| raconte-moi-woippy | Retour menu |
Dernière mise à jour : 20 octobre 2020
|
|
 |
Ci-dessous : articles sur la Guerre de 1914-1918. Pour y accéder, clic sur le titre.
Le 11 novembre 2018, les cloches de Woippy ont sonné à toute volée à partir de 11 heures pour une durée de 11 minutes
pour commémorer l'anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918. | clic |
Le Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919. | clic |
il est aussi intéressant d'y inclure d'autres articles et études, et entre autres, sur le maréchal Bazaine. | clic |
Source : Plaquette "GRAVELOTTE 1870" (1959)

DU SOUVENIR FRANÇAIS
------------
Le SOUVENIR FRANÇAIS créé en 1887 par un modeste professeur alsacien, M. NIESSEN et reconnu d'utilité publique en 1906 a pour but d'entretenir les sépultures de tous ceux qui sont tombés pour la défense de la Patrie.
En fondant cette association, NIESSEN pensait surtout aux Morts de 1870-71, car il voulait que sous le couvert du culte de ces Morts, le SOUVENIR FRANÇAIS s'efforçat de maintenir le Souvenir de la France en Alsace et en Lorraine et celui de l'Alsace et de la Lorraine en France.
En 1907, alors que des groupements existaient dans quatre-vingt-un départements, un comité se forma en Lorraine dont Jean-Pierre JEAN était l'âme.
Depuis 1870, une pieuse coutume s'était établie dans de nombreuses localités de notre province annexée, ainsi qu'en Alsace : le jour des Morts, les jeunes filles en vêtements traditionnels de fête, fleurissaient les tombes militaires de leur commune, en glissant furtivement sur les tombes françaises une cocarde tricolore, témoignage de leur souvenir et de leur espérance.
Le même sentiment avait guidé les « DAMES DE METZ » qui, après avoir donné tout leur dévouement dans les ambulances de la grande cité lorraine avaient vaincu tous les obstacles pour entretenir dignement les tombes militaires françaises au CIMETIÈRE CHAMBIÈRE et faire célébrer chaque année, le 7 septembre, à la Cathédrale de Metz, un service solennel à la mémoire des soldats de France.
Aussi lorsque M. J.-P. JEAN fils et petit-fils de soldats français créa à VALLIÈRES, près de Metz un comité du SOUVENIR FRANÇAIS, put-il, par son dynamisme et sa tenacité, remuer tout le pays, recueillir l'obole de tous les Lorrains annexés, riches et pauvres, et gagner ensuite l'Alsace à son mouvement généreux, enfin vaincre toutes les oppositions allemandes. Il réussit ainsi à faire inaugurer en grande pompe, le 4 octobre 1908, en présence de drapeaux tricolores, le MONUMENT DE NOISSEVILLE consacré aux « Soldats Français tombés glorieusement au Champ d'Honneur ».
Cette cérémonie grandiose de piété et de fidélité françaises se déroula en présence de plus de cent vingt mille personnes, aux sons de « Sambre et Meuse » et de la « Marche Lorraine ».
Mais cette manifestation ouvrit les yeux des Allemands qui croyaient que l'amour de la France était à jamais mort dans les cœurs lorrains. Ils déplaçèrent le Statthalter d'Alsace-Lorraine et se rendant compte de la propagande française suscitée par le SOUVENIR FRANCAIS, ils résolurent d'y mettre un frein. Ils persécutèrent cette association, créèrent mille difficultés pour pouvoir interdire ses manifestations, et en janvier 1913 prononcèrent sa dissolution.
Actuellement l'œuvre matérielle du SOUVENIR FRANÇAIS n'est que la manifestation tangible de notre reconnaissance envers tous ceux qui sont morts pour que la FRANCE VIVE, donnant ainsi le plus bel exemple de solidarité nationale qui puisse exister.
Le sentiment du devoir, l'esprit de sacrifice, l'amour de la Patrie, tracent au SOUVENIR FRANÇAIS la tâche qui lui incombe. L'association doit donc, aux termes de ses statuts, conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, ou qui l'ont honorée par de belles actions, en transmettant le flambeau du Souvenir aux générations successives à qui elle doit inculquer le culte et exhalter les vertus de ces Morts qui, sacrifiant tout pour leur pays, lui ont fait le don sublime de leur existence. Telle est la mission d'ordre moral du SOUVENIR FRANÇAIS.
Le SOUVENIR FRANÇAIS, dans le but d'étendre sa mission, s'efforce de pénétrer dans les divers milieux de la jeunesse, et pour cela demande l'appui des autorités civiles et religieuses, des membres des divers corps enseignants, des dirigeants des grandes associations de jeunes. Aussi de nombreux comités comptent un grand nombre de jeunes adhérents, garçons et filles, qu'il faut encourager à occuper des fonctions de premier plan au sein de l'oeuvre.
Le SOUVENIR FRANÇAIS, placé statutairement en dehors et au-dessus de toute préoccupation politique ou confessionnelle, est qualifié pour permettre à tous les Français, pauvres et riches, de toutes situations sociales, hommes, femmes et enfants, de s'associer dans un hommage, si modeste soit-il, de gratitude personnelle à la mémoire des « Morts pour la France ». C'est autour de lui, dans ses diverses sections, que doivent s'unir les familles glorieusement endeuillées, les camarades de combat, les compatriotes et amis de nos héros, tous les cœurs généreux et reconnaissants, plus ou moins éprouvés par les guerres dans leurs plus chères affections.
Français et Françaises, tous unis, doivent apporter au SOUVENIR FRANÇAIS le touchant témoignage de leur fidélité à la glorieuse mémoire des « Morts pour la France ».
René PETITJEAN
Délégué Général du SOUVENIR FRANÇAIS
de la Moselle et de l'arrondissement de Briey.
| Haut de page |
 N° 437 - 4e trimestre 1999 |
SON HISTOIRE
1870-1887: LES PRÉMICES.
1870 - La défaite. L'Alsace et la Lorraine sont occupées mais le sentiment national demeure toujours aussi vivant. Tandis qu'en Lorraine " Les dames de Metz " veillent à l'entretien des tombes militaires françaises du cimetière de Chambières, à Metz, et font célébrer chaque année un office religieux pour les soldats morts pour la France, en Alsace, à la Toussaint, les jeunes filles en costume traditionnel vont fleurir les tombes des soldats de leur commune en y déposant furtivement une cocarde.
1872 - Une volonté. Xavier NIESSEN, professeur alsacien, a la volonté de manifester le refus du nouvel ordre prussien en Alsace et en Lorraine, de prouver l'attachement indéfectible des Alsaciens et des Lorrains, dans leur majorité, à la Patrie française, et de maintenir le Souvenir des provinces perdues en France de l'intérieur. Ainsi, pense-t-il, en même temps que quelques amis regroupés autour de lui, que le culte des Morts pour la France et l'entretien de leurs tombes peuvent et doivent constituer le trait d'union capable de conserver dans les esprits le sentiment d'unité nationale.
1887-1914 : NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DU SOUVENIR FRANÇAIS.
En France de l'Intérieur.
Xavier NIESSEN, en 1887 crée, à Neuilly-sur-Seine, le Souvenir Français dont le nom traduit bien la volonté de constituer ce trait d'union entre tous les Français, regroupés dans une association, autour des valeurs de la France et de la République, pour lesquelles 100 000 de ces soldats se sont sacrifiés en 1870-1871.
Pour atteindre cet objectif, deux tâches matérielles lui paraissent essentielles : entretenir les tombes de ces soldats où qu'elles se trouvent, élever des monuments à leur mémoire, le principe des monuments aux morts communaux n'existant pas à l'époque.
Le 7 mars 1888, la première phase d'organisation du Souvenir Français est achevée et Xavier NIESSEN appelle les Français à rejoindre l'association. Le Souvenir Français entre alors dans une période active et son développement sera très rapide : en 1906, il est présent dans 81 départements et son action est " reconnue d'utilité publique " le ler février de cette même année.
Ainsi, moins de vingt ans après sa création, le Souvenir Français est l'objet d'une reconnaissance officielle en raison des nombreuses actions accomplies non seulement pour l'entretien des tombes, mais aussi pour l'érection de monuments en maints endroits, Fauquembergues dans le Pas-de-Calais, Valbonne dans les Alpes-Maritimes, Montbard en Côte-d'Or, à Brive, Saint-Dié, Nîmes, Pau etc.
Concernant l'entretien des tombes, l'idée se fait jour assez vite qu'il convient aussi de ne pas négliger les tombes de ceux qui sont enterrés dans des pays lointains, souvent des marins ; à partir de 1889, l'action du Souvenir Français tend à s'étendre au-delà du territoire national, les premières actions s'exercent en Belgique (Waterloo) et aux Pescadores (détroit de Taïwan).
En Lorraine et en Alsace annexées.
C'est en Moselle que va se créer le premier comité du Souvenir Français. Jean-Pierre JEAN, imprimeur et futur député de la Moselle, crée en 1907 dans le petit village mosellan de Vallières " le comité messin du Souvenir Français ".
L'audience de ce comité s'étend avec une grande rapidité au point qu'en une année, lançant une souscription pour ériger un monument de mémoire, l'élan est tel que les autorités prussiennes ne peuvent s'y opposer et que les fonds sont recueillis si rapidement que le monument est érigé et inauguré le 8 octobre 1908. Situé à Noisseville, à proximité de Metz, ce monument est dédié " aux soldats français morts au champ d'honneur ". L'inauguration, sous les plis du drapeau tricolore, réunit 120 000 personnes.
L'Alsace est alors gagnée, à son tour, par l'élan donné en Lorraine. C'est l'action de Monsieur SPINNER, de Wissembourg qui va, en fait, marquer, de façon significative, l'audience du Souvenir Français dans la province.
Il décide, en effet, d'ouvrir une souscription pour ériger un monument à la mémoire des soldats morts pour la défense de la Patrie en Alsace, en deux siècles de conflits : en 1705, sous le commandement du Maréchal de VILLARS, en 1793, aux ordres du Général HOCHE et en 1870 avec le Général Abri DOUAY.
Le 17 octobre 1909, le monument est inauguré à Wissembourg, sur le Geisberg, devant une foule de 80 000 personnes, au chant de la Marseillaise.
Tant en Lorraine qu'en Alsace, l'essor du Souvenir Français inquiète les autorités prussiennes qui y voient, à juste titre, la marque du rejet de l'annexion par la population ; les manifestations publiques du Souvenir Français sont interdites et, en janvier 1913, l'association est dissoute. Enfin, dès le début de la guerre de 1914, les membres du Souvenir Français en Alsace et en Lorraine, sont arrêtés et déportés à l'intérieur de l'Allemagne.
1914-1919 : LE SOUTIEN AUX FAMILLES, L'HONNEUR AUX MORTS.
La guerre amène une désorganisation des comités, car un bon nombre des adhérents sont mobilisés. Assez rapidement, toutefois, des femmes et des hommes plus âgés viennent assurer la relève.
L'action du Souvenir Français se diversifie alors, tant il est clair qu'il est nécessaire d'apporter un soutien moral aux blessés soignés dans les hôpitaux et une aide aux familles touchées par la disparition de l'un des leurs. Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner tous les soldats décédés dans les hôpitaux de l'intérieur ; les membres de l'association s'efforcent, lorsque les familles sont absentes, d'accompagner leur enterrement et de veiller sur leurs sépultures. Localement, les besoins étant immenses, de nombreuses associations se créent poursuivant des buts similaires. Sous l'impulsion du conseil d'administration du Souvenir Français, et notamment de Monsieur Xavier NIESSEN, les 43 nouveaux comités qui ont été créés depuis le début de la guerre et les adhérents dispersés collaborent avec elles et les fédèrent.
Ainsi, l'association "La Cocarde du souvenir" qui s'est donnée pour mission de placer sur les tombes dispersées des champs de bataille l'inscription des noms et une cocarde tricolore s'est associée au Souvenir Français.
Outre l'organisation des premiers cimetières nationaux et carrés militaires - 200 pour la seule année 1914 - le Souvenir Français s'efforce d'organiser des cérémonies patriotiques et de mémoire et d'ériger stèles et monuments commémoratifs.
Le Souvenir Français poursuivit ainsi son action jusqu'après la victoire, mais l'association qui avait déjà la charge de 88 000 tombes de 1870, ne pouvait à elle seule s'occuper des tombes de 1 700 000 morts de la grande guerre.
1919-1939 : SE SOUVENIR.
La loi du 31 juillet 1920 crée le Service National des sépultures ; dès lors l'État prend à sa charge les cimetières militaires de l'ancienne zone des armées et organise les nécropoles nationales. Restent alors les carrés militaires communaux : leur entretien est confié aux municipalités qui, dans de nombreux cas, demandent au Souvenir Français de se substituer à elles.
Pendant les vingt années qui vont suivre la guerre de 1914-1918, l'action du Souvenir Français, qui se reconstitue surtout dans le Nord et l'Est de la France ainsi que dans le Sud-Est, en Corse, en Bretagne, et en Normandie, porte son effort, outre l'entretien des tombes, sur l'organisation des cérémonies patriotiques en liaison avec les associations d'anciens combattants et sur l'érection de monuments du Souvenir, à l'exception des monuments aux morts communaux à la charge des municipalités.
Certains de ces monuments, comme par exemple le Mort Homme, dans la région de Verdun, sont encore, aujourd'hui, la propriété du Souvenir Français qui a en charge leur entretien. D'autres, construits par des associations régimentaires, aujourd'hui disparues ont été érigés avec la participation du Souvenir Français et leur propriété lui a été transférée ultérieurement. Ce patrimoine monumental s'ajoute ainsi à celui hérité de la guerre de 1870-1871, comme la maison de la dernière cartouche de Bazeilles (Ardennes) par exemple.
Mais le temps passe et se pose, comme aujourd'hui d'ailleurs, le problème des tombes familiales abandonnées et dans lesquelles se trouvent les restes de soldats morts pour la France ; à leur initiative les comités du Souvenir Français prennent en charge leur entretien. Ainsi peut-on lire dans un numéro de la revue du Souvenir Français de 1934 :
« Le comité de Fismes a offert son concours, dans la mesure de ses disponibilités, aux 24 maires du canton pour que les quelques tombes familiales contenant le corps de soldats et aujourd'hui abandonnées soient toujours convenablement entretenues ».
L'objet du Souvenir Français est alors limité "à l'édification et à l'entretien des monuments et tombes militaires". Toutefois, dès le début des années 1930, la transmission du Souvenir des soldats morts pour la France et l'explication du sens de leur sacrifice aux plus jeunes deviennent de plus en plus des sujets de préoccupation.
La chronique des comités publiée par la revue du Souvenir Français en est l'illustration :
« À Saint-Malo, le 1er novembre 1933, les enfants des écoles défilent devant les tombes des soldats et y déposent les fleurs qu'ils tenaient à la main... à Knutange, le 11 novembre 1934, le cortège comprenant les enfants des écoles se rend au Monument aux Morts... à Cortisols, des fleurs sont déposées au pied du Monument aux Morts par les enfants... ».
Au 1er janvier 1939, le Souvenir Français comptait environ 100 000 membres et son développement se poursuivait outre-mer par le biais d'associations sœurs comme le Souvenir Indochinois par exemple.
1939-1945 : VEILLER.
La guerre conduit assez rapidement à une impossibilité de maintenir la cohérence des actions du Souvenir Français et l'exode, précédant la défaite. va accroître la désorganisation de l'association que la perte de l'Alsace, de la Moselle et d'une partie du Nord va encore affaiblir, mais s'il n'y a plus là d'actions coordonnées possibles, en France de l'intérieur, il faut reconstruire le Souvenir Français.
En Alsace et en Lorraine occupées.
Les Allemands n'avaient pas oublié l'opposition à la germanisation du Souvenir Français en Alsace-Lorraine avant la guerre de 1914. Dès le début de l'occupation, les dirigeants du Souvenir Français sont chassés vers la France de l'intérieur. A titre d'exemple, Monsieur Jean-Pierre JEAN aura deux heures pour quitter la Lorraine avec sa famille, sans possibilité d'emporter le moindre bien.
Ainsi des 43 000 adhérents que comptait l'Alsace et la Lorraine en 1939, dont 26 915 pour la Moselle, nombreux furent ceux qui durent quitter leur province, d'autant que les autorités allemandes s'étant emparées des archives, les listes d'adhérents leur' étaient connues. Par la suite certains tentèrent d'opposer une résistance à l'occupant. Il s'ensuivit arrestations et déportations.
En France de l'intérieur.
Le conseil d'administration tient une première réunion après l'armistice le 29 novembre 1940. Tous les administrateurs n'ont pu être prévenus de cette réunion, mais le président général, le général LACAPELLE réussit à revenir de Dordogne pour présider cette réunion.
Les premières décisions sont prises. Il s'agit d'abord de remettre en place des délégations dans les départements, qu'ils soient en zone occupée ou en zone libre, et des comités dans les villes et les campagnes chaque fois que possible.
Sont ensuite fixées les missions prioritaires à remplir au mieux : veiller sur les tombes, rechercher toutes les sépultures des 100 000 soldats morts pendant les combats 1940 et sans attendre, les entretenir.
Le comité directeur de l'association composé du général LACAPELLE, du général SONNERAT, secrétaire général et du colonel AUBERT, trésorier, va s'atteler à cette tâche difficile.
En quelques mois, un fichier de 80 000 noms de soldats morts pour la France est établi par le siège, grâce à l'action assez remarquable des comités. Assez rapidement, apparaissent les difficultés de liaison entre la zone libre et la zone occupée ; aussi, un administrateur délégué pour la zone libre est-il nommé, le Général GOURGUEN. En 1942, le Général LACAPELLE meurt à la tâche. Il est aussitôt remplacé par le Général de POUYDRAGUIN.
À partir de 1943, il apparaît toutefois que toute l'action du Souvenir Français repose sur l'initiative de ses adhérents, la coordination des délégations et des comités par le comité directeur étant de plus en plus difficile, d'autant qu'il s'agit alors de veiller sur les sépultures des résistants et des victimes des bombardements.
Au jour de la libération, grâce à ses 120 000 membres recensés alors, dont tous les Alsaciens et les Lorrains réfugiés et anciens adhérents, qui avaient rejoint les comités de l'intérieur, les missions avaient été remplies au mieux.
Le Général de Gaulle, dans une lettre adressée au président général devait saluer l'action du Souvenir Français pendant cette période tragique.
DEPUIS 1945 : GARDER LA MÉMOIRE. TRANSMETTRE L'HÉRITAGE.
Dès la fin de la guerre, le Souvenir Français connaît un développement important, en s'appuyant surtout sur les associations d'anciens combattants ; en 1958, il comptait 300 000 membres adhérents.
Outre les missions habituelles d'entretien des tombes et des monuments, le Souvenir Français se veut gardien de la mémoire. Il lui appartient donc d'organiser et de participer à toutes les cérémonies patriotiques et de veiller à ce que l'oubli ne fasse son œuvre ni en France, ni dans les pays étrangers où nos soldats ont combattu. Aussi un effort particulier est fait pour, qu'aussi bien dans la France métropolitaine que dans la France d'Outre-Mer, il soit représenté et qu'un réseau de correspondants se développe à l'étranger.
Dans le même temps, notre armée est engagée en Indochine, où elle perd 100 000 hommes, à Madagascar, en Corée, au Maroc, en Tunisie puis en Algérie où 25 000 soldats français sont tués ; 120 000 harkis et leurs familles meurent pour la France entre 1954 et 1962.
Vers la fin des années 1970, il apparaît nécessaire de bien établir la chaîne de responsabilité de l'association et d'en préciser les règles de fonctionnement : un nouveau statut et un nouveau règlement intérieur voient le jour en 1979.
Ces deux documents traduisent l'évolution de l'association.
- Ils marquent, d'abord une prise de conscience pour l'avenir : les anciens combattants ne sont pas éternels et le Souvenir Français, à terme, sera la seule association privée existant pour garder la mémoire et transmettre l'héritage aux générations successives. Aussi convient-il de bien marquer le fait que le Souvenir Français n'est pas une association d'anciens combattants, mais qu'il s'agit d'une œuvre inspiratrice d'énergie morale et de solidarité, en dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle, ouverte à tous, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes.
- Ils montrent aussi, compte tenu de l'expansion du Souvenir Français, présent alors dans la totalité des départements métropolitains et d'Outre-Mer et dans 52 pays étrangers, la nécessité d'établir des règles de fonctionnement qui écartent toute lourdeur administrative dans un souci de limiter au maximum les frais généraux. Il est à noter que la règle établie alors innove dans la mesure où elle décentralise les responsabilités au niveau des délégués généraux.
- Ils insistent enfin sur le fait que la transmission de l'héritage reçu ne pourra être réalisée qu'à la condition que des tâches visibles soient effectuées : garder la mémoire, en animant en particulier les manifestations patriotiques, entretenir les tombes et les monuments, pour bien montrer le respect que nous devons à ceux qui sont morts pour défendre le droit et la liberté.
- Il reste que cette transmission de l'héritage est maintenant la mission essentielle, le Souvenir Français doit en être garant.
* *
SOUVENIR ET MÉMOIRE
Nostalgie
d'un passé révolu ou socle
pour une nouvelle citoyenneté ?
11 novembre, 8 mai, partout en France les monuments aux morts de nos villes et de nos villages sont fleuris ; de même, le 2 novembre, respectant en cela un décret de 1919, des fleurs sont déposées dans les nécropoles nationales et dans les carrés militaires de nos cimetières.
De telles cérémonies ont lieu sur tout le territoire national, à Montpellier comme à Nouméa, à Arras comme à Château-Chinon ou à Fort-de-France, et il en est de même au moins dans les 52 pays où le Souvenir Français est représenté et sans doute en d'autres lieux où les cérémonies analogues se déroulent.
Tous les soirs, un peu avant la tombée de la nuit, place de l'Étoile à Paris, la circulation automobile est interrompue et un cortège de drapeaux portés par des hommes et des femmes souvent âgées, gagne la dalle sacrée avant que la flamme qui y brûle ne soit ranimée dans le recueillement.
Toutes ces cérémonies devant un public le plus souvent bien clairsemé ne traduisent-elles que la manifestation d'un rite un peu désuet appelé à disparaître lorsque tous ces anciens combattants qui en sont les animateurs auront disparus ?
Devra-t-on, au contraire perpétuer ces marques de respect et de reconnaissance envers ceux qui sont morts pour la France ?
Pour apporter quelques éléments de réponse à ces questions, un survol rapide de notre histoire nationale, de la guerre de 100 ans à nos jours, permet de dégager quelques constantes qui expliquent et justifient les sacrifices consentis et en éclairent le sens.
Jeanne d'Arc : nous célébrons encore aujourd'hui sa mémoire au point qu'un ministre de la République dépose chaque année une gerbe de fleurs au pied de sa statue en reconnaissance de son combat et de son sacrifice pour la liberté.
Les volontaires de 1792 dans l'enthousiasme et les grognards de l'Empire dans la sérénité ont combattu avec la conscience claire d'un devoir à accomplir envers les peuples d'Europe en leur donnant de nouvelles raisons de vivre et d'espérer.
Plus tard, les premiers résistants qui furent ces soldats en guenilles des armées de la Loire et de l'Est de 1870 et 1871 n'étaient-ils pas animés, eux aussi, par leur foi dans les valeurs de la République qui correspondent, me semble-t-il à celles du patriotisme français dans ses profondeurs et sa permanence ? Abordant notre siècle sanglant, je me limiterai à trois exemples qui me paraissent significatifs :
- le sursaut extraordinaire de ces soldats retraitant, à pied, pendant des centaines de km, pressés par l'adversaire, et qui amènera la 1re victoire de la Marne. Quelle était donc la motivation profonde de ces hommes, car il en fallait bien une pour se relever ainsi et repartir en avant ?
- l'acharnement des combattants de 1940. N'oublions pas ces 100 000 morts au combat en 40 jours qui tentèrent l'impossible malgré tout ;
- et puis aussi, ces jeunes gens qui, crânement, le 11 novembre 1940, après la défaite, remontèrent les Champs Elysées pour saluer le soldat inconnu.
Pourquoi toutes ces actions, pourquoi tous ces sacrifices, pourquoi cette même volonté qui semble traverser le temps ?
Tous ces hommes, toutes ces femmes n'étaient pas nés pour être des héros. Issus le plus souvent des profondeurs du peuple de France, ils acceptaient le sacrifice pour défendre l'honneur de la Patrie, et surtout au nom des valeurs que celle-ci incarnait à leurs yeux : la liberté et le droit.
Pour éclairer mon propos, je ferai appel à deux écrivains illustres, tous deux morts au cours de la grande guerre :
- Alain Fournier d'abord qui écrivit au tout début de cette guerre « Juste guerre, je sens profondément que nous serons vainqueurs au nom du droit » ;
- Charles Péguy, bien avant cette guerre, inscrivit en dédicace de sa Jeanne d'Arc :
« à toutes celles et à tous ceux qui auront vécu leur vie humaine, à toutes celles et à tous ceux qui seront morts, de leur mort humaine, pour l'établissement de la République Universelle, ce poème est dédié ».
Ces deux citations traduisent, me semble-t-il, la place originale de la France qui porte en elle un message universel explicité dans la devise de la République. Ces trois mots de Liberté, d'Égalité et de Fraternité auxquels bien souvent nous ne portons plus attention méritent que l'on s'y arrête, et que l'on réfléchisse à l'idéal élevé qu'ils représentent et pour lesquels tant d'hommes et de femmes se sont battus.
Mais, aujourd'hui où nous rêvons d'une paix éternelle, est-il nécessaire d'établir cette réflexion sur leurs sacrifices. Faut-il encore et toujours se souvenir de ceux et de celles qui sont morts pour la France, mais à une époque et dans des circonstances bien particulières et qui ne reviendront jamais ?
Faut-il encore et toujours rappeler la mémoire de Guillaume Apollinaire, de Robert Desnos, d'Estienne d'Orves, de Berthie Albrecht ou de Guy Moquet ?
Faut-il encore et toujours rappeler les dernières paroles du simple canonnier Maillot en Juin 1940, murmurant à son lieutenant avant de mourir « N'ai-je pas bien accompli mon devoir ?» ou encore celles du lieutenant tunisien El Madi, tué au Garigliano, dont les derniers mots furent « Vive la France ».
Une réponse affirmative à ces questions n'amènerait-elle pas à un repli frileux vers un nationalisme étroit en nous tournant vers un passé définitivement révolu ?
Très sincèrement, je ne le crois pas et bien au contraire, je pense que c'est à partir de la conscience de cet héritage de valeurs que nous avons reçu que nous construirons un patriotisme ouvert et accueillant préparant un avenir plus fraternel et qui, ce faisant, doit être un ferment dans cette Europe en construction.
Il est maintenant courant, dans l'espoir d'atteindre cet objectif d'utiliser l'expression « Devoir de Mémoire ». Personnellement, je préfère utiliser le terme d'héritage. « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament » a écrit René Char et c'est bien d'un héritage qu'il s'agit c'est-à-dire d'une démarche consciente ; le refus de l'oubli doit être l'acte volontaire d'un citoyen responsable ; un héritage doit être accepté.
Pour susciter une telle démarche, encore faut-il que les nécessités en soient comprises.
C'est là le rôle de l'État, me direz-vous, c'est exact mais cette réponse ne paraît pas suffisante. Pour que l'action de l'État, dans ce domaine de la mémoire, soit appréciée et efficace, celle-ci doit être relayée par les initiatives individuelles.
Ce sera, bien évidemment, le rôle des Anciens Combattants et de leurs associations. Tous ils représentent une mémoire vivante bien à même d'expliquer en témoignant.
Mais dans vingt ans la plupart d'entre eux auront disparu et il faut prendre dès maintenant le relais. C'est à cette tâche que s'emploient quelques associations, le Souvenir Français qui se veut gardien de la mémoire, est garant de la transmission des valeurs de la République aux générations successives, tant cette réflexion d'André Gide est exacte : « Le Présent serait plein de tous les avenirs, si le passé y projetait son histoire ».
Évoquant le Souvenir Français, l'histoire de notre association privée, apolitique et non confessionnelle me semble intéressante à retracer à grands traits, tant elle montre une volonté constante de pérenniser la mémoire et la façon d'y parvenir.
Le Souvenir Français est né en 1872, par la volonté des Alsaciens et des Lorrains de conserver vivante la mémoire de la Patrie Française. Le fondateur, Xavier Niessen a compris que pour maintenir un idéal qui au fil des ans risquait de devenir une abstraction, il était nécessaire de s'appuyer sur des gestes concrets pour marquer, de façon visible la foi dans cet idéal. Ainsi, en Alsace, tous les ler novembre des petits bouquets de fleurs aux couleurs nationales étaient déposés sur les tombes des soldats morts en 1870 et inhumés en Alsace. Deux monuments furent ensuite élevés l'un en Lorraine à Noisseville près de Metz, en 1906 et l'autre en Alsace à Wissembourg et inauguré devant respectivement 120 000 Lorrains et 80 000 Alsaciens. Les Prussiens prononcèrent alors la dissolution de l'Association en Alsace Lorraine.
De 1940 à 1944, ceux qui restaient du Souvenir Français à Paris, participèrent tous les soirs avec ceux qui restaient du comité de la Flamme, au ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe.
Aujourd'hui encore nous suivons la même ligne avec nos 130 000 adhérents directs et nous nous efforçons, souvent avec le Secrétariat d'État comme avec les collectivités locales d'entretenir les lieux de mémoire, réhabilitant chaque année une cinquantaine de monuments et 10 000 tombes et en veillant sur 100 000 tombes. Car, nous sommes convaincus qu'il ne suffit pas de dire ; pour convaincre, il faut faire.
C'est ainsi, grâce à ces actes visibles que peuvent être organisées annuellement sur les lieux de mémoire des visites pour 40 000 scolaires environ.
Certes, il s'agit d'un combat rude et difficile, mais restons confiants pour l'avenir. Nous réussirons à perpétuer les enseignements de ceux qui sauvèrent l'honneur en 1940, des résistants qui refusèrent la défaite, des Français libres à l'admirable sursaut patriotique, de tout un peuple qui se retrouva dans cette Armée française aux multiples composantes mais animés d'une même foi et d'une même volonté, de tous ceux enfin qui tout simplement servirent l'État avec discipline et abnégation, tant au cours des conflits mondiaux, que dans les guerres de décolonisation et qui servent encore aujourd'hui dans les Balkans ou au Timor.
Restons confiants car nous affirmerons toujours comme Paul Eluard : « Je suis né pour te connaître, pour te chanter, liberté ».
Restons confiants car, comme Saint Exupéry nous savons que « le disparu si l'on vénère sa mémoire est plus précieux et plus puissant que le vivant ».
Pierre de PERCIN
Président général
| Haut de page |
N° 378 - 1er trimestre 1985
XAVIER NIESSEN QUITTAIT CE MONDE...
| Il y a 65 ans le 29 décembre 1919 Xavier Niessen quittait ce monde. M. R. Niessen, petits-fils du fondateur du « Souvenir Français » a bien voulu évoquer pour nos lecteurs l'image de son grand-père dans l'intimité familiale. Nous lui exprimons ici nos vifs remerciements. |
EVOCATION
Je passais chez mon grand-père la plus grande partie de mes « loisirs » d'enfant... Je le revois pendant toutes ces années qui étaient celles de la « Grande Guerre », assis chaque jour, et du matin au soir, à son bureau dans ce pavillon de Neuilly où il habitait depuis très longtemps, au fond d'une allée de paisibles jardins que bordaient des lilas. C'est là qu'était né le « Souvenir Français », dans le souvenir de l'Alsace et de la Lorraine annexées, qui étaient le leitmotiv de la vie quotidienne de cette maison.
Les livres qu'il me montrait étaient ceux de Hansi. Les meubles qui nous entouraient venaient de chez son oncle de Lorentzen qui l'avait élevé, car il avait perdu, très jeune, ses parents. Une grande pendule à musique et à personnages jouait (et joue encore) de vieux airs alsaciens quand sonnaient les heures. Au mur, une grande photographie (maintenant au siège du « Souvenir Français ») de l'inauguration du monument de Noisseville avec une dédicace de J.-P. Jean, président du comité du monument : « A Xavier Niessen, fondateur du « Souvenir Français ». Les voix que j'entendais « chez nous » étaient souvent chargées du puissant accent de l'Est, mais plus douce était celle de ma grand-mère qui, à vingt ans, avait quitté Metz et émigré après la débâcle. Elle me racontait parfois comment elle avait vu, derrière les persiennes closes, l'entrée des Allemands dans la ville après la capitulation.
Dans les grandes occasions, après le repas, on me disait de me lever et de chanter l'une de ces romances que tous connaissaient :
« Sentinelle, ne tirez pas !
C'est un oiseau qui vient de France... »
ou encore :
« Vous avez pu germaniser la plaine
Mais notre cœur vous ne l'aurez jamais ! »
Pas un jour, de 1914 à 1918, Xavier Niessen ne quitta Paris. Au pavillon de l'avenue de Neuilly les visites pendant ces années d'angoisses et d'espoirs ne cessaient pas ci mon grand-père était souvent un consolateur pour ceux qui venaient auprès de lui rhri chrr un réconfort. C'était bien là je crois, d'ailleurs, l'image qui aura demeuré de lui chez ceux qui l'ont connu : l'image de la bienveillance et de la bonté.
ll se promettait de m'emmener en Alsace « après la Victoire ». Lui-même n'avait pu y retourner, le territoire alsacien lui étant interdit « sous peine de forteresse » (selon un document entre mes mains du Ministerium für Elsass-Lothringen). Mais cet espoir ne se réalisa pas. La mort l'empêcha...
Un beau souvenir me reste, cependant, de cette année 1919 : celui de la cérémonie qui était organisée chaque année au Trocadéro par la Société de Secours Mutuels des Alsaciens-Lorrains, fondée bien avant le « Souvenir Français » par mon grand-père afin de venir en aide à ceux qui avaient quitté les provinces perdues. Xavier Niessen y prononça un de ces discours auxquels sa voix puissante, sa prestance, son émotion communiquaient un élan irrésistible. Sur la scène, debout, trois jeunes filles, tenant des drapeaux : la France, en longue robe blanche. A sa droite et à sa gauche l'Alsace et la Lorraine, en costume de leur province. Le maréchal Foch arrive. Il donne à Niessen l'accolade aux applaudissements de toute la salle, tandis que, près de lui, la France retire les crêpes de deuil des drapeaux de l'Alsace et de la Lorraine.
Il aura eu cette joie.
Robert NIESSEN
| Haut de page |
N° 386 - 1er trimestre 1987
Né le 11 octobre 1846 à Sarreunion, fils de François Niessen et de Marie Elisabeth Antoni qui y étaient domiciliés, François Xavier Niessen devint prématurément orphelin. Il fut élevé par un oncle, frère de sa mère, qui vivait à Lorentzen près de Saverne. Cet oncle, célibataire endurci, l'envoya commencer ses études à Bitche. Après ses humanités, il devint professeur et, très jeune, il commença à enseigner au collège Sainte-Croix à Neuilly où il obtint de bons résultats. Après les hostilités il reprit son service à Neuilly puis s'établit comme professeur libre, situation qui lui laissait plus de loisirs pour s'occuper du « Souvenir Français » et d'une autre association d'Alsaciens Lorrains qu'il avait fondée.
Après la fin de la guerre de 1870, le spectacle des campagnes où les opérations s'étaient déroulées étant désolant ; maisons éventrées par les bombes et les obus, et, si les plaines reprenaient vite leur aspect de champs cultivés, à chaque pas, des tumuli récents arrêtaient le regard, sommés d'une croix hâtivement faite de deux branches entrelacées avec parfois une inscription « Ici git »... vite lavée par les successions de pluie et de soleil. Douloureusement ému d'un pareil état de choses, France Xavier Niessen entreprit à l'unisson avec les municipalités des départements de l'est de rechercher les restes abandonnés et de leur faire élever des monuments dont l'entretien serait assuré en permanence.
Par ailleurs dans le cadre des relations qu'il avait maintenues avec les provinces annexées, il avait aussi remarqué que les jeunes filles de Lorraine et d'Alsace avaient tendance à abandonner la coutume d'aller, à la Toussaint, avec des bouquets tricolores, fleurir les tombes des soldats français disséminées sur les anciens champs de bataille. Il redoutait que l'oubli amène dans ces provinces une désaffection pour la mère Patrie.
Parvenu à la conclusion que la seule bonne volonté d'individus isolés ne suffirait pas à cette tâche immense, François Xavier Niessen réunit à la mairie de Neuilly en février 1887 quelques habitants de cette localité à qui il fit adopter son idée : le « Souvenir Français », société nationale pour l'édification et l'entretien des tombes des militaires et marins morts pour la Patrie.
Cette définition d'une action à venir s'étendait au-delà des victimes de la guerre récente à tous ceux qui à travers les siècles ont versé leur sang pour créer, agrandir ou sauver la terre de France. En même temps ce culte des morts sous-entendait le maintien de liens avec les provinces annexées chères au cœur de Niessen.
Le 7 mars 1888, l'association « Souvenir Français » reconnue par les autorités administratives pouvait se donner le développement que requérait l'ampleur de ses objectifs. Dès 1889 le « Souvenir Français » était représenté dans tous les départements et même aux colonies et à l'étranger.
Instigateur de l'œuvre, François Xavier Niessen a défini ses objectifs auxquels tous les Français peuvent souscrire indépendamment de leurs opinions personnelles, politiques ou confessionnelles, sans y renoncer en rien. Mais aussi il pousse à la présidence de l'Association des personnalités prestigieuses (le général Fournier, puis le général Leval, ancien ministre de la Guerre, sont les deux premiers présidents) et se contente du rôle de secrétaire général où son activité fait merveille malgré sa modestie ; c'est en 1906 que l'Association est reconnue d'utilité publique.
Le « Souvenir Français » a aussi essaimé en Alsace Lorraine occupée avant d'être dissout par les Allemands en 1913 quand ils s'aperçurent de son influence. Mais néanmoins à Metz en 1908 et près de Wissembourg en 1909, sur des initiatives du « Souvenir Français » local, des monuments à la mémoire des soldats morts pour la France ont été édifiés et inaugurés en présence des autorités allemandes. C'est le « Souvenir Français » représenté par Niessen qui avait été désigné par le ministère des Affaires étrangères pour représenter la France à Metz à l'inauguration de 1908.
La guerre de 1914-1918 a vu se développer encore les activités du « Souvenir Français » : à Paris une délégation du « Souvenir Français » accompagnait à leur dernière demeure tous les soldats morts de leurs blessures dans les hôpitaux. En même temps un effort immense était accompli pour donner des sépultures aux soldats tombés sur le champ de bataille et pour les identifier de façon durable : c'était la distribution de palmes, de couronnes et de plaquettes en quantités considérables.
Enfin 1919 arriva avec la libération des provinces annexées de l'est et François Xavier Niessen put voir ces jours glorieux mais il n'eut pas le temps d'en jouir car il s'éteignit, épuisé, le 29 décembre 1919. Mais en 32 ans de sa vie il avait fait œuvre utile et solide : le « Souvenir Français » continue : il est maintenant centenaire et un centenaire bien vivant !
Après 1919 le « Souvenir Français » a été chargé par l'Etat d'entretenir certaines tombes et il assure la continuité de monuments partout dans le vaste monde où des soldats français ont été mourir pour la Patrie. Maintenant que les associations d'anciens combattants meurent à petit feu faute de survivants, elles savent que le « Souvenir Français » peut prendre en charge les monuments qu'elles ont édifiés et qui doivent perpétuer leur souvenir. Toute cette activité du « Souvenir Français » c'est grâce à François Xavier Niessen et à son action que la patrie la doit.
| Haut de page |
N° 452 - Octobre 2003
(extrait des revues du Souvenir Français n° 38 à 44 en 1924)
En 1887, un modeste professeur alsacien qui avait la passion de la petite Patrie et de la grande, dont l'esprit et le cœur souffraient profondément des suites du traité de Francfort, créait le « Souvenir Français ».
En plus de l'entretien des tombes, et du Culte des Morts, sa grande âme travaillait au maintien du souvenir de la France en Alsace Lorraine, du souvenir de l'Alsace-Lorraine en France.
Choisir pour trait d'union entre les vivants les morts glorieux... Quelle idée plus noble et plus belle ? L'âme généreuse de Niessen l'avait enfantée.
À côté de lui se groupèrent, M. Flasch qui l'a précédé de quelques mois dans la tombe, le colonel Bande, le capitaine Guébin et tant d'autres aujourd'hui disparus.
Ce n'est que le 7 mars 1888 que le Souvenir Français sort de la période d'organisation pour entrer dans une phase active. Nous faisons alors, dit Niessen, un appel chaleureux à tous les Français. Nous convions autour du berceau de la Société tous les hommes qui conservent pur et intact le culte impérissable de la Patrie. Ce culte qui constitue le mobile le plus puissant dans la vie des Peuples. Nous leur annonçons alors la naissance d'une œuvre nouvelle dont la mission consiste à entretenir, non seulement au milieu de nous, mais partout où le sang français a coulé, les tombes des soldats et marins morts au champ d'honneur.
Ce sont nos statuts, c'est notre programme fixé irréductiblement dès l'aube de la Société.
L'idée fit rapidement son chemin. Le 24 mars 1889, avait lieu, dans les salons du Cercle militaire à Paris, l'Assemblée Générale des membres souscripteurs du Souvenir Français.
Le président de la Société était alors le général Fourrier, l'un des fils les plus illustres de la Lorraine.
Dès cette année 1889, deux ans à peine après sa naissance, le Souvenir Français atteint un développement qui, depuis, croît de jour en jour.
Le commandant Borelli et MM. Brunet et Honneau fondent, à Bordeaux, un Comité qui lance ses filiales jusqu'à Saint-Louis du Sénégal.
Dans les Basses-Pyrénées, M. Labille ; dans la Charente-Inférieure, M. Marchais ; dans la Marne, M. le docteur Percheron et le docteur Bresnaker ; en Saône-et-Loire, M. Chabert ; en Haute-Saône, le Commandant Teillard ; en Meurthe-et-Moselle, M. Chone ; à Lille, M. Labarsori ; à Calais, M. Jacques ; à Bruxelles, M. Boclets ; et tant d'autres !
Un mois plus tard, le 5 avril, une grande séance était donnée au Trocadéro. Près de 5 000 personnes se trouvaient réunies pour assister à cette solennité.
Le général Leval, ancien ministre de la Guerre, présidait. Le capitaine de frégate Cordier représente le Président de la République, le commandant Schambert, le général Saussier, Gouverneur de Paris ; des Délégués, des Ministres s'y rencontrent.
Généraux, Sénateurs, Députés, Magistrats, Officiers de toutes armes, membres de la Presse et autres se font un devoir d'honorer de leur présence une œuvre destinée à perpétuer la mémoire des nobles Fils de la France, qui ont versé si généreusement leur sang pour la Patrie.
En face de toute œuvre nouvelle se dressent des obstacles de tout ordre. Le « Souvenir Français » n'a pas échappé à la loi commune. Mais nous sommes, après ce bref exposé, à même de nous rendre compte que, sans le prestige du nom et de la fortune, sans appui politique, sans intérêt et sans attrait matériel, le « Souvenir Français » trouve, dès son origine, dans l'âme même du Peuple, et dans le cœur de nos grands chefs, un appui digne de l'idée qu'il réalise.
Cette idée est si parfaitement en harmonie avec les aspirations françaises !
Dans un des premiers discours de M. Robinet de Cléry ces paroles qui sont d'une si impérieuse actualité, semblent écrites d'hier.
« Il est un mot que nous entendons prononcer un peu par tout le monde, un mot à la mode ; il est dans toutes les bouches, comme une promesse et comme un programme, dans les rangs les plus opposés, sans doute parce qu'il répond à des nécessités pressantes et parce qu'il exprime bien l'état des esprits : c'est le mot de « réconciliation ».
Changeons le mot. Au lieu de réconciliation, mettons « Union sacrée » et nous ferons de ce discours d'hier, un discours d'aujourd'hui.
S'il est une œuvre de réconciliation, d'union sacrée, c'est bien la nôtre ; elle n'exige de personne aucune abdication.
Chacun peut s'y consacrer, sans rien renier de son passé, de ses aspirations, de ses espérances. Nous nous plaçons sur un terrain où rien ne peut nous séparer, nous nous appelons le « Souvenir Français ». Ce que nous voulons garder, c'est le souvenir pieux, le culte de ceux, qui, sous tous les régimes, à toutes les époques, sous tous les drapeaux, ont versé leur sang pour la France.
Ce que nous voulons, c'est perpétuer de pareils souvenirs, les transmettre avec tout leur prestige aux générations futures. N'est-ce pas la meilleure manière d'entretenir, de raviver s'il en est besoin, dans les âmes la flamme pure du patriotisme ?
Faire trêve à la politique de partis, défendre ensemble le dépôt, sacré pour tous, de nos gloires nationales, l'humble soldat qui a donné sa vie, comme le Général qui a succombé en conduisant ses légions dans la mêlée, réunir tous ces souvenirs dans la fraternité du sang versé en commun pour la Patrie, et en rappelant tant d'héroïqnes sacrifices, suggérer à tout Français le désir de les imiter, voilà notre but.
Il semble qu'à travers toutes les secousses, toutes les luttes qui passionnent el qui égarent souvent l'opinion il se forme dans notre pays un courant qui, bientôt, entraînera tout. On se dit : à quoi nous ont servi les querelles de partis, les divisions de la politique ? On commence à comprendre que Celle qui souffre de tous ces coups que nous nous portons les uns aux autres, c'est cette grande Blessée, seule digne de notre dévouement et de notre amour : la Patrie.
Les esprits élevés comprennent mieux que les autres ce qu'il y a de patriotisme vrai dans le sentiment qui nous fait rechercher dans le passé, non pas ce qui nous divise, mais ce qui nous unit. Nous tentons d'honorer comme ils le méritent les noms des guerriers de Lens et de Rocroy, ceux de Fleurus et d'Austerlitz, ceux d'Iéna ; ceux qu'engloutirent les sables de l'Egypte et les neiges du Nord ; ceux de Gravelotte et de Reischoffen, ceux d'Algérie, ceux du Maroc, ceux du Tonkin ; ceux aussi plus chers parce que plus proches, les poilus de la Marne, de la Somme ou de Verdun ; tous les illustres enfants dont les ombres se dressent encore dans leurs tombeaux pour crier : « Vive la France ! ».
Nous honorons tous les Morts, mais s'il est une sépulture que nous entourons d'un plus religieux respect, c'est celle des héros ignorés, de ceux qui n'ont pas d'histoire ».
En 1889, le « Souvenir Français » s'occupait des tombes des survivants d'Héricourt et de Villersexel, auprès du Fort de Foux, où une pierre portait seulement cette inscription : « Aux derniers Morts de la Patrie », et s'occupait du tombeau de Waterloo, ainsi que des sépultures des marins tombés au Pescadores, à l'île de Cabrera.
Il érige une tombe au colonel Moreau, à Stonne ; des monuments à Montigny-le-Garmelon, restaure ou érige ceux de Brive, du Creusot, de Brassen, de Niederbronn, de la Seyne-sur-Mer, de Fréteral, de l'île Sacrificious (près du Mexique), de Scharuntz, dans le Tyrol, d'Arthenay, de Lassalt, de Dijon, de Montbard, de Chaux (Côte-d'Or), de Brinville, de Chemaudin, du Breuil etc.
Le général Leval était alors Président. Le 3 décembre 1891, il donne sa démission et déclare :
« Le Souvenir Français » est en progrès. Son organisation est presque complète, sa situation financière très prospère, le moment est donc favorable pour mettre à exécution mon intention, bien mûrie, de me retirer ».
Son successeur fut le général Casseron de Villenoisy.
Le siège social avait été transféré, du Cercle Militaire, dans un local mis à sa disposition par M. Philippoteau, député des Ardennes, dans son immeuble, 229, faubourg Saint-Honoré, où le Souvenir Français a continué à vivre et à prospérer. Lui seul s'occupe à cette époque de perpétuer, à l'aide de la pierre gravée, le Souvenir des lieux de combats. Marseille, Pau, Hauterive, Saint-Sapporn, Beaune-la-Rolande, Villefort, la Neuville-au-Bois, Feuilloy, Saint-Benoît, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Dormans, Gonesse, Nîmes, Saint-Dié, Hyères, Seissan, Vic, Vesoul, Bourgtheroulde, Sougny, Montpellier, Saint-Denis, Grenoble, Mirande, Larcy, sont tour à tour l'objet de ses soins. Et je ne parle pas des plaques funéraires apportées partout où nos soldats avaient donné leur vie !
À ce moment, le « Souvenir Français » englobe 81 départements.
En 1908, un Comité se forma en Lorraine, dont M. Jean, député de la Moselle, était l'âme, et il s'agissait d'ériger, en Allemagne, deux monuments français. Le premier fut Noisseville et le second Wissembourg. Qui oserait nier que les nombreuses souscriptions recueillies, que les travaux entrepris, que les imposantes cérémonies d'inauguration, suivies ensuite de cérémonies commémoratives et de pèlerinages patriotiques, remplirent alors de joie les cœurs français et d'amertume les cœurs allemands ? qui donc oserait dire que ce ne fut pas un précieux encouragement pour les Français captifs ?
Les Allemands, après avoir donné toutes les autorisations nécessaires se rendirent compte de la propagande française, que suscitait en Lorraine le Souvenir Français, et voulurent y mettre un frein. Ils le persécutèrent créèrent mille difficultés pour pouvoir interdire ses manifestations émouvantes.
On retrouve l'écho de ces manifestations dans les paroles que prononçait en notre nom, un enfant d'Alsace-Lorraine :
« Quarante-deux ans se sont écoulés, un demi-siècle bientôt, mais ce souvenir, pour vous, pour nous, enfants de l'Alsace et de Lorraine, est de ceux que rien ne saurait affaiblir ni même effleurer ».
« Un homme, un orateur d'Allemagne, s'adressait à nies compatriotes, « Vous souvenir, soit, libre à vous... mais espérer... jamais ! « C'est défendu ! ».
« Je ne juge pas, je ne discute pas cette deuxième assertion.
Nous souvenir ? soit ! Nous n'avons pas attendu la permission ! Je ne reconnais à personne sur terre le droit de nous défendre le souvenir. Il y a là sous cette poitrine, un sanctuaire sacré et impénétrable, où le souvenir fleurit tout à son aise.
« Je sais cependant qu'il y a quelques années, un haut personnage disait : « Les jeunes qui n'ont rien vu, n'ont pas à se souvenir ».
« Or, savez-vous qu'elle fut la réponse d'un de ces jeunes, réponse à laquelle ont applaudi tous les esprits droits et tous les cœurs bien faits : « Sans doute, disait-il, je n'ai pas vu les gigantesques batailles de 1870, je n'ai pas entendu le bruit du canon, les cris des blessés, le râle des mourants, je n'ai pas souffert, je n'ai pas pleuré, puisque je n'étais pas. Mais je porte au cœur et dans mes veines le sang de ceux qui ont vu le sang, de ceux qui ont entendu, le sang de ceux qui ont pleuré et souffert, et le bon sang lorrain ne saurait mentir. Je me souviendrai donc et tous nous nous souviendrons de nos héros. Et quand nous, les anciens, nous exhalerons notre dernier soupir, quand nous disparaîtrons de la scène du monde, les jeunes se lèveront pour recueillir de nos cœurs, de nos lèvres, pour pratiquer après nous le culte du Passé et la religion du Souvenir.
« Qui donc voudrait et pourrait nous interdire ce culte, cette religion. Depuis 42 ans nous subissons une situation que nous n'avons point faite et nous sommes la rançon consentie par un traité solennel.
« Nous laissons à la Providence, à la sagesse des Nations, au temps et aux événements, le soin de résoudre ce problème angoissant qui pèse sur l'Europe et le monde entier... ».
Le problème est maintenant résolu et nos populations d'Alsace-Lorraine avec un admirable élan d'enthousiasme, sont venues apporter au « Souvenir Français », dans l'exaltation de leur joie patriotique, les témoignages de fidélité qu'elles ne lui avaient pas ménagés pendant les longues et douloureuses années de servage. Et cette fidélité à toute épreuve n'est-elle point une marque de vitalité pour une association comme la nôtre ?
La guerre ne pouvait pas ne pas jeter la perturbation dans nos comités, au moment où la vie de la France se concentrait tout entière dans nos vaillantes armées.
La plupart de nos collaborateurs les plus jeunes et les plus vaillants étaient mobilisés. Des femmes prenaient, dans nos rangs, la place de leurs époux, des pères, au lieu, de leurs fils ; mais on peut dire que dans bien des comités, ce fut la désorganisation. On essaya de les remonter, mais combien, parmi des plus braves et des plus dévoués de nos membres sont restés là-bas, et dont la perte fut irréparable !
Pendant la guerre, le Souvenir Français accepta tous les concours et participa à l'organisation et au patronage d'œuvres similaires, sans aucune rivalité mesquine.
Dans son rapport avec l'Assemblée générale du 31 juillet 1916, notre regretté fondateur s'exprime ainsi :
« N'oublions pas, Mesdames, Messieurs, de saluer en notre nom et avec toute notre affection, la naissance du Souvenir Belge. Cette nation magnanime vient de s'inspirer de nos statuts et de notre règlement, pour fonder avec notre autorisation et sous le vocable de notre devise « À nous le Souvenir, à Eux l'Immortalité » une Association, sœur du Souvenir Français ».
Ces œuvres demeureront désormais, rattachées les unes aux autres pour réunir dans la mort, comme l'ont été dans la lutte, les héros devant lesquels s'inclineront les siècles futurs.
Monsieur BARBUET
Secrétaire Général
du Souvenir Français en 1924
| Haut de page |
N° 371 - Juin 1983
TABLEAU COMPARATIF DES POTENTIELS MILITAIRES FRANCAIS ET ALLEMANDS
Dans l'intention de célébrer le 70e anniversaire de la guerre de 1914-1918, au cours des quatre prochaines années, nous faisons précéder les articles du général Humbert, remarquable historien de cette période, par un exposé clair et précis de l'auteur sur l'état des forces morales, matérielles et des doctrines militaires en France et en Allemagne, au seuil de la grande guerre.
Comment un juge impartial, supposé au courant des secrets des états-majors de France et d'Allemagne, eût-il, le 2 août 1914, du seul point de vue militaire, évalué les chances des deux adversaires ? C'est à cette question que nous chercherons à répondre.
LES FORCES MORALES
Mettons d'abord de côté le moral des combattants. Il n'y a pas de raison de douter en effet qu'il ne fût égal de part et d'autre, c'est-à-dire au plus haut. Il faut avoir voyagé les 2 et 3 août 1914 avec des mobilisés français rejoignant leurs corps et bavardé avec eux durant les longues heures de transport, avoir vu deux jours plus tard, dans une garnison, des échelons de réservistes gagner les quais d'embarquement sans s'émouvoir des femmes et des enfants qui les suivaient en silence, avoir vécu les semaines d'attente avant les premiers combats, parmi cette infanterie presque entièrement paysanne, d'une homogénéité de traditions, de culture et de sentiments dont nous n'avons plus l'idée, pour savoir ce qu'étaient la résolution et la confiance des soldats français. Elevés tant par leurs parents que par leurs maîtres, dans le souvenir de 70 et dans la fierté de leur patrie, dont on leur avait appris amoureusement l'histoire, ne doutant pas qu'elle était attaquée sauvagement et contre tout droit, s'illusionnant à plaisir sur la puissance de ses alliés, ils faisaient tout naturellement face et déféraient sans arrière-pensée à cette obligation intime dont, sous le nom de « devoir », ils étaient pénétrés.
La même certitude d'aller au bon combat, une foi mystique dans l'élection de la nation allemande et une confiance quasi religieuse en leurs gouvernants, animaient les combattants d'en face ; les mots « Gott mit uns » se lisaient sous l'aigle de cuivre de leurs casques à pointe et ils avaient dans leur havresac le livre de prières dont nous devions trouver tant d'exemplaires éparpillés sous les futaies des Vosges.
Sur les wagons « hommes 36 x 40 - chevaux (en long) 12 » les uns avaient tracé à la craie « Direction Berlin » ; sur des wagons similaires, les autres avaient griffonné « Nach Paris ».
LES FORCES DE COMBAT
Les divisions françaises et allemandes étaient, en gros et dans chaque catégorie (d'active, de réserve ou de cavalerie) de force équivalente.
Les divisions affectées initialement aux forces de campagne sur le théâtre nord-est français étaient au nombre de (1) : 46 divisions d'infanterie actives (DIA) françaises contre 45 allemandes ; 14 divisions d'infanterie de réserve (DIR) françaises contre 23 allemandes ; 10 divisions de cavalerie (DC) françaises contre 10 allemandes.
Les deux armées étaient donc à peu près à égalité pour les divisions actives. L'armée allemande bénéficiait d'une large supériorité en divisions de réserve (2). Pour l'infanterie, les bataillons étaient de force semblable ; le nombre de mitrailleuses était de part et d'autre de 2 en moyenne par bataillon.
Pour l'artillerie de campagne, si l'allemande l'emportait légèrement quant au nombre total des pièces, elle était qualitativement nettement inférieure, le 75 qui pouvait tirer 20 coups à la minute, surclassant à tous égards le 77 et disposant d'un obus explosif brisant d'un effet matériel et moral sans égal.
Mais lés divisions et corps d'armée français n'avaient d'autre artillerie que le 75 dont on avait cru trop longtemps qu'il suffirait à tout. Or son tir tendu le rendait souvent incapable d'atteindre les objectifs défilés derrière des crêtes ou enterrés.
Les Allemands, eux, avaient compris cette nécessité. Ils disposaient, dans leurs divisions, d'obusiers de 105, dans leurs corps d'armée, d'obusiers de 150, à l'échelon armée de mortiers de 210, et la portée des 150 et des 210 dépassait celle de nos 75. Ce sont eux que nous avons vu, par exemple, écraser successivement toutes les pièces d'une artillerie divisionnaire, le 25 août 1914, à la lisière de la forêt de Rambervillers. « Alors, mon lieutenant, c'est comme en 70 », nous disait un petit caporal à ce spectacle poignant...
Immédiatement avant la guerre, il est vrai, le commandement français s'était ému de notre carence en artillerie lourde, Il avait passé des commandes, mais il fallait deux années pour les satisfaire. Il avait constitué de bric et de broc au printemps de 1914, cinq régiments d'artillerie lourde, armés de canons de siège et de place désuets, retirés de places déclassées, et d'obusiers de 155, modernes mais sans portée. Il y avait à peu près un de ces régiments par armée, mais on ne les vit guère sur les champs de bataille du début.
Les forces de combat étant somme toute comparables, tout allait dépendre de leur mise en ceuvre, c'est-à-dire de la doctrine de guerre, de l'instruction et de l'entraînement des troupes, de la valeur des hauts commandements et de celle des plans d'opérations.
(1) Il n'est pas fait état des divisions affectées aux places fortes de l'avant (4 DIR en France, 2 DIR en Allemagne) ou maintenues en réserve à l'intérieur (3 DIR en France, 2 DIA et 6 DI d'Ersatz en Allemagne) ni des divisions territoriales ou de landwehr dont l'emploi dans les premières opérations n'était pas prévu, ni du corps expéditionnaire anglais (4 DIA et 1 DC) dont l'intervention n'était pas assurée à la date du 2 août.
(2) Les vingt et un corps d'armée français actifs disposaient chacun, il est vrai, d'une brigade de réserve.
LES DOCTRINES
De part et d'autre, l'offensive était le maître mot : « seule elle permettait d'obtenir des résultats décisifs, la défensive passive était vouée à une défaite certaine et à rejeter absolument » (3). Mais, dans l'armée française, depuis la guerre russo-japonaise où un esprit offensif poussé au paroxysme avait triomphé, nonobstant une grande infériorité numérique, d'une stratégie et d'une tactique généralement défensives, le culte de l'offensive avait pris un caractère absolu, exclusif et quasi mystique. L'attaque était censée apporter la solution de tous les problèmes. Le règlement de 1913 admettait bien que la défensive pouvait trouver une justification - « la seule » - dans « la nécessité d'économiser des troupes en certains points pour donner plus de forces aux attaques », mais, en fait, le combat défensif apparaissait comme discrédité et de mauvais aloi. L'offensive ayant sa vertu en soi, il était toujours plus expédient d'attaquer que d'attendre d'être attaqué soi-même (4). L'armée allemande, elle, sans renier, bien entendu, la primauté de l'offensive mais plus consciente de la puissance du feu, était prête à utiliser sans complexe, le cas échéant, toutes les ressources de la défensive.
L'INSTRUCTION
Du point de vue de l'entraînement et de l'instruction, une grande différence se manifestait en France, particulièrement en ce qui concernait l'infanterie, entre les régiments des régions frontières et ceux de l'intérieur. Les premiers, tenus constamment en haleine, affichaient un esprit de corps très vif, étaient psychologiquement mobilisés en permanence, dotés d'un encadrement d'une qualité moyenne supérieure et bénéficiaient de séjours annuels dans les trois seuls grands camps existant alors en France.
Il n'en était pas de même de ceux de l'intérieur, noyés dans les grandes villes ou fragmentés dans de petites sous-préfectures, ne disposant que de terrains de manœuvres exigus et plats, juste bons pour le rang serré. Leurs cadres, souvent mariés sur place et alourdis par l'âge (5), y vivaient une existence routinière, rompue à l'automne par quelques jours de manœuvres.
Mais, dans les uns comme dans les autres, l'instruction était conforme aux idées régnantes. La préparation au combat se résumait à un exercice cent fois répété : l'attaque, sur le terrain de manœuvres, rigoureusement plat et nu, d'un ennemi déployé à son extrémité. Elle se déroulait par bons alternés et demi-section, l'une censée annihiler, par le jeu de ses Lebels, l'ennemi bien installé, l'autre en profitant pour courir à toutes jambes, jusqu'au moment où toutes deux réunies mettraient baïonnette au canon et se rueraient en criant à tue-tête « en avant à la baïonnette », sur l'ennemi supposé abattu... De l'artillerie, pas question. La section de mitrailleuses du bataillon s'exerçait de son côté, confidentiellement.
(3) Règlement français de 1895, sur le service des armées en campagne.
(4) On a voulu faire d'un simple lieutenant-colonel - d'un rayonnement exceptionnel, il est vrai - le responsable de cette déviation intellectuelle, comme si deux conférences, d'ailleurs assez absconses, prononcées dans un petit cénacle d'officiers généraux et d'officiers supérieurs de grande classe, dont on peut supposer tout de même qu'ils ne manquaient pas d'esprit critique, avaient pu perturber toute l'armée française... Il faut bien plutôt penser qu'il prêchait des convertis... (Le colonel de Grandmaison, parti le 2 août 1914 à la tête d'un régiment, commandait dès janvier 1915 un corps d'armée : performance inégalée. Il ne s'en serait sans doute pas tenu là s'il n'avait été tué deux mois plus tard... et n'aurait pu servir de bouc émissaire).
(5) On arrivait capitaine à l'ancienneté vers 45 ans, chef de bataillon vers 52, colonel au choix ancien vers 57.
Le fantassin était bien muni d'une pelle-bêche ou d'une pelle-pioche mais il n'avait guère l'occasion de s'en servir, car il était exclu de détériorer le terrain d'exercices - et encore moins les champs. On ne pouvait que rappeler de temps en temps l'utilité des trous de tirailleurs dans la mesure où ils ne retarderaient pas l'avance... La défense et l'organisation d'une position ne figuraient guère dans les programmes.
L'attaque droit devant soi jusqu'à l'assaut était inculquée jusqu'au réflexe. L'utilisation du terrain pour progresser à l'abri des vues, tourner les résistances, s'infiltrer dans le dispositif adverse, était en revanche peu pratiquée et pour cause : on aurait endommagé les cultures... Et si, dans la marche en avant, l'ennemi apparaissait, il ne pouvait être question de s'arrêter pour le stopper par le feu, mais bien de lui courir sus.
L'armée allemande pâtissait sans doute, elle aussi, des inconvénients de la vie en garnison mais elle disposait d'un grand camp de division pour chacun de ses vingt-deux corps d'armée, ce qui permettait à son infanterie de manœuvrer plus fréquemment en terrain varié et en liaison avec l'artillerie. La puissance du feu d'infanterie et des mitrailleuses contre une troupe en mouvement y était appréciée à sa juste valeur, une plus large part était faite à l'organisation défensive d'une position, et une grande initiative était laissée aux chefs des petites unités pour une meilleure utilisation du terrain dans l'offensive.
Cette différence de formation, s'ajoutant à une différence de tempérament évidente, devait fatalement aboutir, le moment venu, à une différence de comportement redoutable pour l'infanterie française. Nous devions en avoir personnellement la révélation le 19 août 1914, à la droite de la seconde bataille de Mulhouse, où notre magnifique régiment lancé aveuglément à la baïonnette, drapeau flottant, fut massacré par le feu de deux bataillons badois qui s'étaient solidement accrochés au terrain à l'apparition des premiers Français. Après quoi ces badois eurent beau jeu à reprendre leur attaque...
Les deux cavaleries offraient le même contraste. La française, admirablement encadrée, participait à la mystique de toute l'armée. Son rêve, son but, son ardent désir, c'était d'affronter à cheval la cavalerie allemande, de la défaire au sabre et à la lance en des charges au grand galop. Elle s'entraînait en conséquence. Symbole de cette nostalgie des grandes rencontres du passé, nos douze régiments de cuirassiers, parfaitement anachroniques, dont les rassemblements devaient attirer si bien les obus, au grand déplaisir des fantassins voisins. Mais de tels affrontements présupposaient un consentement mutuel ; or la cavalerie allemande trouvait plus expédient, pour arrêter les cavaliers français, de les attendre à pied, d'user de la carabine, voire de la mitrailleuse et, pour rechercher des renseignements, de s'avancer dans les vides et d'éviter le combat...
Quant à l'artillerie, indépendamment de la question du matériel déjà évoquée, il n'est pas douteux que la française, dont une grande partie des officiers de batterie et la totalité du commandement supérieur provenait de Polytechnique, bénéficiait d'un encadrement qui ne pouvait guère être surclassé.
LES GENERAUX
Le handicap que devait supporter l'armée française du fait de l'irréalisme de sa doctrine aurait pu être annulé par la qualité de son haut commandement - entendons son corps d'officiers généraux. Or il était permis de douter qu'il en fut ainsi. Certes il comptait beaucoup de chefs éminents tant par leur culture militaire que par leur autorité morale et leur force de caractère ; nombre d'entre eux, en particulier, avaient fait leurs preuves d'hommes de guerre dans les campagnes coloniales - Tonkin, Madagascar, Soudan, Maroc... - ce dont aucun général allemand ne pouvait se prévaloir. Mais ce n'était un secret pour personne, depuis le début du siècle les promotions d'officiers généraux, arrêtées en dernière analyse par le pouvoir politique, avaient été souvent motivées, en dehors de toutes considérations militaires, par des recommandations d'ordre électoral, voire idéologique. Ces errements s'étaient raréfiés, il est vrai, depuis la désignation du général Joffre comme vice-président du Conseil Supérieur de la Guerre et chef d'état-major général. Il avait procédé récemment à l'élimination de deux ou trois commandants de Corps d'armée, évidemment incapables mais ce n'était là, dans sa pensée, qu'un début...
Le haut commandement allemand n'avait pas eu à pâtir de mœurs aussi fâcheuses. Le choix des officiers généraux y dépendait exclusivement de l'Empereur, qui ne se serait permis qu'exceptionnellement d'aller à l'encontre des avis de son Grand Etat-Major.
Par ailleurs, l'état-major français avait prévu le rappel à l'activité, et l'affectation à la tête de grandes unités, d'un certain nombre d'officiers généraux passés depuis plusieurs années au cadre de réserve, choisis certes en raison de leurs anciens services, mais parfois physiquement affaiblis et intellectuellement dépassés. A titre d'exemple, la plus forte division active avait été confiée à un général âgé de 68 ans.
LES COMMANDANTS EN CHEF
Dans l'évaluation du potentiel des deux armées, il convenait évidemment d'accorder un coefficient particulièrement élevé à la personnalité des commandants en chef.
Helmut von Moltke, chef d'état-major général de l'Empereur, mais pratiquement commandant en chef de l'armée allemande, neveu du grand Moltke, était âgé de 70 ans. C'était un homme de stature vigoureuse, d'une physionomie calme et sans éclat. Il avait combattu en 1870 et, tant dans l'infanterie qu'au grand état-major, ne s'était jamais occupé que de tactique et de stratégie. Il était chef d'état-major général depuis l'automne 1905. Quand l'Empereur l'avait désigné, il avait été effrayé et s'en était ouvert au chancelier d'Empire, le prince Bülow. « Une voix intérieure, lui avait-il confié, lui répétait qu'il n'était pas l'homme qu'il fallait pour ce poste. Il se trouvait trop réfléchi, trop scrupuleux. Il n'avait pas le goût du risque, sans lequel, d'après Clausewitz, un général sera toujours en perte sur le grand livre de l'Histoire... ». Et il avait supplié Bülaw d'user de son influence sur l'Empereur pour le détourner de son choix. Mais l'Empereur n'avait pas écouté Bülow. « C'était, écrira plus tard Bülow, un philosophe, enclin au mysticisme. Sa femme s'était occupée de fantasmagories spirites et l'avait contaminé... » (6).
Joseph-Césaire Joffre, le généralissime français, avait 62 ans. Lourd, affligé d'embonpoint, la physionomie sereine, le cheveu blanc, la moustache épaisse et le regard très clair, il n'avait guère l'allure guerrière. Polytechnicien d'origine, il s'était toujours montré pondéré, calculateur, concentré, silencieux, peu imaginatif, inaccessible à l'émotion, lent à se décider mais imperturbable dans la poursuite de ses desseins Officier du génie, jusqu'au grade de général de division il s'était surtout occupé de constructions de casernes, de fortifications ou de chemins de fer, tant en France qu'aux colonies, ne s'était soucié de tactique ni de stratégie et n'était pas même passé par l'Ecole de Guerre. Cependant, chef de bataillon au Soudan, il avait manifesté à la tête d'une colonne, dans des circonstances difficiles, voire dramatiques, une vigueur à toute épreuve. Nommé au Conseil Supérieur de la Guerre il avait été chargé de la Direction des Arrières en cas de guerre. Lorsque le ministre, en 1911, sur l'avis d'autres membres du Conseil, l'avait pressenti pour le commandement suprême, il n'avait demandé qu'une journée de réflexion avant d'apporter sa réponse affirmative. Au printemps 1912, évoquant avec un de ses officiers l'éventualité de la guerre : « Nous l'aurons, lui avait-il dit ; je la ferai et je la gagnerai. J'ai toujours réussi dans ce que j'ai fait, comme au Soudan. Il en sera encore ainsi. »« Alors, mon général, avait reparti son compagnon, ce sera pour vous le bâton de maréchal ? » - « Mais oui, avait-il répondu avec simplicité » (7).
Il connaissait les lacunes de sa formation mais savait s'entourer, susciter les idées, écouter et, confiant en son jugement, décider sans retour, Il allait se trouver, dans son commandement en chef, doté d'une autorité absolue sur ses subordonnés, totalement indépendant du pouvoir politique et pratiquement maître du destin de la France. Il savait ce qu'elle attendait de lui et n'en était pas ému.
Moltke, en regard, ne serait jamais, en droit, que le chef d'état-major de l'Empereur, lequel pourrait à tout moment intervenir dans ses décisions. C'est l'Empereur et non lui qui avait choisi les commandants d'armée. Il n'avait pas, à leur égard - (et particulièrement à l'égard des dynastes : le kronprinz impérial, le kronprinz de Bavière, le duc de Wurtemberg) les coudées complètement franches. Sa situation était ambiguë, mais ses scrupules en étaient atténués : il n'allait pas chercher à la clarifier.
(6) « Mémoires du chancelier prince de Bü1ow », t. II et III.
(7) Général Alexandre « D'Agadie à Verdun ».
LES PLANS DE CAMPAGNE
Restait à faire entrer en ligne de compte les plans de campagne, d'ores et déjà arrêtés.
Le plan allemand avait été conçu par le feld-maréchal von Schlieffen, le prédécesseur de Moltke. Celui-ci l'avait adopté mais il n'en était pas le père, il n'y était pas viscéralement attaché. Dans son horreur du risque, il l'avait quelque peu « délayé », il en avait cependant conservé l'économie générale. Tel quel, il restait d'une simplicité et d'une vigueur impressionnantes. Le but à atteindre et la stratégie arrêtée à cette fin y étaient définis avec une parfaite clarté, de la façon la plus concrète, ne laissant place à aucune incertitude. Tandis qu'un quart seulement des forces - 2 armées sur 7, soit 16 divisions sur 68 - contiendraient les Français par une stratégie défensive, entre la région de Metz et le Rhin, le gros de l'armée allemande - 5 armées, 52 divisions - pivotant par sa gauche autour de la région fortifiée de Metz-Thionville, exécuterait un vaste mouvement de rabattement s'étendant à droite jusqu'à la mer à travers toute la Belgique, de façon à déborder finalement Paris par l'ouest et par le sud et à refouler les armées françaises, coupées de leurs bases, vers la frontière suisse. La gauche française, dont on savait qu'elle ne s'étendrait guère au-delà de Sedan, surprise par la violation inattendue de l'intégralité de la Belgique, serait tournée d'entrée de jeu.
Le plan français, pour autant qu'il y avait un plan français, était moins convaincant. Le général Joffre avait une intention bien arrêtée : saisir l'initiative et prendre l'offensive « toutes forces réunies », sans autre visée, au fond, que de décontenancer l'ennemi par la soudaineté et la violence du choc et de prendre d'emblée l'ascendant moral, première condition de la victoire. Or, pratiquement, l'armée française ne pouvait prendre l'offensive que dans trois secteurs : entre la région fortifiée de Metz et les Vosges, en haute-Alsace, et à l'ouest de la région fortifiée de Metz. Encore, dans ce dernier secteur, les conditions de l'offensive différeraient-elles, selon que les forces allemandes (dont on savait qu'elles violeraient le Luxembourg et la Belgique ardennaise, sans croire qu'elles pourraient dépasser le sillon Meuse-Sambre), s'étendraient plus ou moins vers l'ouest ; si bien que, de ce côté du moins l'initiative souhaitée était exclue.
On attaquera donc dans les trois secteurs.
Sur 60 divisions engagés (46 DIA et 14 DIR) : 24 opéreront en Lorraine orientale et haute-Alsace ; 30 opéreront à l'ouest de la région fortifiée Metz-Thionville ; 6 DIR seront maintenues en observation devant les débouchés sud-est, sud et ouest de la région fortifiée de Metz.
L'offensive « toutes forces réunies » se résolverait donc pratiquement en un jeu de trois offensives séparées dans l'espace et dans le temps. Or celle de gauche, avec 30 divisions (dont 5 DIR considérées comme initialement inaptes à l'offensive et affectées en conséquence à des missions de couverture), allait se trouver affrontée à la totalité de la masse offensive allemande, soit à 52 divisions. Vingt de celles-ci, il est vrai, seront des divisions de réserve, mais le commandement allemand, à l'insu des Français, avait décidé de les employer offensivement, tout comme ses divisions actives. La disproportion était flagrante...
CONCLUSION
En nombre de divisions, l'armée de campagne allemande avait une supériorité de 7 % environ. Cette supériorité était portée à près de 50 % quant au nombre de divisions à capacité offensive du fait que, contrairement au commandement français, le commandement allemand comptait comme telles ses divisions de réserve.
Elle avait une supériorité incontestable en artillerie lourde, peut-être compensée en partie par la supériorité technique et opérationnelle de l'artillerie de campagne française.
Contrairement à l'armée allemande, l'armée française était affligée d'une doctrine irréaliste et aventureuse qui avait fâcheusement affecté son commandement et son instruction.
Si toutes deux comptaient un certain nombre de généraux inférieurs à leurs fonctions, il y avait des raisons de penser que l'armée française était défavorisée à cet égard.
Le plan d'opérations allemand était incontestablement supérieur et semblait conduire, à moins de fautes lourdes dans l'exécution, presque mécaniquement au succès.
En revanche, Joffre dominait de haut Moltke par sa force de caractère et sa confiance en soi. Mais cet atout majeur suffirait-il aux Français pour racheter leurs faiblesses ?
En vérité, pour qui aurait pu lire dans les deux jeux, la partie semblait devoir s'engager défavorablement pour le camp français. Mais les Allemands étaient pressés. Il leur fallait régler l'affaire avec la France avant que la puissance russe se manifestât dangereusement aux frontières orientales. Les Français avaient le temps pour eux.
En cas de revers initiaux, pourraient-ils, sauraient-ils, en tirer victorieusement parti ?
Général Jacques HUMBERT
| Haut de page |
N° 373 - Décembre 1983
L'ACTION EXEMPLAIRE DE LOUISE DE BETTIGNIES ET DE LEONIE VANHOUTTE (1)
Les combats dans lesquels les femmes ont pris part, sous la forme d'unités constituées, sont rares dans l'histoire bien que quelques exemples fameux soient présents dans toutes les mémoires.
La reine des Amazones, conduisant devant Troie « l'escadron royal à la tuerie » et les eaux du Thermodon charriant les cadavres tandis que s'enfuyaient au loin « les étalons blancs rouges du sang des vierges ».
Ou ces guerrières que Francisco Orellana llana prétendit avoir vaincues en 1539 vers les sources du fleuve de l'Amérique Sud qui fut pour cela appelé Amazone.
Ce n'est pas pour autant que les femmes n'ont pas pris souvent une part active à la guerre. L'histoire cite le nom de plusieurs héroïnes qui n'ont pas craint de se joindre aux guerriers et de partager leurs périls et leur gloire : Jeanne Hachette, Marguerite d'Anjou, Jeanne d'Arc.
Sans atteindre la grandeur épique de ces héroïnes, quelques femmes n'ont pas hésité à participer à la lutte contre l'envahisseur, sans arme, mais avec un courage d'autant plus grand qu'il était plus obscur.
C'est le souvenir, bien effacé aujourd'hui, de deux de ces Françaises que nous voudrions faire revivre ; le souvenir de deux jeunes filles qui, voilà bientôt 70 ans, pendant que leurs frères se battaient sur les fronts de Champagne ou d'Artois, luttaient à leur manière dans la recherche de renseignements qui furent si profitables aux Alliés. Leur patriotisme ardent les a conduites jusqu'au calvaire des geôles de l'envahisseur et même pour l'une d'elles jusqu'à la mort.
C'est donc un hommage à la fois aux combattants de 14-18, et aux femmes, que souhaitent être ces quelques pages dans lesquelles nous présentons les combats de Louise de Bettignies et de son lieutenant Marie-Léonie Vanhoutte.
(1) L'essentiel de la documentation concernant cet article a été pris dans le livre d'Antoine Redier « La guerre des femmes ».
LES PERSONNAGES
Louise de Bettignies était née le 15 juillet 1880 d'une famille de bonne noblesse du nord de la France. Son père dirigeait une fabrique de faïence et de porcelaine mais, dès 1877, il avait dû renoncer à son industrie.
Sa mère, sentant les difficultés qu'aurait sa fille à s'établir, car l'éducation de huit enfants n'était point chose aisée, voulut donner à Louise une forte instruction.
Cette dernière passa donc deux grandes années à l'université d'Oxford.
A la mort de son père, et pour ne plus être à la charge de sa mère, elle partit en Italie comme dame de compagnie dans la grande famille milanaise des Visconti. Elle y passa de très nombreux mois, puis, pour achever sa formation, elle s'orienta vers les langues germaniques en Pologne d'abord, chez le comte Mikiesky où, pendant un an, elle prit contact avec l'aristocratie autrichienne, puis en Bohême, chez le prince Schwarzenberg Worletz où elle resta 18 mois.
Il est probable qu'elle connut vers cette époque un grand amour malheureux dont d'ailleurs elle ne parlait jamais. Sa foi chrétienne faillit alors sombrer mais, résignée sinon consolée, elle domina sa peine et, au moment où vont commencer ses activités patriotiques, elle envisageait sérieusement de se retirer au carmel.
Nous retiendrons de cette brève esquisse de sa vie que Louise de Bettignies, par ses relations dans l'aristocratie européenne et son ouverture d'esprit, comme par ses connaissances en langues étrangères dont elle parlait couramment les quatre plus importantes de son époque, paraissait presque prédisposée au rôle qu'elle allait jouer.
Donc notre héroïne se trouvait, en octobre 1914, à Lille dans la maison familiale. Sa mère en était absente à cette époque. Elle y resta quelques jours, mais son ardent patriotisme souffrait trop de cette présence de l'occupant et elle résolut de rejoindre la France libre.
Le hasard voulu qu'elle trouvât une filière d'évasion par la Hollande - dont la neutralité n'avait pas été violée - qui la conduisit en Angleterre avant son rapatriement en France.
C'est en débarquant ainsi à Folkstone que se joua son destin.
En effet, Belges et Français qui, très nombreux, fuyaient l'occupant par cette voie, étaient naturellement à leur arrivée longuement interrogés par les autorités britanniques, peu soucieuses de laisser ainsi s'infiltrer chez eux d'éventuels espions.
Au cours de l'interrogatoire que Louise subit de leur part, ses hôtes furent frappés de la précision et de l'importance des renseignements qu'elle leur donnait. Comme ils s'en étonnaient, elle leur apprit que, non contente de parler l'anglais comme ils pouvaient le constater, elle parlait aussi avec la même aisance l'allemand.
Ayant appris qu'elle envisageait de rejoindre sa mère à Saint-Omer où se trouvait à l'époque le grand quartier général britannique, un général de l'Intelligence Service lui demanda si elle accepterait, dès son retour en France, d'être présentée au maréchal French. Il lui confirmerait la requête à elle présentée à Folkestone de faire la navette entre Lille et l'Angleterre pour rapporter régulièrement des renseignements comme ceux qu'elle venait de leur donner.
Louise demanda naturellement à réfléchir, revint en France, fit part à sa mère déchirée mais consentante de ces terribles perspectives, prit conseil d'un prêtre en qui elle avait une grande confiance, puis eut une entrevue avec le chef de l'armée britannique en France. Enfin, elle prit contact avec le grand quartier général français car elle eût préféré s'enrôler sous notre drapeau, aussi bien par sentiment que pour des facilités de compréhension car, bien qu'elle parlât parfaitement l'anglais, sa tournure d'esprit était naturellement plus orientée vers le mode de penser français que vers celui de nos alliés. Des facilités de crédits et surtout la conviction que les Anglais, luttant sur une terre française contre un ennemi allemand avaient encore plus besoin de son aide que ses compatriotes, emportèrent sa décision.
Elle opta donc pour l'Intelligence Service et tout de suite on lui confia un rôle de chef : étendre sur toute la région lilloise un vaste réseau d'observateurs, centraliser les renseignements recueillis et les faire parvenir en Angleterre.
C'est ainsi que, par une froide journée de février 1915, Louise de Bettignies revint à Lille dans sa maison et Alice Dubois, ce fut le nom de guerre qu'elle adopta, commença son travail.
Bien vite elle comprit qu'elle n'y pourrait suffire seule car les distances étaient grandes entre le front allemand, la frontière maritime, Folkestone. Il lui fallait un lieutenant.
À peu de temps de là, au cours d'une entrevue près de Roubaix avec divers notables, Louise de Bettignies rencontra une jeune fille, Marie-Léonie Vanhoutte. Le destin venait de rapprocher ces deux femmes qui, jusqu'à la prison et à la mort de l'une d'elles, allaient sans faiblir lutter ensemble.
Au moment de la déclaration du guerre, Léonie Vanhoutte, une Roubaisienne, suivait depuis quelques semaines un stage d'infirmière à la Croix Rouge et le début des hostilités se passa pour elle, à Lille, à soigner les blessés belges ou français qui refluaient vers le sud.
Quand vint l'occupation allemande, notre héroïne ne voulut plus assurer cette tâche et retourna à Roubaix en conservant toutefois deux objets qui lui furent bien utiles plus tard : sa carte d'infirmière et son brassard de la Croix-Rouge.
En octobre 1914, son frère est bloqué à la frontière. Il veut fuir l'envahisseur, mais comment atteindre l'Angleterre ? Léonie se renseigne, trouve une filière et, après un voyage mouvementé, réussit à faire passer en Hollande puis en Angleterre son frère et trois autres compagnons.
Revenant à Roubaix, elle rencontre à Flessingue un agent du gouvernement belge qui, surpris de l'audace de cette jeune fille, l'incite vivement à mettre l'expérience qu'elle vient d'acquérir au service des Alliés. La perspective de servir son pays plaît à cette âme forte. Revenue chez elle, elle n'hésita pas, quelque temps après, à refaire un voyage analogue avec trois autres jeunes hommes cherchant à rejoindre l'armée alliée.
C'est au retour de ce voyage que le hasard la mit en présence de Louise de Bettignies. Conquise par le rayonnement et l'enthousiasme de son aînée, elle accepta d'entrer dans son équipe. Ses parents, déchirés mais conscients de la grandeur de la tâche à accomplir, acquiescèrent à son départ et « Charlotte », ce fut son nom de guerre, devint le lieutenant d'« Alice ».
Si ces deux femmes constituèrent la tête de l'équipe, elles eurent de nombreux collaborateurs, les uns d'origine très modeste, comme Victor Viaene, alias Albert, qui deux fois par semaine faisait à pied le chemin de Bruxelles à la frontière hollandaise pour porter les précieux renseignements recueillis, ou Isidore Van Vlaenderen qui la première fois fit passer à Louise de Bettignies la frontière vers la Hollande (plus tard, il fut pris par les Allemands et fusillé le 12 septembre 1917), ou Léonie Rameloo ou Emilie Schlattemann, toutes deux également fusillées à cette époque et les sœurs Doutreligne qui, arrêtées furent aussi des compagnes de captivité de Louise.
LEUR ACTION
En fait, les renseignements que Louise de Bettignies avait à transmettre aux Anglais étaient de deux sortes. Il s'agissait d'abord de surveiller les déplacements de l'ennemi et, pour cela, elle eut auprès des ponts, des passages à niveau, des grands carrefours, des personnes qui constamment notaient les trains, leur nombre, leur importance. Ainsi par exemple, en mai 1918 Foch sut-il que, venant du Mont Kemmel, un grand nombre de trains de blessés refluaient vers l'intérieur. Cette partie du front était donc dégarnie et le généralissime put ainsi déplacer ses troupes vers le sud pour l'assaut final du mois de juillet.
Louise sut ainsi recruter des dizaines d'agents, des chemins de fer pour la plupart, qui, grâce à son habileté, ne furent jamais inquiétés.
Mais, à côté de ces personnels modestes, Louise de Bettignies s'était assurée la collaboration de personnes plus capables d'apprécier les mouvements de l'ennemi à proximité immédiate du front et par suite de connaître ses desseins. Il s'agissait souvent de personnalités importantes, instruites et pouvant circuler librement.
Elles venaient à Lille plusieurs fois par semaine, par exemple à l'occasion des marchés, passaient discrètement rue de l'Isly où Louise recevait leurs rapports, en faisait une synthèse que d'habiles calligraphes recopiaient sur de minuscules morceaux de papier. Souvent même, pour éviter toute surprise, Louise n'écrivait ces rapports que passée en Hollande ou même donnait verbalement les informations en arrivant à Folkestone.
Un détail pittoresque montre l'habileté de ces femmes au grand cœur.
Lorsque Louise fut arrêtée, comme nous le verrons plus loin, elle confia à deux dames de Mouscron le soin d'apporter la triste nouvelle à des amis en France, ainsi que de précieux renseignements qu'elle n'avait pu écrire pour l'état-major.
Ces braves personnes, conscientes de l'importance de leur tâche, mais inquiètes de la fidélité de leur mémoire, sortirent leur chapelet et, dans le train qui les transportait, murmurèrent sans trêve, non les dizaines de la prière, mais les phrases qu'on leur avait confiées.
Louise réussit au printemps 1915 à remettre aux Anglais un plan directeur quadrillé de tout son secteur. Elle put désormais, à l'aide de quelques chiffres, indiquer les positions notamment des batteries d'artillerie de la région de Lille qui, par trois fois en ces quelques mois, furent complètement détruites.
Il s'agissait enfin de trouver les agents assurant le passage des personnes, mais aussi des fonds, des journaux et même du détecteur pour le poste de TSF, que réclamait une telle organisation.
Notre héroïne réussissait si bien que ses chefs anglais avaient pour elle une immense admiration « presque religieuse ». Ils l'ont prouvée plus tard.
LE DRAME
Hélas, l'héroïque action de Louise de Bettignies et de son lieutenant Marie Léonie Vanhoutte ne dura pas très longtemps. Cette dernière fut la première victime.
Le 23 septembre 1915 on confia à Charlotte un pli important à transmettre à Alice Dubois. Elle se sent surveillée, tente de différer le voyage, mais sur l'insistance du demandeur accepte d'aller le porter jusqu'à Bruxelles.
L'opération se passe bien. Elle remet son courrier et reçoit un manuscrit pour Tourcoing. Toutefois, dans la maison où elle est descendue, une lettre mystérieuse la convie à un rendez-vous étrange. Elle a immédiatement le pressentiment que cette missive provient de la police allemande, mais son entourage, ne sentant pas le danger, l'encourage à se rendre au lieu indiqué. Aux deux hommes qui l'accueillent au nom d'Alice, elle explique qu'elle voulait passer en Hollande pour rejoindre son fiancé. Ils font semblant de la croire, lui fixent un nouveau rendez-vous pour le lendemain 11 heures. Mais, comme elle a eu l'imprudence de revenir se reposer dans la maison amie qui l'avait accueillie, les policiers, à 5 heures du matin, font irruption dans sa chambre et l'emmènent à la prison Saint-Gilles où elle est enfermée dans une cellule d'ailleurs d'une irréprochable propreté.
Son premier soin est d'avaler le minuscule message qu'on lui avait confié, puis commence sa vie de prisonnière.
Quelques jours après son arrestation eut lieu le premier interrogatoire au cours duquel elle soutint son intention de se rendre auprès de son fiancé. Au moment de quitter la salle, elle remarqua son sac contenant ses affaires personnelles. On refusa de le lui rendre, mais tout de même on lui donna son chapelet dans son étui de cuir. Cet étui contenait le code de passage et la liste des personnes à contacter. Heureusement, ses geôliers ne s'aperçurent de rien et rentrée dans sa cellule Léonie s'empressa de faire disparaître ces documents si compromettants.
Léonie Vanhoutte constata bien vite que la police n'avait aucune charge sérieuse contre elle. En vain la promena-t-on dans Bruxelles pour voir si quelqu'un de son équipe se manifesterait. Aucun élément ne vint confirmer les soupçons allemands. Ce que voyant, ceux-ci la transférèrent à Anvers.
Cette prison, tenue par des religieuses, était plus rigoureuse que celle de Bruxelles et elle dut subir de nombreux interrogatoires, mais, ferme dans sa première déposition, elle n'apporta aucun renseignement aux enquêteurs qui finalement lui dirent qu'elle serait seulement condamnée pour tentative de passage de la frontière, sans doute à trois mois de prison.
Le malheur voulut que, sur ces entrefaites, Louise de Bettignies fut arrêtée. La veille de sa comparution devant le tribunal on présenta à Léonie une photo d'Alice Dubois. Elle nia naturellement connaître cette jeune femme, mais l'enquêteur la fit pourtant immédiatement transférer à Bruxelles. Elle sentit alors qu'elle était perdue.
Pendant que son lieutenant était ainsi arrêté, Louise de Bettignies, qui avait appris quelques jours après cette arrestation, connut des heures difficiles. Justement à cette période, ses responsabilités s'accroissaient.
Les liaisons par la Hollande devenant de plus en plus difficiles, elle s'orienta vers des liaisons par air : TSF ou pigeons voyageurs, et toujours les importants voyages à Folkestone.
Un jour qu'elle tentait de passer en Belgique, elle fut arrêtée avec quelques compagnons par la police allemande de Tournai. Ses compagnons furent relâchés mais Louise, qu'un soldat avait vu avaler un papier, fut retenue par le chef Rotselaer.
On la conduisit rapidement à Lille chez la famille de Geyter qu'elle venait de quitter et qui réussit à nier connaître Louise. La perquisition faite chez eux n'apporta aux policiers aucun renseignement mais Louise fut conduite à la prison Saint-Gilles qu'avait connue « Charlotte ».
Dans cette prison relativement accueillante, elle dut répondre aux interrogatoires répétés de l'instructeur, un nommé Goldschmidt. S'il savait que sa captive s'appelait Louise de Bettignies, il semble qu'il ne sût jamais qu'Alice Dubois et elle étaient la même personne puisque le 5 mai 1916, soit de nombreux mois après l'arrestation, il demandait encore à un détenu, qui était cette « Alice ». Cependant, les enquêteurs furent amenés à penser que celle-ci était peut-être Léonie Vanhoutte qu'ils détenaient à Anvers et ils la firent venir à Bruxelles.
La confrontation entre ces jeunes filles n'eut aucun résultat, toutes deux s'accordant pour affirmer qu'elles ne se connaissaient pas.
Alors les policiers usèrent d'un stratagème. Ils mirent avec Louise de Bettignies, dans sa cellule, une femme, Mme Lardrière, qui avait été condamnée quelques mois auparavant à une peine de prison dans l'affaire de Miss Cavell. Elle gagna peu à peu la confiance de Louise, incapable d'imaginer la fourberie de cette femme. Ainsi, sur les indications de Lardrière, elle parla par le truchement d'un tuyau de chauffage central à Charlotte qu'on avait placée volontairement dans une cellule voisine, puis se confia totalement à cette femme qui naturellement rapporta fidèlement ses paroles à Goldschmidt. Elle obtint même de la pauvre Louise quelques mots pour Charlotte. Cette Mme Lardrière (Louise Tellier) se suicida peu de temps après l'armistice.
Confrontées à nouveau, Louise et Léonie durent admettre qu'elles se connaissaient et tombèrent dans les bras l'une de l'autre.
Les interrogatoires continuèrent, les enquêteurs cherchant à faire avouer l'une en prétendant que l'autre l'avait fait. Ils eurent peu de résultats. Notamment leurs geôliers crurent toujours qu'ils ne tenaient que des comparses et l'affaire fut renvoyée devant le conseil de guerre. La séance fut fixée au 16 mars 1916.
Ce que put être l'attente de nos deux héroïnes, on peut l'imaginer après ce qu'elles avaient vécu 15 jours auparavant.
Le 5 mars 1916, en effet, ce conseil avait jugé Gabrielle Petit. Personne ne connaissait le verdict quand, à l'heure de la promenade, un chant qui était presque un cri emplit le ciel :« Salut, ô mon dernier matin ». Les détenues en entendant ce cri s'agenouillèrent.
Donc, le 16 mars au matin, on conduisit les deux jeunes femmes à la Salle du Sénat, à Bruxelles, où siégeait le conseil de guerre. Celui-ci était présidé par un général, mais le meneur de jeu était un juge civil, le conseiller Stœber, celui même du procès de Miss Cavell.
D'une tribune dominant la scène, le gouverneur von Bissing assista pendant plusieurs heures aux débats.
On interrogea d'abord quelques comparses. Puis vint le tour de Léonie Vanhoutte. Elle se défendit avec ardeur, avec cette ardeur que Gabrielle Petit morte pour la Belgique lui avait insufflée en lui parlant par les tuyaux de chauffage de sa prison.
Elle comprit que Stœber voulait sa perte mais bientôt Louise de Bettignies s'avança à la barre. On fit sortir Léonie. Il ne semble pas qu'un avocat belge ait été désigné pour défendre les accusées. S'il leur fut désigné un défenseur, il semble sûr qu'il n'eut aucun contact avec les détenues et donc que son rôle ait été nul.
Après deux suspensions d'audience, le verdict fut prononcé. La peine de mort pour Louise de Bettignies, Léonie Vanhoutte et un comparse.
Louise alors s'avança à la barre et, en allemand pour n'être pas comprise de Léonie, elle demanda la grâce de celle-ci. De son côté, Léonie, après la lecture de l'acte, demanda au tribunal la grâce pour Louise de Bettignies.
Elles passèrent ensemble le reste de la soirée, mais on né permit pas qu'elles restassent ensemble pour la nuit. « C'est la preuve qu'on ne vous fusillera pas demain » leur murmura un gardien : « dormez tranquilles ».
Le lendemain à 9 heures une voiture cellulaire conduisit les condamnées à la kommandantur. « Il y a du bon » leur chuchota un gardien.
Dans une petite pièce où se trouvaient tous les accusés de la veille, Stœber entra, puis solennellement déclara :
- Louise de Bettignies : peine requise, la mort ; peine prononcée, la mort.
- Léonie Vanhoutte : peine requise, la mort ; peine prononcée, 15 ans de travaux forcés. Il ajouta : le gouverneur général qui a assisté à l'audience va sans doute examiner le dossier de Bettignies avec indulgence.
Convaincue ainsi qu'elle ne serait pas exécutée immédiatement, Louise mit à profit le temps de répit pour réfléchir à son procès. Le 19 mars, elle écrivit à von Bissing pour lui demander la grâce de Léonie Vanhoutte et de tous les comparses. « Je mourrais contente, Excellence, si j'apprends que vous avez agréé ma demande et remis Mlle Vanhoutte... en liberté ».
Le 23 mars, on lui apprend que von Bissing a accordé sa grâce et que sa peine est commuée en une détention perpétuelle - ce mot la fit sourire, « jusqu'à la victoire de la France » dit-elle - en Allemagne.
Elle resta encore un mois à Saint-Gilles et les sœurs du Carmel auquel elle se destinait purent lui envoyer quelques douceurs. Ce qui la toucha le plus fut la visite d'une française, Mme Louise Robiliart qu'elle ne connaissait pas, mais qui vint lui apporter le salut d'une compatriote et glissa dans sa main un petit bouquet à nos trois couleurs.
Le vendredi saint, elle partit brusquement pour l'Allemagne, à Siegburg, près de Cologne.
Léonie Vanhoutte l'avait précédée dans cette prison. En effet le 24 mars, à sa sortie de Saint-Gilles, on fit monter Léonie dans le train pour l'Allemagne, escortée d'un officier et d'un soldat. Malgré une altercation avec un Allemand dans le wagon, le voyage ne fut pas désagréable car son escorte avait pitié de cette jeune fille. Ainsi, tard dans la soirée, elle arriva dans la prison.
Celle-ci était dirigée par Frau Rüge, la femme d'un ingénieur, fille d'un professeur notoire, personne distinguée et bien élevée. Elle avait une certaine considération pour les détenues qui appartenaient à l'aristocratie ou à la haute bourgeoisie mais se montrait assez méprisante pour ses plus humbles pensionnaires. Quoi qu'il en soit, rares sont celles qui l'ont détestée, on lui savait gré de son excellente éducation.
Par contre, car Siegburg avait deux prisons, une pour les hommes et une pour les femmes, régnait sur l'ensemble un individu grossier, Herr Dürr qui terrorisait tout le monde, aussi bien détenus que geôliers. Un autre personnage odieux était le docteur attaché aux établissements. On l'avait surnommé le docteur « Sortez » car au lieu d'écouter les patientes, dès qu'elles ouvraient la bouche, il leur criait « Sortez ».
Le typhus s'étant déclaré, ce furent des prisonnières, et tout particulièrement Léonie Vanhoutte, la petite infirmière, qui acceptèrent de soigner les malades, les gardiennes ayant peur. Elles furent même parfois contraintes de mettre les mortes dans leur cercueil et de transporter ce funèbre fardeau jusqu'au cimetière. Léonie Vanhoutte fut à son tour atteinte par cette terrible maladie, heureusement tardivement, et le 8 octobre 1918, elle fut libérée par les évadés français et belges de la prison des hommes et quelques soldats allemands annonçant que la République était proclamée.
Rentrée en France, elle se remit peu à peu et le 24 août 1919, la croix de guerre lui était décernée.
Ce n'est que 8 ans plus tard, le 27 février 1927, que le ministre André Tardieu, en présence de représentants du ministre de la guerre, du maréchal Pétain, et devant tout Roubaix en fête, remettait la Légion d'Honneur à Marie-Léonie Vanhoutte.
Le lieutenant avait survécu au drame, mais Louise de Bettignies n'eut pas cette chance.
Nous avons vu qu'elle avait quitté Bruxelles le vendredi Saint 1916. L'internement devait être particulièrement pénible à cette fille ardente et fière qui ne tolérait pas la grossièreté des geôliers. Malgré les conseils de prudence que lui donna la princesse de Croy, détenue comme elle, elle ne courba pas la tête.
Ainsi, les Allemands ayant émis la prétention de faire confectionner des enveloppes de tête de grenade par les prisonniers, Louise de Bettignies prit l'initiative de refuser ce travail de guerre. On la mit au cachot, mais on cessa la fabrication. Cependant, privée de tout vêtement chaud, des envois qu'on pouvait recevoir dans les cellules, elle avait pris mal. Longtemps après sa sortie de cachot, on lui refusait encore ses vêtements de laine. On les lui rendit à la fin de l'hiver, probablement sur une intervention de l'ambassade d'Espagne qu'on avait pu toucher. Mais la blessure était bien mortelle. Son état parut s'améliorer en 1917. Pourtant, dès les premiers froids de l'hiver 1917-1918, une glande apparut entre deux côtes : la pneumonie qu'elle avait contractée dégénérait en pleurésie purulente. L'opération s'imposait. Louise voulait qu'elle eût lieu dans des conditions correctes, à Cologne ou à Bonn et non pas sur place. Elle lutta contre Dürr tant qu'elle put, mais, affaiblie par la maladie, elle renonça et fut opérée à Siegburg le 18 avril dans de très mauvaises conditions. Elle parut pourtant un peu se remettre et pendant quelques jours, entourée de la compassion de ses compagnes et même de Frau Rüge, elle connut le calme d'une rémission, mais malgré les plus hautes interventions, les Allemands ne voulurent pas la transférer dans un hôpital sérieux. Ce n'est que plus tard, sachant qu'elle allait mourir, qu'ils acceptèrent enfin son transfert à Cologne. Le 24 juillet 1918, accompagnée en voiture par Fr. Rüge, elle quitta Siegburg. Le 17 septembre, elle s'éteignait dans cet hôpital Sainte-Marie où on l'avait transférée trop tard. Les sœurs, sentant bien que le corps de cette héroïne serait un jour réclamé, la mirent dans un double cercueil de chêne et de zinc et elle fut inhumée au cimetière de Bichendorf. Cinq personnes suivaient ce pauvre convoi, dont Fr. Rüge, avertie, qui arrivait directement de Siegburg.
Une simple croix de bois marquait sa tombe. Quand les Britanniques arrivèrent à Cologne, ils recherchèrent cette tombe et la fleurirent.
Sa mère ayant demandé que le corps lui fût remis, les autorités françaises et anglaises lui rendirent le 20 février 1920 un solennel hommage.
Le cercueil, recouvert d'un drap tricolore et porté par une prolonge d'artillerie traversa Cologne entre une haie de soldats présentant les armes. Un coussin portait les quatre médailles de la morte, la Légion d'Honneur, la croix de guerre française et britannique et la croix d'officier de l'Ordre de l'Empire britannique (O.B.E.).
À Lille, le 4 mars, ses compatriotes lui firent de magnifiques funérailles et le cardinal Charost, archevêque de Lille, prononça un émouvant panégyrique.
Louise de Bettignies repose parmi les siens dans le petit cimetière de Saint-Arnaud.
Les femmes aussi ont su faire la guerre.
LE « SOUVENIR FRANÇAIS »
| Haut de page |
N° 374 - Mars 1984
Le « Souvenir Français » tient à cœur de célébrer dans sa revue le soixante-dixième anniversaire de la guerre 1914-1918. Dans les générations nouvelles, nombreux sont ceux qui n'ont reçu, au cours de leurs études, qu'une connaissance superficielle de cette période décisive et glorieuse de notre histoire. C'est à leur intention surtout que nous tenterons, en quelques articles, de rappeler et d'en expliquer sommairement les principaux épisodes.
DE LA MOBILISATION A LA MARNE
(2 août - 5 septembre 1914)
I. - LE PREMIER ACTE
(2-23 août)
La mise en place des armées.
Dans un précédent article (N° 371, juin 1983) nous avons indiqué les intentions initiales des deux commandements en chef opposés et la répartition de leurs forces. De part et d'autre il fallut une douzaine de jours pour que celles-ci se mobilisent et se mettent en place. Ce fut chose faite le 13 août. A cette date, les armées allemandes (cinq armées numérotées de I à V de la droite à la gauche) qui devaient envelopper les armées françaises par la Belgique et les plaines du Nord étaient alignées face à l'ouest derrière la frontière orientale de la Belgique, tandis que le gros des forces françaises (IIIe, IVe et Ve Armées de la droite à la gauche) était réuni face au nord entre la région nord de Verdun et la région sud de Mézières. Ces deux dispositifs étaient séparés par toute l'épaisseur des Ardennes françaises et belges. Entre la région fortifiée de Metz et les Vosges, par contre, la gauche allemande (VIe et VIIe Armées) et la droite française (Ire et IIe Armées) étaient déployées face à face, à quelque trente kilomètres de distance, de part et d'autre de la frontière franco-allemande, celle-là se préparant à une bataille défensive, celle-ci à attaquer.
La bataille de Lorraine (14-22 août).
Le 14 août, le général Joffre découpla ses deux armées de droite (Ire et IIe). Elles entrèrent immédiatement en contact avec l'ennemi aux abords de la frontière entre les Vosges et les avancées de Nancy. Elles ne rencontrèrent d'abord qu'une faible résistance, mais une puissante artillerie lourde, que nos 75 ne pouvaient contrebattre, leur infligea d'emblée des pertes et freina leur élan. Leurs progrès se poursuivirent néanmoins pendant les trois jours suivants, l'ennemi semblant en retraite. Mais, le 19 au matin, alors que la IIe Armée reprenait son avance sur Morhange avec optimisme, elle se vit assaillie de front et sur son flanc gauche avec une extrême violence. Elle fléchit. Il fallut retraiter en hâte et parfois en grand désordre, d'autant que l'adversaire, enflammé par son succès, poussait vigoureusement. La Ire Armée, attaquée sur sa droite au débouché des Vosges, dut se conformer au mouvement de sa voisine mais le fit en bon ordre. L'ennemi nous avait attirés dans une nasse. Il n'était pas cependant assez fort pour transformer notre échec en une défaite décisive : le 22 août au soir, les deux armées françaises purent faire front et s'établir sur des positions favorables à une trentaine de kilomètres de la frontière, la gauche de la IIe Armée s'accrochant aux hauteurs qui couvrent Nancy.
Préparation de l'offensive principale (voir croquis n° 1).
À l'ouest de la région fortifiée de Metz le général Joffre était resté d'abord dans l'expectative. Il n'avait guère de doute sur le principe de la manœuvre d'enveloppement décidée par Moltke et il avait prévu que l'aile droite allemande, chargée de la réaliser, s'avancerait par le sillon Meuse-Sambre et la région découverte au nord des forêts ardennaises. Il lui paraissait probable que pour assurer à sa manœuvre le maximum de puissance, Moltke serait amené à faire des économies sur les forces qui flanqueraient l'aile marchante à travers les Ardennes, et il envisageait de profiter de leur faiblesse relative pour lancer contre elles, lorsque l'aile marchante se serait suffisamment enfoncée vers l'ouest, une attaque puissante qui les bousculerait et prendrait cette dernière à revers. Cette attaque déboucherait par surprise, droit au nord, de la ligne générale Longwy-Sedan, et serait menée par deux armées très fortes - les IIIe et IVe - tandis que la Ve et l'armée anglaise (deux corps d'armée), partant de la région Mons-Charleroi, se porteraient à la rencontre de l'aile marchante pour l'immobiliser. L'offensive préalable de Lorraine devait exercer, en faveur de cette entreprise, un bénéfique effet de diversion. Tout cela n'aurait rien eu que de raisonnable si l'hypothèse de base, à savoir l'évaluation des forces offensives ennemies avait été exacte. Malheureusement, nous l'avons dit, il n'en était rien, les Allemands, à l'insu et à l'inverse des Français, ayant groupé leurs divisions de réserve en corps d'armée pour les engager en première ligne. Dès le 15 août le général Joffre fut informé que deux armées comprenant sept corps franchissaient la Meuse à Liège et au nord de cette ville et s'avançaient à la fois par la plaine belge en direction de Bruxelles et par la vallée de la Meuse, tandis qu'une troisième marchait à leur hauteur sur la rive sud de ce fleuve. Ces trois armées formaient évidemment l'aile enveloppante. Elle s'étendait nettement plus au nord et était plus forte que prévu mais le général Joffre s'en félicita plutôt : les forces traversant les Ardennes en seraient affaiblies. Fixé dès lors sur la manœuvre ennemie il poussa, comme il l'avait envisagé, la Ve Armée (général Lanrezac) vers le sud de la Sambre pour opérer de concert avec l'armée anglaise qui se rassemblait vers Maubeuge, et il déploya ses IIIe et IVe Armées entre Longwy et Mézières, prêtes à l'attaque.
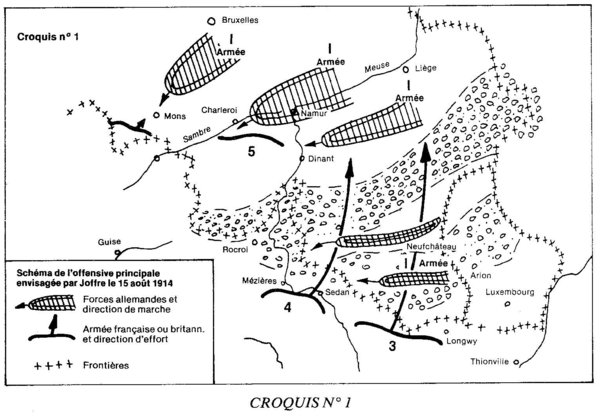
Le 20 août, l'aile droite allemande avait dépassé la ligne Bruxelles-Namur, tandis que, dans les Ardennes, des colonnes glissaient vers l'ouest à une trentaine de kilomètres de la frontière. Le général Joffre jugea le moment venu. Au matin du 21 il lança ses ordres : les IIIe et IVe Armées entameront immédiatement leur offensive ; la Ve et l'armée anglaise se porteront à la rencontre de l'aile droite ennemie pour la bloquer. « L'ennemi sera attaqué partout où on le rencontrera ».
La bataille des Ardennes (22-23 août).
Le 22 août au matin, sur tout le front des IIIe et IVe Armées, la bataille s'engagea. Partout nos troupes se trouvèrent aux prises avec des forces supérieures. Certaines se heurtèrent à un ennemi retranché, d'autres, en colonnes de route, en pleine forêt, furent assaillies sur leur flanc droit par des colonnes allemandes marchant vers l'ouest. Partout ce fut l'échec et, pour deux corps d'armée, une lourde défaite. Certaines divisions perdirent une partie de leur artillerie. Des milliers de prisonniers tombèrent aux mains de l'ennemi. Le soir de nombreuses unités désorganisées se ralliaient difficilement ; les autres, très éprouvées, étaient immobilisées ou en repli. Le 23 au soir, devant l'impossibilité de reprendre le mouvement en avant, les deux commandants d'armée décidaient la retraite sur les positions de départ.
La bataille de Charleroi (22-23 août).
Plus à gauche, le même jour, la Ve Armée, elle aussi, avait livré bataille. Le général Lanzerac, esprit indépendant, n'était pas un adepte des théories à la mode. Il avait établi, dès le 20 août trois de ses quatre corps d'armée sur les hauteurs de la rive sud de la Sambre entre l'ouest de Charleroi et Namur, tandis qu'un quatrième, aux ordres du général Franchet d'Esperey, le couvrait à droite sur la Meuse au sud de Namur. Il était décidé à briser sur cette position les attaques ennemies avant de se porter au-delà. Mais, pour ses subordonnés, se défendre c'était attaquer. Dès qu'au soir du 21 août l'ennemi apparut et se saisit des ponts de la Sambre, les divisionnaires des deux corps d'armée du centre lancèrent des bataillons pour les reprendre. Ils échouèrent. Le 22 à l'aube, contrairement aux ordres de Lanrezac, ces deux corps d'armée engagèrent toutes leurs forces dans les bas-fonds de la Sambre. Mal appuyés par le tir tendu de nos 75, pilonnés par les obusiers allemands, décimés par les mitrailleuses, nos régiments lancés à l'aveuglette refluèrent peu à peu. Au soir, le front de l'armée était ramené à dix kilomètres au sud de la Sambre.
Deux corps d'armée sur quatre étaient intacts. L'armée Lanrezac avait rempli sa mission, certes à trop grands frais.
L'ennemi (c'était la IIe Armée de von Bülow) n'avait pas suivi. Il avait lui aussi beaucoup souffert. Le 23 août il resta passif devant la Ve Armée dont les régiments éprouvés reprenaient cohésion et dont le moral n'était pas atteint. Dans l'après-midi, le général Lanrezac fut avisé que des éléments ennemis avaient passé la Meuse derrière sa droite dans la région de Dinant et que le corps d'armée Franchet d'Esperey s'employait à les rejeter. C'était l'avant-garde de la IIIe Armée allemande : que celle-ci franchisse la Meuse et la Ve armée serait prise à revers... Le soir, il apprit la retraite de nos deux armées du centre après leur échec cuisant de la veille. Sa droite était découverte. « Pour éviter un nouveau Sedan », il prit de lui-même une grande décision : il ordonna à son armée de battre en retraite pour se rétablir à une quinzaine de kilomètres en arrière. L'armée anglaise qui, plus à gauche, avait contenu tout le jour sur le canal de Mons les attaques de l'armée allemande d'extrême droite (Ire Armée de von Klück) et n'avait finalement reculé que de quatre kilomètres, ne l'apprit que tardivement. Elle ne pouvait que faire de même.
Malheureusement, le maréchal French, commandant l'armée anglaise, et le général Lanrezac n'étaient pas en confiance. Chacun ignorait la langue de l'autre et leurs personnalités étaient opposées. Entre le premier, d'éducation parfaite, tiré à quatre épingles, réservé, très soucieux de sa responsabilité vis-à-vis de son gouvernement, et le second, créole, corpulent, exubérant et peu préoccupé de son extérieur la sympathie n'avait pas jailli...
(24-31 août)
Première réaction de Joffre (24 août).
Le 24 août, au grand quartier général de Vitry-le-François, Joffre pouvait se faire un tableau d'ensemble. Son plan était anéanti ; toutes ses armées étaient en retraite ou réduites à une défensive problématique. A l'exception de deux divisions de réserve laissées à Paris et d'une, active, arrivant d'Afrique, toutes ses forces étaient engagées. Il connaissait maintenant les raisons de son échec : l'emploi inattendu en première ligne des corps d'armée de réserve allemands, nos procédés tactiques inadéquats, la déficience de nombreux généraux. Quel était alors son propre état moral ?
Incontestablement responsable de la bataille perdue, un autre aurait pu en être accablé et juger la partie pour le moins compromise. Son anxiété aurait pu se muer en désarroi, en agitation, au pire en irrésolution. Combien eût-on pu trouver de chefs assez forts pour conserver en une telle occurrence équilibre et maîtrise de soi ?
Le général Joffre resta pareil à lui-même, calme, silencieux, concentré, inaccessible à tout ressentiment, confiant dans les ressources du pays et du soldat français, certain de vaincre. Son rythme de vie ne fut pas troublé. Il visita tout à tour ses commandants d'armée en situation critique pour juger de leur moral et leur insuffler sa volonté. Et aussi infailliblement que le jour suit la nuit son calme et sa confiance s'épandirent sur toute l'échelle hiérarchique jusqu'aux plus bas échelons.
Au fond, l'échec, grave et coûteux, n'était pas un désastre, toutes nos armées restaient bien en mains et avaient pu se dégager de l'étreinte. Sous un chef de caractère, le général de Langle de Cary, la IVe se rétablissait derrière la Meuse en amont de Mézières ; la Ve retraitait spontanément, en bon ordre ; la IIIe était solidement étayée par le camp retranché de Verdun. Quant aux deux de Lorraine, non seulement elles contenaient l'ennemi mais elles s'apprêtaient à reprendre l'offensive et ne causaient plus de souci. Nous n'en parlerons plus.
Le 25 août, le général Joffre notifia ses premières décisions. Il comptait prendre du champ pour réorganiser son front de bataille puis reprendre l'offensive et il fixait comme ligne de rétablissement la ligne générale Amiens-Verdun, en vérité bien rapprochée. En vue de déborder la droite allemande le moment venu, il rassemblait sur la Somme, de part et d'autre d'Amiens, une nouvelle armée, la VIe, confiée au général Maunoury, constituée, pour commencer, d'un corps d'armée ramené d'Alsace et de quatre divisions de réserve tirées de Paris et de Lorraine : au total, une bien faible masse... Pour gagner du temps les IVe et Ve Armées auraient à freiner l'avance ennemie par des coups de boutoir vigoureux.
Le retrait des Anglais et la bataille de Guise (26-29 août).
Mais, dès le lendemain matin, Joffre fut inquiet pour son aile gauche. Le maréchal French, amertumé contre le général Lanrezac et ayant perdu confiance dans le commandement français, avait décidé de faire bande à part et se repliait à grande allure sans se soucier de la Ve Armée qui risquait, de son fait, d'être tournée par sa gauche. C'est à conjurer ce péril que Joffre, avec une activité inlassable, allait consacrer la plus grande partie des quatre journées suivantes.
Le 26, il est auprès de French, à Saint-Quentin. En vain essaye-t-il de le convaincre de ne pas lâcher Lanrezac et de rester en ligne. Le dissentiment est total : French entend se tenir à deux jours de marche en arrière. Le 27, à l'aube, dans l'espoir de réconforter French, il envoie à Lanrezac l'ordre de faire front le lendemain 28 et d'exécuter, à hauteur de Guise, une contrattaque vigoureuse, comme le fait, le jour même, de Langle de Cary sur la Meuse. Le 28, il est à Marle, au quartier général de Lanrezac, qu'il sait réticent et il lui confirme par écrit son ordre impératif. Le 29, il retourne auprès de lui, cette fois à Laon, pour s'assurer de l'exécution de son ordre : de fait, la Ve armée, ce jour-là, passe à l'attaque par sa droite. Le corps d'armée Franchet d'Esperey rejette brillamment deux corps de Bülow derrière l'Oise, en amont de Guise. En fin de l'après-midi, Joffre est à Compiègne, chez French. Il espère que ce succès va le déterminer à rester solidaire. Vain espoir, French est buté et pense à se retirer pour un temps de la lutte. Pendant cette journée, l'armée von Klück, dont Joffre avait sous-estimé la capacité de marche, a passé la Somme en amont d'Amiens et bousculé les premiers éléments, à peine débarqués, de la nouvelle VIe Armée. Le plan du 25 août est d'ores et déjà caduc. Il faut continuer la retraite... « On les aura tout de même » dit simplement Joffre à l'officier qui l'accompagnait...
La retraite.
Il faut continuer la retraite... Paris est maintenant directement menacé. Le général Gallieni, gouverneur militaire, doit en assurer la défense. Il est démuni : Joffre lui donne la VIe Armée, repliée de la Somme, un corps d'armée ramené de Lorraine et déjà en cours de transport, et la division algérienne qui débarque à Paris. Pour se soustraire au débordement qui la menace, la Ve Armée se rabattra vers le sud-est, en direction de Château-Thierry. Plus on reculera et plus les lignes de communication de l'ennemi s'allongeront à son détriment. Néanmoins, il faut bien se fixer une limite... Sur quelle ligne faire demi-tour pour bloquer l'ennemi, mettre les troupes en condition et reprendre l'offensive ? C'est le problème de Joffre dans les trois derniers jours d'août.
La retraite fut très pénible. Il fallait marcher sans cesse pour ne pas se laisser accrocher. Les routes étaient encombrées de réfugiés que l'on devait rejeter dans les champs. La résistance de l'infanterie fut à dure épreuve. Mais l'infanterie allemande n'était pas moins fatiguée et ne pouvait aller plus vite que la française, et les 75 de nos arrière-gardes suffisaient à la stopper. L'armature des armées ne se rompit pas. Grâce aux mesures prises en temps voulu par le commandant en chef, toutes les brèches furent aveuglées à temps.
Les décisions du commandement allemand du 20 au 30 août.
Qu'avait fait depuis le 20 août le commandement allemand ? Moltke n'avait initialement donné aux cinq armées d'attaque que des directions générales. Celle d'extrême droite (Ire de von Klück) devait marcher par Bruxelles, la IIe (von Bülow) par Namur, la IIIe (von Hausen) par Dinant. Les deux suivantes s'aligneraient en pivotant autour de la région nord de Verdun. Au-delà on agirait suivant les circonstances, dans l'esprit du plan. Jusqu'au 25 août, ç'avait été un triomphe. Prisonniers par dizaines de mille, canons par centaines. Tous les comptes rendus le proclamaient : partout l'ennemi était en fuite. A l'extrême droite, von Klück, par Cambrai, débordait l'armée anglaise. « Dans six semaines tout serait réglé à l'ouest ». Moltke était à Coblence, très loin de sa droite. Il ne pouvait se rendre dans la journée près de Klück ou de Bülow comme Joffre auprès de Lanrezac ou de de Langle. D'ailleurs il n'en éprouvait pas le besoin et préférait rester au bureau, près de l'empereur. Aucun problème ne se posait : il n'avait qu'à laisser faire ses commandants d'armée. Il ne cédait pas cependant à l'enthousiasme et dans ses lettres journalières à sa femme il s'affligeait des horreurs de la guerre. Plus que le déroulement des opérations en France l'inquiétait le front russe. Fidèle à ses conventions avec la France, le tsar avait aventureusement lancé dès le 14 août deux armées sur la Prusse orientale. L'état-major allemand, qui ne l'avait pas prévu, n'y en avait laissé qu'une. Violemment attaquée le 20 août elle avait dû retraiter. La panique avait gagné les populations. Moltke ne résista pas à leur appel et à l'irritation de l'empereur. La partie n'était-elle pas déjà gagnée à l'ouest ? Le 25 août, il décida d'embarquer immédiatement à destination de la Prusse orientale deux corps d'armée prélevés sur les armées de droite. Ils devaient faire gravement défaut quelques jours plus tard. Leur envoi s'avéra d'ailleurs inutile : avant leur arrivée, le nouveau commandant en chef en Prusse orientale, von Hindenburg, avait écrasé les deux armées russes. Le 27 août, Moltke crut devoir se manifester. Il lança une « Directive impériale pour la poursuite ». L'objectif de « l'armée allemande » y était défini sans ambages : Paris. La Ire Armée se portera sur la Seine, en aval de l'Oise, débordant largement de la capitale par l'ouest. La IIe marchera droit sur Paris. Les IIIe, IVe et Ve déborderont Paris par l'est en franchissant la Marne entre Château-Thierry et Vitry-le-François. Il n'était plus question du grand mouvement de rabattement. La bataille décisive était gagnée. C'était l'hallali (Voir croquis N° 2).
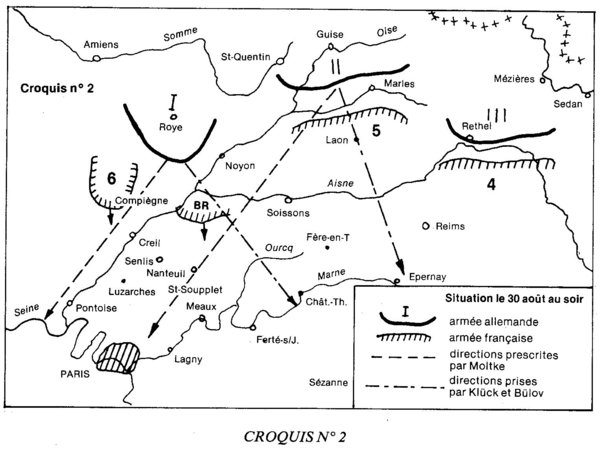
D'accord avec Bülow, il décida, le 30 août au soir, de n'en pas tenir compte et de foncer, en direction de Compiègne et de Château-Thierry, à marches forcées, sans trop se soucier de Paris où il ne pouvait y avoir que des forces négligeables. Bülow, de son côté, serrant sur sa gauche, poursuivra et accrochera Lanrezac de front : au lieu de marcher sur Paris il marchera sur Epernay...
C'est à ce moment que le drame de la défaite allemande se noua.
Le 30 août à 22 heures, prévenu par Klück de la décision qu'il venait de prendre de concert avec Bülow, Moltke, se contredisant, leur télégraphiait sa complète approbation....
(ler-5 septembre)
La journée du ler septembre.
Le ler septembre, le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, chargé de la défense de la capitale, s'attendait à voir apparaître les avant-gardes allemandes. Il ne disposait, outre quatre divisions territoriales médiocres et une brigade de fusiliers-marins, que des éléments de la VIe Armée du général Maunoury (un corps d'armée et quatre divisions de réserve qui se regroupaient, après leur repli, entre Creil et Pontoise) et de la division algérienne qui débarquait à Paris. Il attendait enfin, pour le 3 septembre, le corps d'armée de Lorraine que lui envoyait Joffre. Il installa ses forces sur le front du camp retranché, jalonné par Pontoise, Luzarches et Dammartinen-Goële. La VIe Armée tiendrait entre la route de Lille et la Marne ; la division algérienne formerait réserve.
Cependant, la retraite de nos IIIe, IVe et Ve Armées se poursuivait. Le ler septembre elles atteignaient la ligne Grand-Pré (en Argonne), Vouziers, abords nord de Reims, Fismes, région sud-est de Soissons. Les Anglais, retirés du jeu, se préparaient à franchir la Marne vers Meaux. Ce fut alors, le ler septembre à 14 heures que Joffre, après longue délibération, signifia par une instruction générale, la limite qu'il entendait de ne pas voir dépassée par ses armées : c'était la ligne marquée par la Seine de Bray-sur-Seine à l'Aube, l'Aube et la région nord de Bar-le-Duc.
Ce jour-là aussi, le maréchal Kitchner, ministre de la Guerre britannique, inquiet des intentions de French, débarquait à Paris, convoquait ce dernier à l'ambassade et lui intimait l'ordre de se maintenir sur la ligne de bataille, en coopérant avec les Français. Joffre prévenu, l'invita à se porter sur la Seine de Melun. Le 2e corps de Cavalerie, nouvellement constitué, le relierait vers Bray-sur-Seine, à la gauche de la Ve Armée.
Dès lors, aux yeux de Joffre, la situation était claire : les armées allemandes de droite, marchant sur Paris, allaient se heurter aux forces de Gallieni. Celles du centre viendraient se butter contre le barrage tendu sur la Seine et l'Aube...
Les décisions capitales (3-4 septembre).
Le 2 septembre et la matinée du 3, au G.Q.G. et à l'état-major de Gallieni, se passèrent dans l'attente. Les avant-gardes allemandes entraient à Senlis ; des uhlans se montraient au sud de la forêt de Chantilly ; tout confirmait que la droite allemande marchait sur Paris. Or, dans l'après-midi du 3 septembre, brusquement, et à la stupéfaction générale, le tableau changea. Tous les renseignements concordaient : il n'y avait plus au nord de Paris qu'un corps d'armée allemand. Tout le reste de la1re Armée allemande glissait à l'est de la route Meaux-Senlis, par les plateaux, vers le sud-est, comme pour aller passer la Marne de la Ferté-sous-Jouarre à Château-Thierry. Le soir, la colonne de droite avait franchi la Marne à quelques kilomètres à l'est de Meaux... Le 4 au matin, les reconnaissances de cavalerie poussées sur Senlis et Nanteuil-le-Haudouin tombèrent dans le vide. Gallieni n'avait plus de doute, « il fallait » leur tomber dessus : à 9 heures il donna l'ordre à Maunoury de prendre ses dispositions pour attaquer le lendemain.
À 8 heures, un envoyé de Gallieni était arrivé au G.Q.C., alors à Bar-sur-Aube, pour faire part de ses derniers renseignements et de ses intentions. Joffre, prévenu, réfléchit longuement, silencieux au centre d'une discussion fiévreuse. Notre front formait un vaste demi-cercle par rapport à l'ennemi qui venait de contourner Paris ; l'armée britannique et l'armée de Paris étaient en bonne position pour l'attaquer de flanc... Sa décision était prise : il arrêtera la retraite au plus tôt, avant d'atteindre la Seine, et reprendra aussitôt l'offensive. A 9 h 45, il fit prévenir Gallieni qu'il l'approuvait de pousser le jour même la VIe Armée vers l'ouest.
Cependant, avant de donner ses ordres d'exécution, il voulait avoir l'avis des autres intéressés : le commandant de la Ve Armée et celui de la IXe, qu'il avait constituée huit jours plus tôt pour assurer la liaison entre les IVe et Ve. Et il lui fallait l'accord de French, qui n'était pas officiellement sous son commandement.
Le commandant de la Ve Armée n'était plus Lanrezac. Joffre l'avait relevé, le jugeant fatigué et ne se sentant pas en communion de pensée avec lui. C'était une des victimes, et la plus éclatante, de l'épuration qu'il avait entreprise à l'encontre des chefs déficients. A la place de Lanrezac, il avait mis Franchet d'Esperey, vainqueur à la journée de Guise. Quant à la IXe Armée, il l'avait confiée à Foch, super-énergique. Et la IIIe à Sarrail, au caractère de fer.
La journée du 4 se passa en échanges de vues entre Joffre et Gallieni par le truchement de leurs états-majors, et en négociations menées successivement par Gallieni et par Franchet d'Esperey en personnes avec l'état-major de French, en l'absence de ce dernier. Vers 21 heures, les avis résolument favorables de Franchet d'Esperey et de Foch étant parvenus, Joffre et Gallieni, dans une conversation téléphonique d'homme à homme, tombèrent d'accord. A 22 heures, Joffre signa en conséquence l'« Ordre général de la Marne » dont voici la substance :
- L'offensive sera prise le 6 septembre au matin.
- La VIe Armée débouchant par le nord de Meaux franchira l'Ourcq et attaquera en direction de Château-Thierry.
- L'armée anglaise (alors arrêtée face au nord-est à 15 kilomètres au sud de la Marne à Lagny) attaquera face à l'est par le nord de Coulommiers en direction de Montmirail.
- La Ve Armée (qui s'arrêtera face au nord à une vingtaine de kilomètres au sud de la Ferté-Gaucher et de Montmirail) attaquera droit au nord en direction de Montmirail. Le 2e corps de Cavalerie (alors aux environs de Provins) la reliera à l'armée anglaise, dont elle est éloignée d'une vingtaine de kilomètres).
- La IXe Armée couvrira à droite la Ve en tenant les hauteurs qui commandent la plaine de Troyes du sud des Marais de Saint-Gond.
- La journée du 5 septembre sera consacrée à la mise en place sur les positions de départ.
Le lendemain, Joffre compléta cette instruction en ordonnant à de Langle de Cary de faire tête à l'ennemi et à Sarrail d'attaquer du sud de Verdun vers l'ouest.
Les historiens ont discuté à perte de vue pour déterminer la part relative de Joffre et de Gallieni dans l'« Ordre de la Marne ». Discussion assez oiseuse. L'ordre est signé « Joffre » et c'est Joffre qui en a endossé la responsabilité. On ne peut rien opposer à sa boutade : « Je ne sais qui a gagné la bataille de la Marne mais je connais bien celui qui l'aurait perdue ».
L'obstination de von Klück.
Que s'était-il passé chez l'ennemi depuis que, le 30 août au soir, von Klück, d'accord avec Bülow, au lieu de marcher sur la basse Seine s'était lancé vers le sud-est pour déborder la Ve Armée française ? Les 31 août, ler et 2 septembre, n'ayant plus rien devant lui, il a poussé sans désemparer ses trois corps de gauche par Compiègne en direction de Château-Thierry dans l'espoir de la devancer sur la Marne. Il n'a laissé pour surveiller Paris qu'un corps d'armée, le IVe de réserve, qui s'est installé, le 2, à Creil et Senlis. Au soir du 2 septembre, le gros de son armée, au prix d'étapes de 40 à 50 kilomètres est parvenu à une dizaine de kilomètres, au sud de la forêt de Villers-Cotterêts, mais son corps de gauche s'est déjà saisi, sur la Marne, du pont de Château-Thierry ! La gauche de la Ve Armée française était située par l'aviation à une vingtaine de kilomètres au nord-est et l'armée entière allait visiblement passer la Marne le lendemain aux ponts les plus proches en amont de Château-Thierry. Elle était déjà virtuellement débordée et si Klück ne pouvait l'assaillir sur la Marne, il ne doutait pas de la coincer sur la Seine. Bülow ayant une journée de marche de retard, la victoire serait l'œuvre de Klück : ce n'était qu'une question de deux ou trois jours...
Or, le 3 septembre au matin, voici que lui parvient une nouvelle directive de Moltke. « L'ennemi étant en complète dissolution, il ne s'agit plus que de le refouler vers la frontière suisse en se rabattant vers le sud-est, par l'est de Paris ». C'est bien ce que fait Klück depuis quatre jours. Mais, prescrit Moltke, dans ce mouvement, la Ire Armée restera en retrait de la IIe en flanc-garde face à Paris...
Von Klück écume. S'il obéit et s'arrête, la Ve Armée lui échappe et la manœuvre de Moltke est compromise ! Il passera outre et continuera à foncer vers le sud-est par delà la Marne, en utilisant les ponts de Château-Thierry à la Ferté-sous-Jouarre. Seul, son IVe Corps de réserve et une division de cavalerie, descendant de la région de Senlis, resteront face à Paris pour couvrir ses arrières. De ce côté, que risquait-on ?
C'est dans cette journée du 3 septembre, nous l'avons vu, que la marche des colonnes de la Ire Armée allemande entre la forêt de Villers-Cotterêts et la Marne en direction du Sud-est avait été révélée à Gallieni.
Les 4 et 5 septembre, le gros de l'armée von Klück poursuivit donc sans répit, dans le vide, sa manœuvre d'enveloppement de la gauche française. Le 5 au soir, son corps de gauche (le IXe) la serrait de près, à une quinzaine de kilomètre au sud de Montmirail et n'était plus qu'à 25 kilomètres de la Seine. Le IIe Corps de Cavalerie, au nord de Provins, en était plus près encore. Klück touchait au but !
Von Klück fait demi-tour (4 septembre - 23 heures).
Au matin du 5 septembre, il est vrai, Klück avait reçu de Moltke par radio un nouvel ordre stupéfiant : « Ire et IIe Armées resteront face au front est de Paris, Ire entre l'Oise et la Marne, IIe entre la Marne et la Seine. La IIIe marchera sur Troyes... ». Ainsi, au moment d'aboutir, il lui faudrait faire demi-tour, remonter à 50 kilomètres au nord, imposer à ses troupes épuisées de refaire en sens inverse les étapes qui leur avaient coûté tant d'efforts et redéployer face à l'ouest son armée orientée au sud-est ? A cet ordre invraisemblable il n'avait pas donné suite. Mais le soir même, il vit débarquer à son quartier général un envoyé de Moltke, le lieutenant-colonel Hentsch. Il venait lui expliquer la raison de la nouvelle directive et lui en imposer l'exécution. La raison : on savait maintenant que des corps d'armée français retirés du front de Lorraine avaient été transportés à Paris d'où ils pouvaient d'un jour à l'autre déboucher sur les arrières de l'armée allemande... Klück comprit : il fallait obéir. A 23 heures il ordonna le demi-tour, exception faite pour le corps de gauche (IXe), à la droite du Bülow, et pour le IIe Corps de cavalerie.
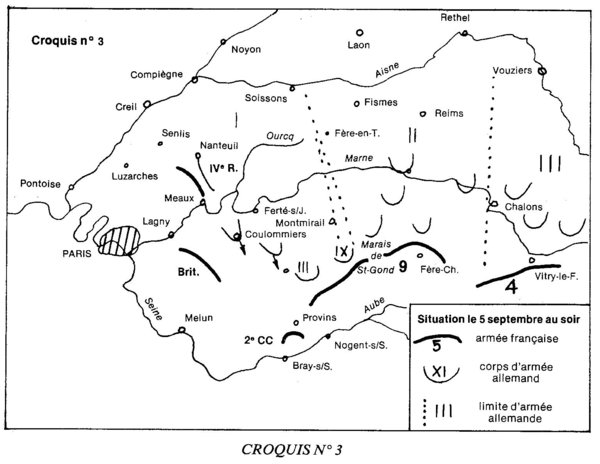
Mais, ce qu'il ne s'avait pas, c'est que l'armée de Paris avait déjà débouché et était, depuis le début de l'après-midi, aux prises avec son IVe Corps de réserve. En effet, dès le matin, la VIe Armée française, ayant serré sur sa droite, s'était mise en mouvement suivant les ordres de Gallieni pour gagner la route Meaux-Saint-Soupplet, sa base de départ pour l'offensive du lendemain. Le VIe Corps de réserve allemand, descendu tranquillement de la région de Senlis par l'est de la route ci-dessus venait de s'installer face à Paris sur les hauteurs au nord de Meaux lorsque des patrouilles de cavalerie avaient signalé l'approche de colonnes françaises. Son chef avait aussitôt décidé d'attaquer pour y voir clair. De violents combats s'étaient engagés aux abords de la route, sur une dizaine de kilomètres. C'était le prélude de la bataille de la Marne. Général Jacques HUMBERT. (à suivre)
N° 375 - Juin 1984
(Suite)
II
LA MARNE
Situation des armées allemandes le 6 septembre au matin (Croquis N° 1).
Joffre avait donné le 4 septembre l'ordre de prendre l'offensive le 6 au matin. Les Allemands ne s'en doutaient absolument pas. Quelles étaient le 6 à l'aube la situation de leurs armées à l'ouest de la Meuse et les intentions de leurs chefs ?
À l'ouest du front, von Klück, obtempérant à l'ordre de Moltke, venait de faire faire demi-tour au gros de ses troupes, soit trois corps d'armée, laissant en ligne, à la droite de l'armée Bülow, son corps de gauche (IXe), parvenu en fin de marche à une dizaine de kilomètres de la gauche de la Ve Armée française. A la nouvelle que son IVe Corps de réserve, laissé au nord de la Marne face à Paris, avait été engagé dans l'après-midi du 5 contre des forces importantes débouchant de la capitale, il avait réagi avec sa fougue habituelle et s'était immédiatement résolu à anéantir ces forces en les fixant de front et en les tournant par leur gauche. Après quoi il pourrait foncer sur Paris. À cet effet il poussait sans désemparer vers le nord les trois corps d'armée qu'il avait retirés du front.
Du retrait de ces derniers résultait, entre le IVe Corps de réserve (au nord de la Marne) et le IXe Corps (au sud de la Ferté-Gaucher), un vide de plus de trente kilomètres. En face de ce vide, l'armée anglaise et la gauche de la Ve Armée française. Mais les Anglais étant pratiquement hors de cause et la Ve Armée française en pleine retraite, il suffirait, pensait Klück, pour aveugler ce vide, des deux corps de cavalerie des Ire et IIe Armées (IIe et Ire Corps de Cavalerie). Bülow était d'accord.
Bülow, toujours en retard d'une journée sur Klück, avait perdu le contact des Français qu'il considérait comme en dissolution. La dernière directive de Moltke lui avait prescrit de se rabattre face à Paris, pour couvrir les armées de gauche dans leur conversion vers le sud-est. Il lui fallait pour cela pivoter sur le IXe Corps, laissé par Klück à sa disposition et porter sa gauche au-delà des hauteurs qui bordent au sud les marais de Saint-Gond.
Quant aux trois armées plus à l'est, elles comptaient continuer tranquillement vers le sud-est la poursuite des Français.
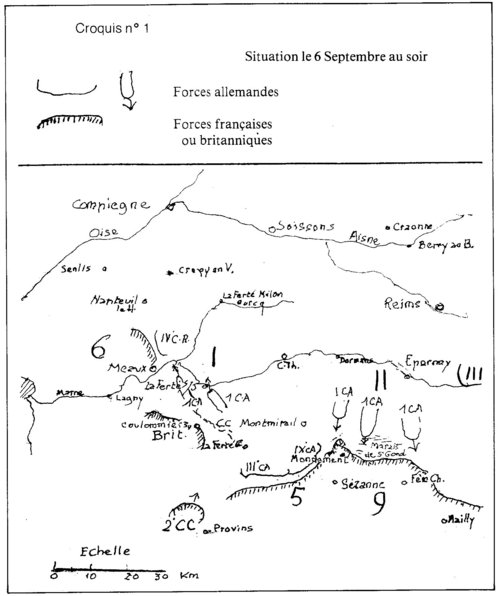
La journée du 6 septembre.
C'est dans ces conditions que, le 6 au matin, la bataille s'engage.
À l'ouest, Maunoury attaque de front le IVe Corps de réserve qui à son insu, s'est replié dans la nuit d'une douzaine de kilomètres. Le combat dure toute la journée. Il est coûteux mais les résultats sont nuls. Le soir, Maunoury décide de tenter le lendemain de tourner la droite allemande avec une division du corps d'armée qui vient de débarquer de Lorraine et avec le Ier Corps de Cavalerie qui lui est affecté après un mois de randonnées aussi vaines qu'éreintantes.
À sa droite, de l'autre côté de la Marne et à une distance de vingt à trente kilomètres de cette dernière, l'armée britannique, ayant abandonné le contact des Allemands depuis plus de huit jours, stationnait le 6 au matin sur une ligne très oblique par rapport à la base de départ que Joffre avait prévue pour elle. Elle ne peut, le 6, que gagner celle-ci par des marches de sept à quinze kilomètres en refoulant quelques éléments de cavalerie ennemis.
À droite des Anglais, séparée d'eux par une vingtaine de kilomètres où le IIe Corps de Cavalerie doit jouer un rôle de liaison, les deux corps de gauche de la Ve Armée se heurtent vers midi au IXe Corps de von Klück qui a repris sa marche vers le sud. La progression est modeste mais elle a obligé, dès le début, le IIIe Corps, déjà en route vers le nord, à faire demi-tour pour secourir et prolonger le IXe en difficulté et elle décide Klück à envoyer, dans la nuit du 6 au 7, à ces deux corps d'armées en grand danger d'être tournés, l'ordre de se replier dès l'aube de quelque quinze kilomètres vers le nord.
Quant à la droite de la Ve Armée, elle n'aborde qu'en fin de journée le corps de droite de Bülow après une avance de dix kilomètres environ.
Plus à l'est, Bülow, rattrapant son retard, refoule les éléments avancés de Foch sur les hauteurs qui dominent au sud les marais de Saint-Gond, mais ne pourra attaquer sérieusement que le lendemain.
La IIIe Armée allemande, qui a pris un jour de repos, est en retard sur Bülow. Elle n'a pas encore pris, au soir du 6, le contact de la IVe Armée française, étirée sur quelque soixante kilomètres. Quant à l'armée Sarrail, entre l'Ornain et Verdun, ses tentatives offensives ont été rapidement contrées. Sur le front de ces deux armées, que deux corps d'armées transportés de l'est vont étayer dès le lendemain, de durs combats se dérouleront dans les jours suivants sans conséquence sur l'issue de la bataille. Nous ne nous en occuperons pas.
Au total, cette première journée ne se traduit donc pas par des résultats spectaculaires. Mais l'effet moral est énorme. Du côté français, c'est le retour subit à l'espérance. Du côté allemand, c'est la stupeur... A Luxembourg surtout, où l'ordre du jour de Joffre, saisi sur un prisonnier, est parvenu en fin de journée. (Le G.Q.G. impérial s'est transféré à Luxembourg le 29 août.)
Journée des 7 et 8 septembre (Croquis n° 2).
Les 7 et 8 septembre, le destin sembla hésiter.
Maunoury, tout en s'acharnant à attaquer de front sans résultat notable, cherche bien à déborder la droite ennemie mais il manque de forces pour y parvenir, le le, Corps de Cavalerie se montrant d'ailleurs inefficace.
Le 8 au soir, il se voit réduit à la défensive. Von Klück, en revanche, a poussé sans trêve ses forces vers le nord derrière son IVe Corps de réserve, pour les faire déboucher le 9 sur l'aile gauche de Maunoury. Qui l'emportera ?
Au centre, il se produit le 7 un événement capital. Klück, acharné à la poursuite de son plan et ne se souciant plus de ce qui se passe au sud de la Marne, rappelle dès le matin ses IIIe et IXe Corps, qu'il a déjà fait décrocher dans la nuit. Dès le début de l'après-midi, ces deux corps se replient vers la Marne qu'ils franchissent entre Château-Thierry et la Ferté-sous-Jouarre, pour aller mener l'attaque contre la gauche de Maunoury, tandis que le corps de Cavalerie de la Ire Armée se replie sur la Marne, à la Ferté-sous-Jouarre et en aval. Du coup, la brèche est béante sur près de quarante kilomètres, devant les Anglais, le IIIe Corps de Cavalerie et le corps d'armée de gauche de la Ve Armée.
Bülow n'est plus couvert à sa droite que par son propre corps de Cavalerie. Comment ne serait-il pas anxieux ?
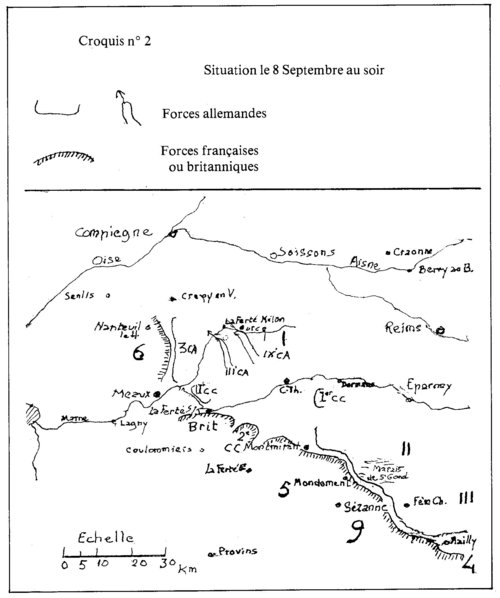
Mais ni les Anglais, ni la VC Armée française ne se sont aperçus du retrait des corps. de von Klück. Les Anglais, très prudents, veulent avant tout rester alignés sur la Ve Armée ; or les régiments de cette dernière, échaudés à Charleroi, fort fatigués, s'attendant à retomber sur l'ennemi d'un moment à l'autre, n'avancent qu'avec précaution et les chevaux du IIe Corps de cavalerie sont exténués. Le 8 au soir, les Anglais et la gauche de la Ve Armée n'ont pas dépassé une ligne comprise entre les abords sud de la Ferté-sous-Jouarre et Montmirail. Cela représente tout de même une avance moyenne de quinze kilomètres pour la journée malgré de durs combats contre la droite de Bülow.
Pendant ce temps, ce dernier, fidèle à.sa mission, a dépensé le gros de ses forces en violentes attaques contre les hauteurs tenues par la IXe Armée française au sud des marais de Saint-Gond (Hauteurs de Mondement et du Mont-Aout). Il s'y est cassé les dents mais, dans la nuit du 7 au 8, une attaque par surprise de la IIIe Armée à refoulé la droite de Foch à dix kilomètres au sud de Fère-Champenoise. Le 8 au soir, les Français, de ce côté, paraissent bien à bout. Aussi, malgré l'angoisse que lui cause la brèche ouverte sur sa droite, poursuivra-t-il le lendemain son effort vers le sud : peut-être cela soulagera-t-il son flanc droit ?
Le 8 au soir, Joffre, à Châtillon-sur-Seine, est en retard sur les événements. Il sait que les Anglais s'avancent lentement depuis deux jours dans un vide relatif et il presse French de l'exploiter en franchissant la Marne, à la Ferté-sous-Jouarre et en amont, pour tomber sur les arrières des forces de von Klück opposées à Maunoury. Mais il ignore la disparition des IIIe et IXe et du IIe Corps de Cavalerie allemands, et il ne peut se douter du vide absolu qui s'ouvre maintenant, non seulement devant les Anglais, mais devant le IIIe Corps de Cavalerie et le Corps d'armée de gauche de la Ve Armée, à l'insu de ces derniers. Il ne peut donc qu'inciter Franchet d'Esperey à appuyer les Anglais par sa gauche et à poursuivre vigoureusement sa poussée vers le nord.
Moltke, quant à lui, est resté inerte le 7 comme le 6. Le 8, par un appel radio de Bülow à son corps de cavalerie, il a eu la révélation de la brèche ouverte entre Kluck et Bülow. Du coup, il s'est affolé, a vu déjà la partie perdue, une retraite nécessaire pour ressouder à quelques dizaines de kilomètres plus au nord le front dissocié. Dans l'après-midi il a renvoyé sur place le lieutenant-colonel Hentsch, pessimiste notoire, pour juger de la situation et décider en son nom...
Le 9 septembre, journée décisive (Croquis n° 3).
Le 9 septembre, à la fin de la matinée, von Kluck déclenche contre la gauche de Maunou'ry l'attaque qu'il monte avec passion depuis trois jours. Un corps d'armée actif et demi (c'est le IXe et la moitié du IIIe, pleins d'allant malgré leurs marches forcées), flanqués par une division de cavalerie, débouchent brusquement de la région de la Ferté-Milon. En face d'eux, deux divisions, dont une de réserve déjà fort épuisée. Le succès est rapide. vers 15 heures, la gauche de Maunoury est refoulée de plus de sept kilomètres ; une brigade allemande, arrivant opportunément de Bruxelles par Compiègne, n'a plus que quelques kilomètres à avaler pour la prendre à revers.
C'est une victoire susceptible de larges développements que von Klück s'apprête à saisir.
À la même heure, midi environ, la gauche de Bülow - dont la Garde - qui, dans un suprême effort a pris pied le matin sur les hauteurs de Mondement et sur le Mont-Aout au sud des marais de Saint-Gond, n'a plus que des débris à balayer pour déferler dans la plaine de Sézanne. Le moral des feldgrau, comme chez Klück, est au plus haut.
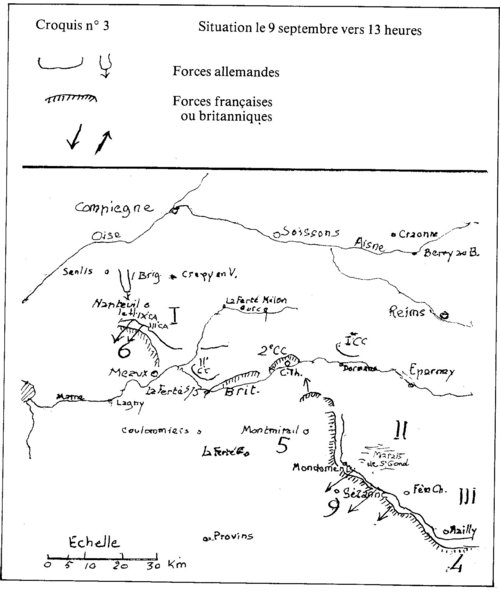
Or, vers 17 heures, les Français, moins épuisés qu'il ne semblait, contre-attaquant sur Mondement et au sud de Fère-Champenoise, tombaient dans le vide : l'ennemi avait disparu... Deux ou trois heures plus tôt, en effet, les fantassins allemands d'en face, prêts à repartir à l'assaut, avaient reçu, stupéfaits, l'ordre de rompre le combat et de se replier vers le nord. Et à peu près en même temps, à l'armée von Klück, il en avait été de même : les feldgrau avaient été saisis en pleine avance victorieuse par l'ordre incroyable de s'arrêter sur place et de décrocher à la nuit en direction de Soissons.
La cause de ce coup de théâtre ? La voici. Le 8 septembre à 19 h 15, le lieutenant-colonel Hentsch, pénétré des vues de Moltke était tombé au château de Montmort, près d'Epernay, quartier général de Bülow, dans un état-major angoissé par la fameuse brèche où le XIe Corps de Cavalerie, éparpillé, ne tenait plus le coup. D'emblée, Bülow s'était déclaré d'accord avec Moltke : à quoi bon un succès de Klück, voire de la gauche de Bülow, si l'ennemi franchit la Marne en force et débouche derrière leurs deux armées ? Il n'y aurait alors qu'un moyen d'éviter un désastre : ramener les Ire et IIe Armées derrière l'Aisne pour y rétablir le front. Dès que l'ennemi passera la Marne, avaient-ils conclu, il faudra s'y décider. Et il avait été convenu qu'Hentsch, dès le lendemain matin, irait prévenir Klück.
Parti de Montmort le 9 à 7 heures, retardé par des embouteillages de convois en retraite et par le grand détour qu'il avait cru nécessaire pour éviter la cavalerie française, Hentsch n'était arrivé chez Klück qu'à midi. Il l'avait trouvé dans l'exaltation de la victoire. En vain avait-il tenté de le convaincre : contre une poussée ennemie au nord de la Marne, Klück avait pris ses précautions. Mais, à 13 heures, on avait apporté un radio de Bülow ; daté de 11 heures. Il était clair : « La IIe Armée entame sa retraite ; aile droite Dormans ». Il n'y avait plus à discuter : la mort dans l'âme, Klück avait ordonné le repli sur l'Aisne de part et d'autre de Soissons.
En fait, se conformant à la directive de Joffre, les Britanniques, dans la matinée, avaient atteint et franchi la Marne sans peine, en amont de la Ferté-sous-Jouarre. Ils ne s'avancèrent pas cependant au cours de la journée à plus de dix kilomètres au nord. A leur droite, le IIe Corps de Cavalerie et le corps de gauche de la Ve armée ne dépassèrent qu'à peine la Marne à Château-Thierry et en aval, sans avoir repris le contact de l'ennemi. Les deux corps plus à droite, après avoir refoulé la droite de Bülow s'arrêtèrent face au nord-est à plusieurs kilomètres de la rivière. Au soir du 9 septembre, les Français ni les Anglais ne se doutaient que les I1e et IIe Armées allemandes étaient en pleine retraite et que la bataille était gagnée.
Moltke, lui, ne se faisait pas d'illusion : « Je ne saurais te dire à quel point je suis oppressé par le poids de mes responsabilités, écrivait-il à sa femme ; tout cela est au-dessus des forces humaines. »
La poursuite (10-15 septembre).
Au matin du 10 septembre, sur tout le front de Nanteuil-le-Haudoin à l'est de Fère-Champenoise, Britanniques et Français se convainquirent de la disparition de l'ennemi et entamèrent, non sans circonspection, la poursuite qui s'étendra le lendemain sur le front des IVe et IIIe Armées, devant lesquelles l'ennemi se repliait pour s'aligner sur Bülow. Mais les Allemands avaient pris de l'avance et la pluie tombait sans cesse. Faute d'une autorité coordinatrice, les armées Klück et Bülow s'étaient repliées dans des directions divergentes, l'une vers Soissons, l'autre vers Reims, élargissant ainsi la brèche qui les séparait. Celle-ci, cependant resta insoupçonnée.
Le 12, l'ennemi fit front au nord de l'Aisne, de part et d'autre de Soissons, aux abords nord et nord-est de Reims, et en Champagne jusqu'à hauteur de SainteMenehould.
Le 13, les forces alliées tentèrent en divers points, de forcer le barrage. Elles furent rapidement stoppées, sauf dans la région à l'ouest de Berry-au-Bac. Là sur une trentaine de kilomètres, le vide entre Kluck et Bülow se révéla soudain. Franchet d'Esperey y lança le IIe Corps de Cavalerie tandis que son corps d'armée de gauche, s'emparait, au nord de l'Aisne, des hauteurs de Craonne.
Deux jours durant on put croire le front allemand rompu. Ce n'était qu'une illusion : dès le 14, l'intervention d'une nouvelle armée allemande, faite de corps d'armée ramenés de Lorraine et de Maubeuge, dont la résistance avait pris fin le 7 rejetait sur l'Aisne nos forces aventurées.
Il ne restait plus qu'à tenter de bousculer par des attaques aussi violentes que possible ce front que l'on voulait encore considérer comme un simple rideau d'arrière-gardes, et à essayer de le déborder à l'ouest par la vallée de l'Oise. Il fallut vite déchanter. Toutes les attaques frontales échouèrent d'emblée... Partout elles trouvèrent l'ennemi déjà enterré derrière des fils de fer. Le débordement par l'ouest, tenté par un nouveau corps d'armée ramené de l'est, se heurta vite à une parade efficace. Visiblement l'ennemi entendait se maintenir inébranlablement sur son nouveau front. La fatigue de nos troupes, la carence de notre artillerie lourde et l'épuisement de nos stocks de munitions ne permettaient pas d'envisager l'effort prolongé d'une bataille de rupture. Au 17 septembre, le rideau tomba sur le grand acte stratégique ouvert douze jours plus tôt. Depuis trois jours Moltke était remplacé dans ses fonctions par le général von Falkenhayn...
Sans doute la victoire de la Marne eût-elle pu être plus éclatante encore si l'étendu de la brèche, habilement dissimulée par la Cavalerie allemande, avait été décelée le 7 ou le 8 septembre. On peut douter toutefois que l'absence de réserves importantes et l'irrémédiable lenteur des masses d'infanterie en eussent permis une exploitation stratégique décisive.
UN TROISIÈME ROUND SANS CONCLUSION
(15 septembre-31 décembre 1914)
Les Allemands n'entendaient pas renoncer et la France n'était pas libérée. Les attaques frontales s'avéraient sans espoir. Pour le commandement allemand, pas d'autre issue que de reprendre la marche sur Paris par le terrain libre à l'ouest de l'Oise en prélevant le maximum de forces sur le front de barrage qu'il avait choisi ; pour le commandement français pas d'autre issue que de débusquer l'ennemi en jetant sur ses derrières et ses communications, par le terrain libre à l'ouest de l'Oise, tout ce qu'il pourrait retirer du front atteint en fin de poursuite. Exactement symétriques les deux projets devaient fatalement aboutir à une confrontation dans les plaines du nord. Ses modalités et ses résultats dépendraient de l'importance des forces mises en œuvre et de la rapidité de leur intervention.
Les deux adversaires furent également incapables, en partie pour des raisons techniques ferroviaires, de constituer des masses puissantes à grand rayon d'action largement désolidarisées du front déjà fixé. Ils durent se contenter de tentatives de débordement sans envergure, toujours plus décalées vers le nord. D'où une suite de violentes rencontres à forces égales, en Picardie et aux avancées d'Arras, avec comme résultat, la prolongation en équerre du front cristallisé après la Marne.
Finalement, de fil en aiguille, les deux adversaires finirent, à la mi-octobre, par atteindre la mer du Nord, de part et d'autre de l'Yser, petite rivière lente et étroite derrière laquelle l'armée belge, après avoir évacué Anvers, venait de se replier. Tous deux, du 20 octobre au 15 novembre, tentèrent de réaliser en Flandre maritime le débordement décisif vainement poursuivi depuis plus d'un mois. Les Allemands, à défaut de Paris devenue inaccessible, visèrent les ports du détroit : Dunkerque, Calais, Boulogne, et engagèrent à cette fin deux armées puissantes, comprenant des corps d'armée de nouvelle formation au moral surchauffé, appuyées par un grand déploiement d'artillerie lourde. Animés par le général Foch, délégué de Joffre dans le Nord, les Français et les Anglais (ceux-ci ramenés du front de l'Aisne), tentant de progresser vers Gand, leur opposèrent rapidement des forces équivalentes.
Il en résultat deux batailles successives et étroitement liées. Du 20 au 27 octobre, les alliés, devancés dans leurs intentions offensives par le déferlement de l'attaque allemande, parvinrent à la briser sur l'Yser. A partir du 28, la levée des écluses qui empêchaient la mer d'envahir le pays de part et d'autre de l'Yser rendit cette partie du front infranchissable.
Dès lors, le cœur de la lutte se transporta devant Ypres, devenue le môle du front allié. Quinze jours durant, sur un vaste demi-cercle à une dizaine de kilomètres autour de la ville, de terribles affrontements se succédèrent, fort coûteux pour les deux camps. Les Allemands échouèrent dans tous leurs assauts mais les visées offensives de Foch furent réduites à néant. A la mi-novembre chacun des deux adversaires avait engagé dans cette bataille plus d'une trentaine de divisions et dépensé toutes ses réserves. La bataille s'éteignit.
De nouvelles offensives n'en furent pas moins entreprises à la mi-décembre, par les Français et les Anglais au sud d'Ypres et par les Français au nord d'Arras. Malgré un fort appui d'artillerie elles échouèrent immédiatement. Décidément, faute des moyens matériels adéquats, que l'on ne savait d'ailleurs ni préciser ni évaluer, l'enfoncement d'un front fortifié, même légèrement, s'avérait pour l'instant plus que problématique.
C'est sur cette constatation décevante que, dans la boue et la pluie, l'année se termina.
Tableau de fin d'année.
« Nous serons rentrés pour la Noël » avaient dit les soldats en partant. Et à Saint-Cyr on avait expliqué aux futurs officiers que la guerre serait courte pour des raisons économiques évidentes. Or la guerre continuait et nul ne voyait comment elle pourrait finir. Les deux armées adverses étaient enterrées face à face, leurs hommes presque au coude à coude, de la frontière suisse à la mer du Nord. Le commandement français n'avait presque pas de réserves, presque pas d'artillerie lourde et était désorienté par cette espèce de guerre de siège qu'il n'avait ni prévue ni étudiée. Condamné à l'offensive il ne savait comment techniquement l'envisager. L'avenir était obscur et cependant, chez les soldats français, la foi en la victoire restait totale, tandis qu'à l'intérieur la « Victoire de la Marne » avait pallié l'effet accablant des terribles pertes du mois d'août (*).
Quant aux Allemands, ils se demandaient si la solidité de leur front de l'ouest leur permettrait de régler leur compte aux Russes avant d'en finir avec les Français.
(*) À titre d'indication, la promotion de Saint-Cyr « Montmirail », sortie de l'école le 2 août 1914 à l'effectif de 485 sous-lieutenants, comptait le 11 novembre 1915, 233 tués. Sur ces 233, 120, soit plus de 50 pour 100, avaient été tués en 1914, dont 80 entre le 9 août et le 15 septembre et 23 dans la seule journée du 22 août.
REGARD D'ENSEMBLE SUR LA CAMPAGNE DE 1914
Les Français ont perdu la première bataille mais, leurs forces n'ayant été en aucune façon désorganisées, ce ne fut qu'un cruel échec. Grâce à sa force de caractère, Joffre sut le ramener à ses justes proportions, en préparer immédiatement la revanche et décider, sans souci de l'opinion, le sacrifice momentané d'une large portion du territoire national. A sa détermination répondit l'assentiment de ses troupes, inentamées dans leur moral malgré leurs grands sacrifices.
Le commandement allemand, en regard, se laissa aveugler par son succès et crut quasi hors de cause les forces qu'il avait seulement repoussée. Au lieu de préparer une nouvelle bataille, il s'abandonna à une stratégie de poursuite, laissant la bride sur le cou à ses commandants d'armée au risque de voir certains d'entre eux jouer un jeu personnel. Joffre tint les siens fermement en mains, imposant constamment sa volonté, au besoin par sa présence.
Joffre en décidant de livrer bataille entre Marne et Seine le 6 septembre, s'est inscrit parmi les grands chefs de guerre de l'Histoire. Sa décision et la stupeur qu'en éprouva l'adversaire résultaient logiquement des jugements portés par les deux commandants en chef sur la bataille des frontières.
La bataille de la Marne n'a pas été, elle non plus une victoire absolue car elle n'a pas davantage obtenu la désorganisation des forces adverses. Elle n'a pu que les contraindre à un large repli. Encore l'importance en a-t-elle été due à la défaillance morale de Moltke et de Bülow qui jugèrent la partie perdue alors qu'elle était peut-être sur le point d'être gagnée. Là encore, le caractère des grands chefs s'avéra primordial.
Après la fin de la poursuite, lorsque les Allemands eurent constitué un front continu à l'est de l'Oise, les deux commandants en chef n'eurent plus de possibilités de choix ; les opérations ne purent que se dérouler avec une inflexible logique jusqu'à l'extension du front de la mer à la Suisse.
Général Jacques HUMBERT
| Haut de page |
N° 378 - 1er trimestre 1985
PRÉAMBULE
Les deux camps.
La guerre de 1914 était en germe dans le traité de Francfort. Le fruit mûrit pendant quarante-quatre ans. Dans les premiers jours d'août 1914, il tomba.
L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'affrontaient à la France, à la Russie et à la Serbie. L'Italie, officiellement alliée à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, se défilait en attendant de voir. L'Empire britannique, en cordiaux rapports avec la France, réservait sa décision, mais l'Allemagne était convaincue qu'il n'interviendrait pas ; il n'avait d'ailleurs que quatre divisions, sans service militaire obligatoire. La neutralité de la Belgique était garantie par un traité dont l'Allemagne était signataire. L'Empire Ottoman était lié par un traité secret à l'Allemagne qui instruisait son armée. Les autres nations se tenaient à l'écart.
Le camp franco-russe était plein de confiance ; l'Allemagne débordait de certitude. Tout homme sensé pensait que la guerre serait trop coûteuse pour pouvoir durer plus de quelques mois.
Les forces en présence sur le front français.
Tout dépendait du duel franco-allemand. L'énorme Russie aux chemins de fer médiocres ne pèserait pas de tout son poids avant deux mois. D'ici là elle aurait affaire aux Austro-Hongrois. Elle avait promis à son alliée de lancer dès le début des hostilités deux armées sur la Prusse Orientale. L'Allemagne pensait les contenir aisément avec une seule, tandis qu'elle mettrait les Français hors de cause. Après quoi, pensait-elle, la question serait pratiquement réglée. Mais il lui fallait faire vite pour ne pas rester accrochée à l'Ouest lorsque la masse russe déferlerait dans toute sa puissance. Pour la France, au contraire, si elle n'était pas victorieuse d'emblée, il suffirait de tenir jusqu'à cette échéance. Elle avait du temps devant elle.
Numériquement les forces françaises et allemandes mobilisées étaient sensiblement égales. Les infanteries se valaient en puissance de feu, particulièrement en nombre de mitrailleuses ; si l'artillerie de campagne française était très supérieure en rapidité de tir grâce à son remarquable canon de 75, l'artillerie lourde allemande, représentée dans les corps d'armée et les divisions par des obusiers de 210 et de 105 à tir rapide, défiait toute comparaison avec la française, inexistante dans les corps d'armée et les divisions, réduite dans les armées à quelques régiments hâtivement constitués de canons longs, anciens et à tir lent.
Les deux armées étaient animées d'un patriotisme égal, de la même confiance en la victoire, de la même valeur combative et du même esprit offensif. Mais celui-ci, chez les Allemands, était associé à une juste estimation de la puissance du feu et des ressources de la défensive, alors que les Français, obnubilés par les souvenirs de la guerre de 70 et par les déboires des Russes en Mandchourie, s'exagérant d'ailleurs les vertus des forces morales, en faisaient une panacée. L'instruction des deux armées se ressentait de cette différence. La valeur moyenne des grands chefs était comparable mais, sur un point capital, et sans doute à son insu, la France l'emportait de haut : il s'agit de la capacité du commandant en chef. Moltke, l'Allemand, avait accepté la charge à son corps défendant. Savant, brillant, voire prestigieux, il se savait psychologiquement faible, indécis et tourmenté. Joffre, le Français, massif, lent et réfléchi, officier du génie, n'était pas passé par l'Ecole de guerre, mais avait prouvé en Indochine et en Afrique sa solidité et sa force de caractère. Il était sûr de lui-même, prêt à toutes les responsabilités, capable de surmonter tous les malheurs, certain à l'avance d'être le vainqueur.
Les plans de guerre allemand et français.
Le plan allemand, conçu par le prédécesseur de Moltke, était simple et grandiose. Tandis qu'un minimum de forces resterait sur la défensive à l'est de Metz, le gros de l'armée allemande pivotant autour de Metz à travers la Belgique et les plaines du Nord rabattrait le centre et la gauche française sur les Vosges et la Suisse. Dans cette manœuvre, le rôle principal incomberait à l'aile droite. Renforcée au maximum elle marcherait d'abord sur Paris et la Basse-Seine.
Conforme à la mystique française, le plan de Joffre était intégralement offensif. D'emblée, il attaquerait à l'est de Metz, ce qui absorberait le tiers de ses forces mais, pensait-il, en attirerait davantage. A l'ouest de Metz, il commencerait par attendre. Il savait bien que l'ennemi envahirait le sud de la Belgique et s'étirerait vers l'ouest pour l'envelopper avec une aile droite aussi forte que possible. Mais pour ce, pensait-il, Moltke serait obligé de faire des économies sur son centre, dans les Ardennes. Dès que le râteau allemand s'approcherait de la frontière française, il passerait à l'offensive partout mais c'est sur ce ventre mou des Ardennes qu'il lancerait sa masse principale. Elle le crèverait puis, se rabattant sur la gauche, se retournerait contre l'aile droite allemande. Mutantis mutandis, ce serait le coup d'Austerlitz.
Comme prévu, avant même la déclaration de guerre, les Allemands pénétrèrent en Belgique et en attaquèrent le verrou : Liège. L'effet fut immédiat : les Anglais entrèrent dans la guerre. Leur corps expéditionnaire s'embarqua pour aller prolonger la gauche française.
Dès la concentration faite, le 19 août, la droite française prit l'offensive en Lorraine, sans trop de précautions : elle s'y brisa dès le troisième jour. Joffre avait appris que la droite allemande s'étendait beaucoup plus à l'ouest qu'il ne l'avait prévu. Il en conclut que le centre en serait d'autant plus affaibli et sa propre manœuvre plus aisée. Le 22 août il lança son offensive dans les Ardennes. Partout elle se heurta à des forces supérieures. Ce fut un échec total, fort coûteux en tués, blessés, prisonniers et canons. Le même jour, l'armée du général Lanrezac, qui avait été poussée vers Charleroi pour bloquer la droite allemande, naturellement en l'attaquant, et qui l'avait contenue dans une rude bataille, s'était vue menacée d'être tournée sur sa droite et Lanrezac, pour la dégager, avait dû battre en retraite. Les Anglais, à sa gauche, s'en étaient trouvés isolés et ne s'étaient dérobés que de justesse. La confiance de leur chef, le maréchal French, dans le commandement français s'était évanoui du coup et il avait décidé de prendre du champ pour garder l'armée de Sa Majesté à l'abri d'une surprise.
Sur tout le front, le plan de Joffre avait donc fait fiasco. C'est qu'il s'était abusé dans l'évaluation des forces allemandes de première ligne. Comme les Français, les Allemands avaient des divisions d'active et des divisions de réserve, moins jeunes et moins entraînées. Les Français, pour les batailles initiales, ne comptaient que sur les premières et reléguaient les autres dans des tâches secondaires. Joffre avait pensé que les Allemands faisaient de même. Il n'en était rien. Moltke avait groupé ses divisions de réserve en corps d'armée et les avait engagées au côté des autres. Grâce à quoi le « ventre mou » n'avait pas existé...
La retraite.
Le 30 août, les armées françaises à l'ouest de la Meuse retraitaient sur toute la ligne. La petite armée anglaise s'était éclipsée. Les chefs allemands n'en doutèrent pas : elles étaient disloquées sans recours. Il n'était que d'en pourchasser les débris pour les liquider en un dernier coup de balai. Déjà l'armée de droite, commandée par un chef fougueux, von Klück, dont la droite atteignait Amiens, débordait la gauche de Lanrezac, qui filait sur Soissons. Moltke, très loin, à Coblence, laissait courir.
Il faisait erreur. Les armées françaises avaient manqué leur affaire mais elles n'étaient pas détruites ni même désorganisées. Celles de Lorraine s'étaient déjà ressaisies à une journée de marche de la frontière. Quant aux autres, elles retraitaient bien sûr, éreintées, mais sur ordre, et en ordre, et personne n'y croyait que la partie était jouée. C'est que Joffre n'avait pas perdu la tête. Il avait ramené son échec à ses justes proportions, tenait en mains ses subordonnés et préparait déjà une nouvelle bataille. Il lui fallait prendre du champ, abandonner délibérément une large portion du territoire national. Il s'y était résolu sans barguigner. Son plan était simple : ramener des forces de sa droite par chemin de fer, les rassembler à sa gauche sur le flanc de l'ennemi, puis reprendre l'offensive contre un adversaire affaibli par l'étirement de ses communications.
Courant de poste de commandement en poste de commandement, il expliquait sa manœuvre à ses subordonnés, leur insufflait sa confiance, les jaugeait, démettait les incapables. Pour rétablir son dispositif il lui fallait reculer jusqu'à la Seine en amont de Corbeil, et à l'Aube. Plus il reculait, plus les chefs allemands croyaient ses armées en déroute et la guerre déjà gagnée. Pourquoi marcher sur Mantes, pensait von Klück, quand l'aile gauche de Lanrezac se dérobait vers Soissons et Château-Thierry ? De lui-même il changea de direction de marche pour aller vers le sud-est envelopper Lanrezac. Il allait laisser Paris loin derrière sa droite, mais qu'avait-il à craindre de Paris ? Moltke n'intervenait pas. Ce qui l'inquiétait, c'était les deux armées russes entrées en Prusse Orientale. Elles affolaient les populations et irritaient l'Empereur. La partie étant pratiquement gagnée à l'ouest, que risquait-on à en distraire deux corps d'armée pour la Prusse où le général von Hindenburg et son chef d'état-major Ludendorf venaient de prendre les affaires en mains ? Ils allaient bien manquer en France quelques jours plus tard.
La Marne.
Le 4 septembre, à l'ouest de la Meuse, les armées alliées en retraite dessinaient un grand demi-cercle, de Verdun aux abords sud de Meaux par Saint-Dizier et Fère-Champenoise. L'armée française de gauche, où Franchet d'Esperey avait remplacé Lanrezac, s'approchait de la Seine près de Provins ; la petite armée anglaise qui s'était tenue depuis dix jours à l'écart, s'était arrêtée plus à gauche, à l'ouest de Coulommiers. Mais, au nord de la Marne, devant Paris, une nouvelle armée, ramenée de l'Est, était maintenant rassemblée, aux ordres du gouverneur de la capitale, Galliéni. Maunoury la commandait. Une vaste et profonde nasse était ainsi tendue où la droite et le centre allemands se trouvaient engouffrés. Le schéma que Joffre visait depuis le 25 août était réalisé...
Moltke venait d'être informé des transports français : il y avait des forces à Paris. Qu'elles débouchent, elles tomberaient sans rien rencontrer sur les arrières allemands. Atterré, il dépêcha à von Klück un officier de confiance, le lieutenant-colonel Hentsch, avec l'ordre impératif de faire demi-tour, de remonter au nord de la Marne et de s'installer en flanc-garde face à Paris. Klück se croyait à la veille d'un triomphe. Dépité, il s'exécuta sur le champ. C'était le 5 au soir. Mais, dès le 5 au matin, sur l'ordre de Galliéni d'accord avec Joffre, Maunoury s'était mis en mouvement vers l'est par le nord de la Marne.
Grâce à la rapidité de sa volte-face, Klück arrivera à temps pour lui barrer la route au nord-est de Meaux.
Le 6 septembre, sur l'ordre de Joffre, d'accord avec French, soucieux de l'honneur de l'Angleterre, Français et Anglais, revers et retraite oubliés, se portaient à la rencontre de l'ennemi stupéfait. La bataille de la Marne commençait. Les Français, instruits par l'expérience et d'ailleurs éreintés, avançaient résolument mais non sans précautions ni sans l'appui de leur artillerie. Les Anglais, qui avaient perdu depuis des jours le contact de l'ennemi, avaient d'abord à marcher pour le retrouver. Les Allemands, revenus de leur surprise, attaquaient eux aussi, et parfois furieusement, comme l'armée de von Bülow au centre contre l'armée du général Foch, au sud des marais de Saint-Gond. Les chances se seraient peut-être équilibrées si le demi-tour de von Klück n'avait ouvert un grand vide, à peine masqué par de la cavalerie, au sud de la Ferté-sous-Jouarre, en face des Anglais et de la gauche de Franchet d'Esperey.
La bataille dura trois jours. Le 9 septembre - tandis que von Klück s'acharnait contre Maunoury, et Bülow contre Foch - les Anglais et la gauche de d'Esperey, refoulant le léger rideau de cavalerie tendu entre les deux, atteignaient la Marne de la Ferté-sous-Jouarre à Château-Thierry. Sans qu'ils en eussent alors conscience, Anglais et Français avaient crevé le front allemand.
Moltke, depuis deux jours, pressentait le désastre. Il avait renvoyé sur place le lieutenant-colonel Hentsch pour y parer, si besoin était, par un ordre général de retraite. Le 9, vers midi, Bülow d'accord avec Hentsch jugea le moment venu. Klück dut se soumettre à l'interprète du commandement suprême et à la nécessité. Dès le soir, les deux armées retraitaient vers le nord. Le lendemain, les autres armées à l'ouest de la Meuse, suivaient le mouvement. L'ensemble allait se rétablir à une cinquantaine de kilomètres, de Soissons à Sainte-Menehould par les abords nord de Reims... Français et Anglais, à la voix de Joffre, avaient remporté la victoire de la Marne. D'ores et déjà l'Allemagne avait manqué sa guerre.
La course à la mer.
Les Français espéraient reconduire d'une traite l'ennemi à la frontière ; ils se heurtèrent à lui dès le 12 septembre. Il était enterré sur une ligne continue de tranchées. Ils tentèrent de l'en chasser. Ils manquaient d'obus. ils étaient exténués. Il pleuvait à flots. Ils durent s'arrêter et s'enterrer à leur tour. Joffre essaye de tourner ce front par la vallée de l'Oise. Les Allemands-eurent la même idée. Il fallait, de part et d'autre, retirer les divisions du front et les transporter à l'ouest, au-delà de l'aile ennemie. Ni les Français ni les Allemands ne purent réunir une masse de manœuvre capable d'un grand succès. Leurs tentatives successives de débordement, toujours de faible envergure, menées par des forces équivalentes aboutirent à une suite de grands combats de rencontre, sans autre effet que l'allongement progressif du front sur une ligne sud-nord, de Noyon à la mer, par Arras.
La bataille des Flandres.
Moltke, anéanti, avait été remplacé par le général von Falkenhayn. Falkenhayn voulut tenter avant la fin de l'année un effort massif et spectaculaire, à l'extrémité du front, dans les Flandres. Il s'emparerait des ports, Dunkerque, Calais, Boulogne puis se rabattrait vers la Somme. Son offensive se déclencha à la mi-octobre sur l'Yser et se prolongea devant Ypres, en deux batailles successives et acharnées. Devant de jeunes troupes allemandes fanatisées, les Anglais ramenés de l'Aisne, les Français, retirés du front par divisions, brigades, voire régiments, furent jetés dans la mêlée. Au bout d'un mois d'hécatombes, Falkenhayn dut renoncer.
Les intentions de Joffre et de Falkenhayn.
Le front était continu et fortifié de la mer à la Suisse. Pour Joffre, le devoir était clair : libérer le territoire français, donc attaquer, et le plus tôt possible, pour ne pas laisser l'ennemi s'incruster et le moral de la population faiblir.
Que tel fût le projet du commandant en chef français, Falkenhayn n'en doutait pas. Pour lui, la France était l'adversaire principal, le moteur de la coalition adverse. Il fallait tout mettre en oeuvre pour la forcer à capituler : l'abandon de l'Angleterre et de la Russie s'ensuivrait fatalement. Mais on ne pouvait recommencer août 14. C'est en brisant radicalement toutes ses offensives, en lui infligeant, ce faisant, des pertes insoutenables, et en paralysant son industrie de guerre par la guerre sous-marine - qui asphyxierait en même temps l'Angleterre - qu'on mettrait la France à genoux. Il s'agissait donc de fortifier le front de l'Ouest avec toute la méthode et la dépense nécessaires et d'y maintenir toutes les forces voulues pour briser à coup sûr tous les assauts, sans se laisser impressionner par les appels d'Hindenburg.
La guerre sur le front russe et l'évolution de Falkenhayn.
Dès le début de la guerre, les Austro-Hongrois avaient pris l'offensive contre les Serbes et contre les Russes. Ils avaient été battus par les uns et par les autres et leurs armées composites ne permettaient guère de grands résultats.
En revanche, le duo Hindenburg-Ludendorf, malgré une infériorité numérique évidente, avait libéré la Prusse Orientale en capturant deux armées russes, rejeté au cœur de la Pologne celles qui avaient menacé un moment la Silésie, et anéanti une autre dans la région du Niémen. Non seulement il demandait des renforts pour faire face à de nouvelles offensives des masses russes, mais, d'accord avec le général en chef des Austro-Hongrois Conrad von Hœntzendorf, il estimait que si aucune entreprise décisive ne pouvait plus être envisagée à l'ouest, il était possible, grâce à la supériorité indiscutable du commandement et du soldat allemands, d'infliger aux Russes, par une guerre de mouvement audacieuse, des défaites irrémédiables.
Falkenhayn était réticent. Il se rappelait 1812. Cependant, en mars 1915, il finit par se convaincre que le front de l'Ouest n'avait plus rien à craindre. Il se rallia alors dans une certaine mesure aux vues d'Hindenburg, lui envoya quelques renforts et lui laissa liberté de manœuvre pour mener, de concert avec Conrad von Hœntzendorf, une guerre offensive à l'Est, sans toutefois se laisser entraîner trop loin.
Les offensives françaises de l'hiver et du printemps.
C'est que les tentatives offensives des Français au cours de l'hiver et du printemps avaient dans l'ensemble échoué. Ils n'avaient pas prévu ce genre de guerre. En Champagne, plusieurs corps d'armées poursuivirent leurs attaques deux mois durant. Au prix de lourdes pertes ils ne purent enlever qu'une ligne de tranchées sur quelques kilomètres. Ailleurs, sur des fronts plus restreints, à Soissons, dans les Vosges, des expériences analogues n'aboutirent qu'à des résultats insignifiants et coûteux. En mars, en Woëwre, on essaya de la surprise : les attaques se brisèrent sur des fils de fer. De ces efforts décevants, le commandement français avait du moins retiré d'utiles leçons. Il avait surtout entrevu l'importance de l'artillerie à mettre en œuvre pour arriver à « percer » dans un secteur donné. Le 9 mai, fort de ces enseignements, il engagea d'un coup, au nord d'Arras, cinq corps d'armées sur un front de 25 kilomètres. Les Anglais participèrent à l'affaire en liaison avec eux. L'ennemi ne s'y attendait pas. Sur deux ou trois kilomètres, ses défenses, peu profondes d'ailleurs, furent emportées d'un seul élan et notre infanterie s'avança de trois ou quatre kilomètres, sans plus rien trouver devant elle. Rapidement soutenue elle eût pu aller plus loin et élargir la brèche. Ce ne fut pas le cas et les renforts ennemis rappliquèrent à temps pour bloquer son avance. Mais le fait était là : on avait percé. Il n'y avait qu'à recommencer sur une plus grande échelle, en profitant de la leçon.
L'écroulement du front russe.
Joffre avec l'approbation du gouvernement et d'accord avec les Anglais dont les forces, grâce à leur ministre de la Guerre, Lord Kitchener, s'étaient grandement accrues, décida de jouer l'offensive décisive avant la fin de l'été. Elle s'imposait d'autant plus que les Russes, après une grande victoire sur les Austro-Hongrois au début de mai, étaient bousculés sur une large partie de leur front et entraînés dans une retraite catastrophique, tandis que les Italiens, qui avaient fini par se décider à entrer dans la guerre, s'épuisaient dans de vaines attaques frontales sur les plateaux dalmates.
La grande tentative de percée du 25 septembre.
L'été, sur le front français, se passa en préparatifs fiévreux. On percerait en Champagne, sur un front de 25 kilomètres. Par la brèche ouverte, et tout en l'élargissant, on pousserait en masse, droit à la frontière. Une autre offensive, franco-anglaise, en Artois, attirerait à elle une notable partie des réserves ennemies, et percerait aussi, si faire se pouvait.
Pour arrêter notre avance sur ces deux directions stratégiques essentielles, l'ennemi serait obligé de prélever des réserves sur d'autres parties du front, affaiblissant d'autant son armature. Alors l'offensive s'étendrait de secteur en secteur, forçant l'ensemble des armées allemandes à une retraite générale.
Pour augmenter le nombre des pièces d'artillerie mises en œuvre, Joffre avait fait désarmer toutes les places fortes, y compris celles de première ligne - Verdun, Toul, Epinal et Belfort - ainsi que les batteries de côte. Nos bataillons étaient munis, à l'instar des Allemands, de mortiers de tranchée et de grenades tout juste sortis d'usines ; on avait accumulé d'énormes stocks de munitions ; créé à grands renforts de travailleurs, des kilomètres de boyaux et de parallèles pour l'approche et l'abri des troupes d'attaque, de routes, pistes et voies ferrées, nombre de postes de secours et de postes de commandement souterrains ainsi qu'un énorme réseau téléphonique. Tout cela n'était pas resté ignoré à l'intérieur ni de l'ennemi. Pourtant, cc n'est qu'au début de septembre que Falkenhayn s'inquiéta et fit embarquer pour la France deux corps d'armée du front russe.
Le général de Castelnau commandait en Champagne, le général Foch en Artois. Les troupes étaient peut-être les plus belles et les plus ardentes que la France eût jamais eues. L'offensive, en Champagne comme en Artois, déboucha le 25 septembre. Le temps s'était gâté. Il pleuvait. L'aviation, sur laquelle on comptait tant pour guider l'artillerie dans ses tirs, était clouée au sol. L'élan de l'assaut fut partout magnifique.
La bataille fut acharnée. Elle dura quatre jours. En Champagne comme en Artois nous enlevâmes la première position, progressant de 4 à 5 kilomètres ; nous fîmes au total plus de 28 000 prisonniers, enlevâmes 200 canons. Mais partout nous fûmes bloqués devant la deuxième position, occupée à temps par des réserves allemandes amenées à la hâte d'un peu partout. Nulle part, malgré des efforts désespérés, nous ne pûmes y mordre... Il fallut se rendre à l'évidence. « La percée » était un rêve impossible. Force était de trouver autre chose...
L'ouverture du front d'Orient.
Depuis le début de l'année, d'aucuns pensaient à l'Orient. En Angleterre, c'étaient le premier Lord de l'Amirauté, Winston Churchill, et le ministre de la Guerre, Kitchener. A leur instigation, une tentative avait été faite en mars pour mettre la main sur Constantinople et entrer en liaison avec la Russie par la mer Noire. Une escadre franco-anglaise avait essayé de forcer les Dardanelles. Elle avait renoncé après avoir eu plusieurs cuirassés coulés par des mines et des batteries de côte. Le gouvernement avait sollicité Joffre d'envoyer des divisions à Salonique pour menacer la Hongrie à revers, de concert avec les Serbes. Joffre, qui n'était jamais que « commandant en chef sur le front du Nord-Est » et qui préparait sa grande offensive en France, s'était refusé à distraire des troupes pour une entreprise improvisée dans un pays trop pauvre en voies de communication. Le ministre de la Guerre français avait alors formé lui-même deux divisions avec les réserves des dépôts, qui ne dépendaient que de lui, en vue d'une expédition franco-anglaise sous commandement britannique destinée à atteindre Constantinople par terre. Débarqué le 25 avril, à l'extrémité de la presqu'île de Gallipoli, le corps expéditionnaire avait été immédiatement bloqué devant des tranchées turques et restait depuis lors enlisé dans un désert sans eau. Mais, maintenant que le rideau était tombé en Champagne et en Artois, Joffre consentait à s'intéresser au théâtre d'Orient, et d'autant que le gouvernement s'apprêtait à le nommer commandant en chef de toutes les armées françaises.
Le théâtre d'Orient, il est vrai, devenait d'actualité. Falkenhayn était délivré de tout souci à l'Ouest. La Russie avait subi une défaite écrasante, mais il se refusait toujours, hanté par l'aventure de Napoléon, à se rendre aux incitations de Hindenburg. C'est vers le sud-est que s'orientaient ses desseins. Rallier la Bulgarie, écraser la Serbie, faire sa jonction avec la Turquie, menacer Suez et la route des Indes, prendre pied aux bords de la Méditerranée, aggraver en même temps la guerre sous-marine, tel était maintenant son plan.
Il ne perdit pas de temps. Dès le 5 octobre, la Bulgarie entrait en guerre aux côtés des puissances centrales. Le 7 octobre, les armées austro-hongroises, allemandes et bulgares assaillaient la Serbie par le nord et par l'est. La France et l'Angleterre, prévenues, avaient pu débarquer à temps à Salonique quelques divisions sous les ordres du général français Sarrail. Deux d'entre elles, françaises, s'avancèrent au secours des Serbes par la vallée du Vardar. Mais déjà l'armée serbe était refoulée vers l'ouest. Pourchassée, à travers un pays impossible, artillerie et bagages perdus, elle refluait vers l'Adriatique. En décembre, ses rescapés, embarqués sur des bateaux français, devaient échouer à Corfou.
Les forces franco-anglaises de Sarrail, renforcées par celles des Dardanelles que l'on évacuait, s'installèrent en camp retranché autour de Salonique. Le théâtre d'Orient était définitivement ouvert.
Les projets alliés pour 1916.
Par la vigueur de ses entreprises et l'étendue de ses sacrifices, la France s'était imposée comme animatrice de la coalition. Le 5 décembre 1915, les représentants des différentes armées alliées se réunirent au grand quartier général français, autour de Joffre. Tous furent d'accord pour une stratégie résolument offensive, mais coordonnée. Les différentes armées alliées, y compris l'armée d'Orient, prendraient donc l'offensive dès le début de l'été, à des dates aussi rapprochées que possible. Sur le front Ouest, les armées françaises et anglaises jointives - celles-ci considérablement accrues - attaqueraient aux environs du le1 juillet de part et d'autre de la Somme. D'ici là, chacun des Etats intéressés poursuivrait énergiquement ses efforts d'armement, facilités par l'ouverture du marché américain et par la maîtrise de la mer, inentamée malgré l'activité des sous-marins allemands.
La bataille de Verdun.
C'était compter sans Falkenhayn. Son rêve méditerranéen ayant fait fiasco, il en était revenu à son idée antérieure : convaincre la France qu'elle se saignait en vain. Sans souci de stratégie, il n'allait se proposer qu'un but : la décourager par des pertes écrasantes. Exploitant la supériorité allemande en artillerie lourde de destruction, il organiserait un véritable abattoir de Français. Encore fallait-il que ceux-ci acceptassent de s'y rendre et de s'y maintenir. Ils le feraient si l'enjeu était tel qu'ils n'en puissent accepter moralement la perte. C'était le cas de Verdun, ville historique de célébrité mondiale. L'attaque en était tentante en soi. Verdun n'était qu'à quelques kilomètres du front. Ses forts avaient été désarmés, comme nous l'avons dit. De vastes forêts assureraient le secret des préparatifs. Les lignes à enlever étaient faiblement tenues et sommairement organisées.
La faiblesse du secteur de Verdun était réelle. On n'avait pu à la fois multiplier les attaques et organiser puissamment toutes les parties du front. On avait porté l'effort sur celles dont l'enfoncement aurait été stratégiquement néfaste. Telle n'était pas la région de Verdun. Au début de février, cependant, certains indices et renseignements avaient alerté le grand quartier général et un des meilleurs corps d'armée avait été porté à une ou deux journées de marche en arrière de Verdun. Néanmoins, lorsque le 21 février, une tempête d'artillerie lourde s'abattit soudain sur les faibles défenses du secteur nord de la place, la surprise fut grande. Les troupes en ligne furent submergées. Dans la journée même, le fort de Douaumont, désarmé et sans garnison, tomba aux mains des fantassins ennemis ; la radio répandit la sensationnelle nouvelle dans le monde entier ; le commandement local fut débordé.
Joffre resta calme. Il envoya son adjoint, Castelnau, juger sur place. Castelpau le comprit d'emblée : en premier lieu il fallait un chef. Le général Pétain avec son état-major, mis en réserve après l'offensive de Champagne, était disponible. Castelnau l'appela. C'était un chef froid et réaliste. Ses commandements en Artois et en Champagne lui avaient valu une grande réputation. Il inspirait confiance. A son arrivée le désarroi cessa. Plus question de se retirer derrière la Meuse. Verdun sera défendu.
C'était bien, au fond, ce que voulait Falkenhayn. Les divisions françaises, cinq mois durant, dans un mouvement de noria incessant, calculé de façon qu'elles ne s'usassent pas trop, se succédèrent sur le champ de bataille, bientôt étendu à la rive gauche de la Meuse. Les noms de Douaumont, de Vaux, du Mort-Homme, de la Cote 304 et de la côte de Froideterre retentirent dans l'univers. Nos pertes se comptèrent par dizaines de milliers de tués. Mais celles des allemands ne furent guère moindres. Le courage des soldats français fut égal à l'épreuve. Pourtant les dernières réserves s'épuisaient en contre-attaques désespérées sur la dernière crête et la défense semblait à bout lorsque, le ler juillet, ainsi que Joffre l'avait décidé six mois plus tôt, une armée française et une anglaise se lançaient à l'assaut sur les deux rives de la Somme. Du coup, Verdun était sauvé.
La bataille de la Somme et la crise allemande.
Rien n'avait pu ébranler Joffre. Contre vents et marées il avait réservé les divisions nécessaires à son offensive. Et elles étaient des meilleures. Il ne s'agissait plus de percée. Cette fois on irait pas à pas, tranche de terrain par tranche de terrain, n'attaquant chacune qu'après écrasement. Cela ne différerait pas tellement de la méthode Falkenhayn, mais le front d'attaque était beaucoup plus étendu qu'à Verdun et, en même temps, l'armée russe du général Broussilov enfonçait le front autrichien entre les Carpathes et la Vistule, les Italiens repartaient à l'attaque en Trentin et Sarrail se préparait à affronter les Bulgares.
La bataille de la Somme s'ouvrit par d'éclatants succès. Elle se poursuivit jusqu'au cceur de l'automne par une succession d'avances, volontairement limitées, tant en profondeur qu'en largeur, facilitées par une maîtrise absolue de l'air. Dans le courant d'août le front de l'offensive fut étendu au sud grâce à l'extinction de la bataille de Verdun. En octobre, les Alliés avaient avancé en moyenne de six kilomètres, fait quelque 85 000 prisonniers, enlevé des centaines de canons et largement dépassé les dernières positions organisées. Cependant les Allemands se battaient toujours avec acharnement. Leur front n'était pas disloqué mais, tous les renseignements le confirmaient, leurs divisions en ligne étaient à bout de souffle et leurs réserves s'épuisaient.
C'est que la Somme n'était pas leur seul souci. A la suite de la victorieuse offensive de Broussilov, le centre et la droite russes étaient passés à leur tour à l'attaque en Lithuanie et en Courlande et n'avaient été contenus qu'à grand peine. Les Italiens, sur les plateaux dalmates, approchaient de Gorizia. La Roumanie enfin était entrée dans la danse aux côtés des Alliés. Obligés de soutenir leurs alliés défaillants, voire d'agir à leur place, les Allemands voyaient leurs disponibilités fondre. Si l'on ne s'arrêtait pas, pensait Joffre, leur front craquerait bientôt.
Et de fait, l'inquiétude grandissait en Allemagne. Falkenhayn avait été sacrifié. Appelé par l'opinion unanime, Hindenburg, auréolé par tant de victoires, avait reçu le commandement suprême.
Les projets d'offensive pour 1917 et le départ de Joffre.
Joffre, d'accord avec Douglas Haig qui avait remplacé French dès la fin de 1915, mettait tout en œuvre pour que l'offensive, momentanément interrompue en novembre par la boue et les brouillards picards, redémarre dès le ler février. L'accroissement continu des forces britanniques, à la suite de l'adoption du service militaire obligatoire, permettait d'étendre le front anglais au sud de la Somme et le front d'attaque français jusqu'à l'Oise. L'offensive déboucherait ainsi sur un front de soixante kilomètres. Les chefs désignés s'employaient fiévreusement à l'équipement de leurs bases de départ et à la mise en condition de leurs troupes lorsque, tout d'un coup, tout fut bouleversé.
La bataille de la Somme avait déçu le pays. Tant de sacrifices sans aucune décision ! Comment partager l'optimisme de Joffre ? N'y avait-il aucune autre stratégie ? Le commandement était contesté mais la poursuite de la guerre « jusqu'à la victoire » n'était pas pour autant mise en question comme avait pu l'espérer Falkenhayn. On voulait un homme nouveau, aux idées audacieuses. On crut l'avoir trouvé : c'était Nivelle. En mai, Pétain ayant été nommé à la tête d'un groupe d'armées, il l'avait remplacé devant Verdun et il avait vaillamment conduit la bataille aux heures les plus tragiques. En octobre, en deux attaques foudroyantes menées par le général Mangin, contre des troupes assez médiocres et fatiguées il est vrai, il avait reconquis presque sans pertes tout le terrain perdu depuis février. On le crut génial. Joffre, sacrifié, fut nommé maréchal de France pour la galerie, Nivelle reçut le commandement en chef.
Nivelle et son plan.
Il n'avait eu jusqu'alors que des commandements subordonnés, quoique importants. Soudain il eut à penser la guerre. Il transposa dans la stratégie sa tactique de Verdun. La surprise, il crut pouvoir l'obtenir sur un front jusqu'alors négligé ; le front de l'Aisne entre Soissons et Reims. Il emporterait d'un bond la longue crête du Chemin des Dames et lancerait aussitôt droit sur Laon toute une armée massée à l'avance sur les talons des troupes d'assaut. Le front d'attaque français au nord de l'Oise serait réduit en conséquence à la portion congrue. Rien ne serait changé en revanche aux attaques anglaises.
Nivelle avait prévu de lancer son offensive à la date prévue par Joffre, soit au début de février. C'était sous-estimer gravement les délais nécessaires à l'équipement d'un front jusqu'alors passif. Un froid rigoureux les accrut. Hindenburg bouscula le jeu.
Le repli allemand.
Hindenburg était un grand caractère. Ludendorf, qui l'inspirait, n'était pas un prudent arithméticien comme Falkenhayn mais un imaginatif et un joueur. Dès son arrivée sur le front de l'Ouest, il avait senti la corde sur le point de craquer. Il fallait prendre du champ, raccourcir le front pour récupérer du monde, faire tomber la prochaine offensive alliée dans le vide pour la briser largement en arrière. Il fit entreprendre immédiatement, à grand renfort de béton, une puissante ligne fortifiée, scientifiquement tracée, coupant le saillant du front, d'Arras à la forêt de Saint-Gobain par Saint-Quentin : ce fut la ligne Hindenburg. Quand elle fut prête, au milieu de mars, les troupes de l'avant s'y reportèrent posément en minant et détruisant tout derrière elles. Grande fut la surprise des alliés en découvrant que l'ennemi se repliait. Ils suivirent prudemment, stoppés et bluffés quotidiennement par des arrière-gardes. Il leur fallut une dizaine de jours pour approcher de la ligne Hindenburg et commencer à s'installer en face d'elle dans un pays dévasté. Que serait-il arrivé si, Joffre resté en place, l'offensive franco-anglaise s'était déclenchée au début de février comme il l'avait voulu ?
L'offensive du 16 avril 1917.
Le repli allemand ruinait le plan Nivelle. D'ores et déjà la surprise était exclue. L'importance des préparatifs français n'avait pu échapper à l'aviation allemande. L'ennemi avait renforcé ses premières lignes, rapproché des réserves. Le raccourcissement de son front lui fournissait des disponibilités nouvelles. Croire, comme l'assurait Nivelle, que le Chemin des Dames serait enlevé en vingt-quatre heures et Laon occupé le lendemain paraissait à beaucoup illusoire. Nombre des grands chefs, Pétain en particulier, laissés hors de l'affaire, partageaient ce scepticisme. Le gouvernement, renseigné par des officiers du front, s'inquiétait. Mais Nivelle était condamné à agir. L'offensive fut lancée le 16 avril, par un temps de giboulées neigeuses. On enleva la première position, 18 000 prisonniers, 80 canons ; on ne put franchir la crête. On continua à combattre pied à pied. Cette fois la déception fut mêlée de dépit. Nivelle, désavoué par tous, fut destitué. Pétain s'imposait. Il reçut le commandement en chef.
La situation à l'avènement de Pétain.
Il lui fallait de l'estomac. Le moral français avait pris un sérieux coup. Le pessimisme gagnait à l'intérieur. Les permissionnaires, à leur retour, s'en faisaient l'écho. Le doute se répandait dans les cantonnements. Des unités renâclaient pour monter en ligne. De véritables mutineries éclataient, parfois dans des régiments réputés. Le gouvernement flottait. On parlait de rencontres en pays neutre entre personnalités socialistes des deux camps, de traîtrises à l'intérieur...
À l'extérieur, le décor était sombre. La Roumanie, dont l'entrée en ligne avait apporté tant de réconfort, avait été écrasée en cinq mois. Très éprouvées mais encore résolues, ses forces se reconstituaient en Moldavie avec l'aide d'une mission française. En février le tsar, s'abandonnant devant de simples émeutes, avait abdiqué et une république socialiste s'était instaurée en Russie. Un démagogue aux généreuses intentions tâchait de susciter par des discours la bonne volonté des soldats. Le résultat n'était que trop clair : les armées russes ne se battaient à peu près plus. Enfin, les Allemands ayant considérablement accru leur flotte sous-marine le nombre des navires alliés coulés dépassait 300 par mois.
Il y avait cependant, à l'horizon, des lumières. L'armée anglaise avait attaqué à la date prévue et conformément aux plans initiaux, à l'est et au nord d'Arras. Son offensive se poursuivait sans faiblir, dans le style de la Somme. Elle allait s'étendre aux Flandres. Du coup, il est vrai, l'autorité de l'Angleterre dans l'alliance s'était accrue et Douglas Haig, qui avait consenti à accepter les directives de Nivelle, avait repris son indépendance. Mais surtout les Etats-Unis, décidés par l'extension de la guerre sous-marine, avaient déclaré, le 6 avril, la guerre à l'Allemagne. Dès le mois de juin, les premiers contingents américains débarquaient en France. Ce n'était encore que des échantillons et il faudra bien un an avant qu'une armée américaine constituée puisse entrer dans la bataille. N'importe, l'apparition des boys aux grands chapeaux soulèvera dans tout le pays une grande flambée d'espoir.
En France même, le matériel d'artillerie lourde, tardivement commandé par Joffre, sortait d'usine à bonne cadence.
L'ennemi enfin, contrairement à toute attente, inconscient de la dépression française, restait passif devant nous. C'est qu'Hindenburg et Ludendorf voulaient en finir avec la Russie déliquescente pour se retourner avec toutes leurs forces contre les Français et les Anglais avant que les Américains aient pu entrer en lice.
D'ailleurs, le gouvernement français ne l'ignorait pas, l'état de l'armée austro-hongroise était tel que le nouvel empereur, Charles Ier, n'estimait pas pouvoir continuer la guerre et cherchait à négocier une paix séparée avec la France ; des tendances pacifistes se faisaient jour en Allemagne et le chancelier Bethmann-Hollweg, en conflit avec le Haut-Commandement, devait donner sa démission.
Le redressement français.
Pour Pétain, il s'agissait d'abord de restaurer le moral de ses- armées. Et pour cela, persuader les troupes que c'en était fini des attaques mal préparées et mal appuyées, ruineuses de ce fait. « L'artillerie conquiert, l'infanterie occupe », déclara-t-il. Il définit les critères à observer pour le calcul des munitions et des effectifs dans l'offensive comme dans la défensive. Et pour convaincre tout le monde que, dans ces conditions, l'offensive serait payante, il organisa sans tarder deux puissantes attaques surprises, sur des objectifs strictement limités, assorties de la mise en œuvre d'un écrasant matériel : l'une dans le secteur de Verdun, l'autre au Chemin des Dames. Dans les deux cas le succès fut total, le chiffre des pertes minime.
Déjà, à ce moment, les mesures prises par Pétain pour améliorer la vie matérielle du soldat, les directives exigeantes qu'il avait multipliées à ce sujet, sa fermeté dans la répression de l'indiscipline avaient rétabli la confiance à tous les degrés. Et puis un vent nouveau soufflait au sommet de l'Etat. Un chef de gouvernement digne de ce nom apparaissait : Georges Clemenceau. Ses déclarations sans équivoque à la Chambre des Députés : « La guerre, rien que la guerre... La justice passe. Le pays connaîtra qu'il est défendu... », ses mesures radicales contre la propagande défaitiste et contre les agents de l'ennemi retentissaient dans la France entière. Sa vigueur était convaincante. On le crut.
Enfin un authentique commandement de la coalition s'ébauchait. Un « conseil supérieur de guerre interallié », réunissant les Premiers ministres des puissances alliées occidentales, se constituait en vue d'assurer la coordination de l'action militaire. Il se dotait d'un comité de conseillers militaires permanents dont, pour la France, le général Foch. Dès sa création, au début de novembre, l'institution faisait ses preuves. Une puissante offensive austro-allemande venait de bousculer les Italiens à Caporetto, dans la haute vallée du Tagliamento ; elle leur avait enlevé un butin énorme en prisonniers •et en matériel et les avait rejetés sur la Piave, presqu'aux portes de Venise. Sur ordre du conseil supérieur de guerre interallié des divisions françaises et anglaises accoururent à leur secours et l'avance allemande fut bloquée.
L'année se termina cependant dans l'anxiété, les velléités belliqueuses du soi-disant gouvernement russe s'étaient vite évanouies. Des révolutionnaires authentiques avaient pris le pouvoir en octobre, demandé l'armistice et déposé les armes. La totalité des forces allemandes était maintenant disponible. L'heure de l'explication finale approchait.
L'offensive allemande en Picardie et le commandement unique.
On attendait l'offensive allemande sur la droite anglaise fixée devant la ligne Hindenburg, au nord de l'Oise. Sa fortification n'était qu'ébauchée. D'accord avec Douglas Haig, Pétain avait placé derrière elle, en réserve, une armée française pour la soutenir en cas de besoin. Le 21 mars 1918, l'offensive ennemie se déclencha d'Arras à l'Oise, sur 70 kilomètres de front. L'objectif de Ludendorf était clair : il s'agissait d'écraser l'armée anglaise et, pour commencer, de la couper des armées françaises. Le front au sud de la Somme fut bousculé d'emblée. L'armée de réserve française intervint comme convenu. Mais Pétain était inquiet pour la Champagne. Douglas Haig et lui s'entendaient bien. Ils s'efforçaient de maintenir leurs forces jointives mais chacun d'eux était préoccupé de sa responsabilité nationale. L'un craignait d'abord pour Paris, l'autre pour les ports. Les chefs politiques, Clemenceau et Lloyd George, virent le péril. Il fallait un chef qui embrassât l'ensemble de la bataille du seul point de vue de l'intérêt général : Foch ne cessait de le répéter. Il était prêt à jouer le rôle et ne s'en cachait pas. Le 25 mars, à Doullens, Clemenceau et Lloyd George le lui confièrent. Quelques jours plus tard, avec l'accord des gouvernements italien et américain, Foch reçu le commandement suprême de toutes les armées alliées. Déjà Français et Anglais avaient reconstitué devant la ruée allemande un front assez dense et assuré leur liaison. Le 30 mars, l'ennemi fatigué par dix jours de combats ininterrompus sur soixante kilomètres de profondeur s'y brisa. Ludendorf comprit qu'il n'avait plus rien à espérer de ce côté. Les allemands étaient parvenus à 15 kilomètres d'Amiens et de Compiègne. C'était déjà un beau résultat. Il fallait maintenant frapper ailleurs.
L'offensive allemande dans les Flandres et le dilemme de Foch.
Le coup était prêt : sur la gauche anglaise maintenant dégarnie, entre Ypres et Béthune. Objectif : Calais. L'attaque fut lancée le 9 avril. Elle débuta brillamment. Mais, d'abord surprise et refoulée d'une quinzaine de kilomètres, la résistance anglaise s'organisa. Des divisions françaises envoyées par Foch, entrèrent en ligne. La bataille se fixa sur les monts de Flandre, le Kemmel en particulier, au sud d'Ypres. Le 29 avril, un dernier assaut allemand s'y brisa. Ludendorf décida d'arrêter les frais. Son idée maîtresse restait la même : liquider les Anglais. Il comptait la réaliser dès que la masse de ses troupes d'assaut serait de nouveau en condition.
Foch l'avait bien compris. Pour les Alliés, le coup le plus rude eût été la mise hors de cause des Anglais. La mer était proche, et ils étaient à bout : ils avaient perdu 300 000 hommes depuis le 21 mars. Abandonnés à eux-mêmes il était douteux qu'ils pussent tenir le coup. Foch décida de pousser derrière eux le gros des réserves françaises. C'était risquer une aventure sur le front français. Mais là une perte de terrain comparable n'eût pas été décisive. Il prit le risque.
L'offensive allemande sur l'Aisne.
Il perdit. Le 27 mai, l'armée qui tenait la longue crête du Chemin des Dames, surprise par un bombardement infernal et un assaut massif fut écrasée en quelques heures. Il n'y avait pas de réserves derrière. Avant que Foch ait pu en ramener du Nord, l'ennemi, le 1°r juin atteignait la Marne sur 20 kilomètres en amont de Château-Thierry à cinquante kilomètres de son front de départ. Surpris lui-même par une avance si rapide et quelque peu désuni de ce fait, il s'y heurta à des forces fraîches et bien installées, dont des Américains qui faisaient là leur apparition avec un brio extraordinaire. Cette fois encore, Lüdendorf ne s'obstina pas. Ayant suffisamment gagné de terrain, il allait préparer le coup de partie : le Friedensturm, l'assaut pour la Paix, qui userait toutes les réserves françaises et laisserait l'armée anglaise isolée devant l'attaque, déjà prête, qui en viendrait à bout.
L'offensive allemande de Champagne.
Pétain, à l'automne précédent, avait donné des directives précises pour la bataille défensive. Refuser la bataille sur la première position en n'y laissant qu'un trompe-œil ; se battre toutes forces réunies sur la deuxième, à 4 ou 5 kilomètres en arrière ; dans l'intervalle, abuser l'ennemi par des éléments légers et l'accabler sous les feux massifs de l'artillerie : tel était son système. Il n'avait pas été obéi sur le Chemin des Dames. Cette fois il imposa ses vues. Gouraud commandait en Champagne. Il s'y conforma résolument.
Le 14 juillet au soir il fut prévenu par des prisonniers de l'imminence de l'assaut. Il prit les devants et accabla de toute la masse de son artillerie les positions de départ. Au jour, l'infanterie allemande, déjà fort éprouvée, fonça dans le vide. Trois heures plus tard, matraquée à outrance, elle se brisait sous les feux de la deuxième position française quasiment intacte. L'échec était sans recours.
La marche à la victoire.
Foch l'avait prévu. Le front allemand depuis le début de juin formait une vaste poche entre la forêt de Villers-Cotterêts, la Marne et la Montagne de Reims. Sur le flanc ouest, deux armées françaises attendaient leur heure. Le 18 juillet, elles jaillirent des forêts, précédées de centaines de chars de combat fabriqués à l'insu des Allemands. L'ennemi, éberlué, fut enfoncé, Soissons libéré.
Foch avait repris l'initiative ; il n'allait plus la lâcher. Les Français et leurs alliés sur le front de France faisant bloc sous ses ordres, disposaient maintenant d'une artillerie automobile lourde et légère, de masses de camions pour le transport de l'infanterie, de milliers de chars de combat, d'une maîtrise de l'air totale. L'armée anglaise après ses épreuves du printemps avait retrouvé toute sa forme. L'armée américaine, constituée, entrait en ligne avec un million d'hommes. La supériorité numérique des alliés s'accroissait de jour en jour. Foch pouvait désormais porter ses coups à l'improviste d'un coin du front à l'autre, s'arrêtant quand cela devenait trop dur pour reporter ailleurs l'effort ou pour monter sur un large front une attaque d'ensemble.
L'ennemi, bientôt, ne sut plus où donner de la tête. En septembre, la fameuse « hernie de Saint-Mihiel » était conquise par les Américains, la ligne Hindenburg crevée par les Français à Saint-Quentin, par les Anglais à Cambrai ; Lille tombait aux mains de ces derniers. Inexorablement, à travers la Champagne, l'armée Gouraud s'approchait des Ardennes, et Mangin entrait à Laon. En octobre, la bataille s'étendait à la Flandre belge et une armée interalliée, aux ordres du roi Albert, approchait de Gand. Depuis le 18 juillet les « jours de deuil de l'armée allemande », selon l'expression de Ludendorf, se succédaient sans répit. Le 15 septembre, les Alliés, sous les ordres de Franchet d'Esperey, avaient crevé le front bulgare. Le 25 octobre, les armées austro-hongroises s'effondraient devant l'offensive italienne et l'empereur Charles demandait l'armistice. Les fantassins allemands se battaient toujours farouchement mais ne pouvaient plus que reculer. A l'intérieur de l'Allemagne, enfin, la marine se mutinait et la révolution se propageait dans les grandes villes. Malgré Ludendorf qui démissionnait écœuré, Hindenburg se rendit à l'évidence : pour que l'armature de l'armée allemande ne s'écroulât pas, force était de mettre fin aux combats. Les Alliés ne traiteraient pas avec Guillaume II : il fallait que Guillaume II abdiquât. Il s'y résigna. Le 7 novembre, les émissaires obscurs d'un gouvernement de rencontre se présentèrent aux lignes françaises. Le 11, ils acceptaient sans réserve les conditions des Alliés. Foch ordonna le « cessez le feu ».
L'Armistice.
Les Allemands déposaient des masses de matériel de guerre, livraient leur flotte, évacuaient l'Alsace, la Lorraine, la Belgique et toute la rive gauche du Rhin. Leurs régiments allaient réintégrer leurs garnisons souvent sous des arcs de triomphe. Les troupes françaises étaient accueillies dans l'enthousiasme à Metz et à Strasbourg.
Chez les Français toutes les cloches sonnaient.
Une joie délirante et une immense fierté jaillissaient des cœurs, traversées, hélas par la douloureuse évocation de ceux qui ne reviendraient pas. La nation unanime se croyait à l'aube d'une époque radieuse, ne doutait pas que ses régions dévastées seraient rapidement remises en état aux frais des vaincus - et ne se savait pas ruinée.
Chez les Allemands, la rancœur le disputait au chagrin devant tant d'illusions perdues et de sacrifices vains et l'angoisse grandissait devant le spectre de la révolution.
Général Jacques HUMBERT
| Haut de page |
N° 380 - 3e trimestre 1985
C'était au mois d'août 1917. Après un repos de quelques jours dans la région de Bar-sur-Aube, mon régiment - le 151e - remontait pour la troisième fois à Verdun et prenait part à l'offensive sur le Bois le Chaume et le Bois des Fosses, à 4 kilomètres de Douaumont.
Après plus de cinq heures d'attente et de voyage en camions par une chaleur torride et dans la poussière, nous débarquions vers 8 heures du soir à Verdun, dans la cour de l'ancienne caserne du régiment, au faubourg Paré. Un frugal repas froid, tiré de nos musettes et rapidement consommé, nous laissait à peine le temps de souffler, et les compagnies, sac au dos, montaient en ligne.
Je devais conduire la mienne à la ferme des Chambrettes. Mot charmant, évocateur ! Mais le tas de pierres auquel était réduit cette ferme, ne pouvait que faire tomber toute envolée lyrique, comme l'avait fait la traversée du Bois d'Haudremont pilonné chaque jour par l'artillerie lourde allemande.
Le terrain sur lequel nous marchions n'offrait à la vue et à nos pieds meurtris que des tronçons de tranchées bouleversées, des abris béants, des boyaux nivelés, le tout parsemé de débris les plus hétéroclites, parmi lesquels dominaient d'inextricables fouillis de fils de fer barbelés, de chevaux de frise et de câbles téléphoniques... paysage qui, somme toute, nous était devenu familier, mais qui prenait ce soir un aspect agressif et dantesque.
Nous marchions à la file indienne, la configuration du sol et les obstacles ne permettant d'autres formations.
J'allais en tête ayant à mes côtés le guide qui nous avait pris en charge et le lieutenant chef de la première section. Le reste suivait lentement, trébuchant non sans bruit et jurons dans les souches d'arbres à moitié arrachées, les trous d'obus, les piquets tordus, les fils de fer et contraints, par surcroît, à de nombreux plat ventre quand un obus coléreux éclatait près de nous. Les « gros noirs » passaient au-dessus de nos têtes dans un ronronnement bon enfant et allaient s'écraser sur quelque arrière inconnu.
Nous marchions depuis près d'une heure dans la zone dite « soumise au feu » et nous ne devions pas être à plus d'un kilomètre de la position à occuper.
La troupe était harassée, moins peut être par l'effort physique qu'elle fournissait depuis plus de six heures que par la tension nerveuse qu'elle éprouvait inconsciemment depuis que nous avions dépassé les positions des batteries de campagne pour entrer dans cette zone qui est celle où le fantassin est condamné à recevoir des coups sans pouvoir en donner.
Je marchais sans rien dire. On parle peu dans ces circonstances. Ma boussole machinalement serrée dans la main, m'en remettant bien davantage à mon guide qui pourtant, par deux fois déjà, avait paru hésiter sur la direction à suivre.
Je commençais à être inquiet, mais je gardais mes réflexions pour moi, lorsque soudain, dans la lueur brutale d'une fusée éclairante, je vis étendue devant moi la surface d'un lac immense. Surpris, je montrais à mes voisins l'obstacle qui nous barrait la route. Le guide interrogé ne connaissait pas ce lac dans ce secteur, mais n'était pas très catégorique et parut aussi étonné que moi, tout comme mon entourage immédiat qui n'avait d'yeux que pour cette masse d'eau.
Nous étions égarés. Du moins nous le pensions. Une simple lecture de la carte nous aurait rassurés mais il ne pouvait en être question avec cette nuit et l'endroit où nous nous trouvions.
Derrière nous, indifférents aux raisons qui motivaient cette halte inattendue, les hommes, échelonnés les uns derrière les autres sur plus de deux cents mètres s'allongeaient sur le sol sans même quitter leur sac.
J'en étais là de ma décevante découverte et cherchais à savoir comment nous allions sortir de cette impasse, lorsqu'une voix jaillit soudain de l'ombre et lançait au mépris du silence que nous nous imposions : « C'est toi Cazenave ? » Cazenave était le nom de mon guide, qui interpellé et faisant face à un autre guide de sa compagnie venu à sa rencontre : « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Le capitaine attend ! »
Grâce à cette mâle interjection, tout avait changé. Le lac avait disparu comme par enchantement. Je le cherchais en vain du regard et je ne voyais plus devant moi qu'un large trou d'obus plein d'eau qu'un détour de six à douze pas suffisait à contourner.
Le traditionnel « sac au dos » lancé à voix basse remettait la compagnie sur pied et la marche reprenait sous la conduite des deux guides.
La nuit se passa sans incident. Mais je n'en restais pas là. Il me fallait une explication à cette erreur qu'avaient partagée avec une égale spontanéité et une non moins grande conviction les quelque quinze hommes qui m'entouraient et qui, eux aussi, avaient réellement vu le lac, ce lac qui avait si bien pris forme dans nos esprits par une sorte de psychose collective due à la fatigue, à la marche nerfs tendus, à l'approche du danger, et surtout, quant à eux, parce que moi, le chef, je l'avais vu le premier et qu'il leur était impensable que je puisse me tromper, tant leur confiance en moi était grande.
Cet incident, assez banal en soi, me ramena à une salutaire modestie. Le chef qui sait à ce point capter la confiance de ses subordonnés n'a pas le droit de se tromper.
Je fis mon profit de cette leçon et les opérations qui suivirent me procurèrent des témoignages réconfortants et effacèrent l'impression désagréable que j'avais gardée de cette nuit de relève.
Mais l'évènement eut par la suite un épilogue assez comique l'interprétation romancée qui lui donnèrent ceux qui ne l'avaient point vécu et qui se targuaient d'un savoir plus que les autres.
À quelques jours de là, je surpris bien involontairement des propos qu'échangeaient deux « hommes de soupe » au retour d'une corvée de ravitaillement. L'un d'eux disait à l'autre : « Mon vieux on en a bavé à la dernière montée, même qu'on a buté sur un lac immense qu'il a fallu contourner et marcher une bonne heure de plus. Y parait que ce sont ces vaches de boches qui ont construit un barrage pour inonder le pays. Plus d'attaque possible. Aux roulantes y m'ont dit que le génie allait faire sauter le barrage. Non, mais tu te rends compte de ces vaches-là (sans que je n'ai jamais pu savoir si ce qualificatif s'appliquait aux hommes du génie on aux boches). Tous les mêmes que je te dis. Heureusement on sera relevé avant » !!
R.BASTEAU
| Haut de page |
N° 384 - 3e trimestre 1986
TEMOIGNAGE D'UN COMBATTANT
Un ancien du 74e R.IL en même temps qu'ancien combattant de Verdun, nous a communiqué une brève mais combien émouvante relation de l'action de certaines unités de son régiment au mois de mai 1916 en vue de la reprise du fort de Douaumont.
En cette année, alors qu'est célébré le 70e anniversaire de cette gigantesque bataille, il a paru opportun de citer ce témoignage d'un des derniers survivants.
Depuis le début de mai 1916, le général Pétain, nommé au commandement du Groupe d'Armées du Centre et son successeur à la l1e Armée, le général Nivelle, étaient aux prises avec un redoublement des attaques allemandes, en particulier sur la rive gauche de la Meuse. Il fallait absolument soulager les défenseurs du bois d'Avocourt, du Mort Homme et de la cote 304, par un coup de boutoir sur la rive droite, mais avec les seuls moyens de l'armée. Or la 5e Division était disponible et les noms de Mangin et de Douaumont n'étaient pas associés pour la première fois. Il fut donc décidé de confier à la division Mangin, renforcée par une brigade d'infanterie et 150 pièces d'artillerie, la mission de reprendre le fort de Douaumont. A un officier d'état-major qui lui exposait l'insuffisance des moyens et l'étroitesse du front d'attaque limité à 1 500 m, le général Pétain répondait : « Vous voyez très juste, mais vous saurez plus tard pourquoi je ne peux donner satisfaction à vos demandes. N'oubliez pas qu'il y a des circonstances à la guerre ou, pour relever le moral d'un pays et de ses alliés, il est nécessaire de faire des sacrifices qui font saigner le cœur d'un chef ».
Le 15 mai, sous une pluie battante, la division fut passée en revue par le général Mangin. Entre les rafales de vent, les Poilus percevaient par bribes les mots de leur chef : « En vertu des pouvoirs... République... Légion d'honneur... » Le général accrocha au drapeau du régiment, la croix de guerre avec palme, l'oncle Paul (commandant Lefebvre-Dibon) fut décoré ; les décorations tombaient comme la pluie ! Un poilu, sans acrimonie : « Et nous ! Qu'est-ce que nous aurons ? La croix de bois ? »
Le 19 mai, le régiment embarqua en camions et ceux-ci écrasèrent de leurs roues les pierres jetées à pleines pelletées par les territoriaux, sur la Voie Sacrée. La division Mangin était chargée de reprendre le Fort de Douaumont, et le 3e bataillon du 7-4 était en première ligne.
22 mai, 6 heures. - La préparation d'artillerie commence. Obus de 75 et de 155 pulvérisent les réseaux de fils de fer, nivellent les boyaux et tranchées. A intervalles réguliers, les grosses marmites ronronnent sur leurs trajectoires. Pendant quelques dixièmes de seconde le ronronnement cesse, le fort devient un volcan en éruption, une gerbe noire jaillit vers le ciel, environnée de nuages verts, jaunes et bruns, le bruit de l'éclatement martèle les tympans.
11 h 30. - Le bombardement redouble. Les dernières minutes avant l'assaut soumettent les nerfs à rude épreuve. Le Ber tire de sa vareuse un jeu de cartes et fait une patience. Une marmite éclate couvrant de terre le jeu et le joueur : « Enfin, c'est idiot, on ne peut même pas jouer aux cartes ! »
11 h 50. - « En avant ». Les sous-lieutenants Le Ber et Martin, en tête de sections, surgissent de leurs trous, le capitaine, debout sur le parapet prend des photos, l'oncle Paul bat des mains, criant de toutes ses forces « Bravo mes amis, vive le 3e bataillon ! »
Magnifique, le bataillon monte à l'assaut du Fort de Douaumont. L'avion de commandement, qui survole le secteur, rend compte. L'observation a commencé à 11 h 30, très difficile tant la fumée est opaque.
12 h 30. - L'attaque de droite atteint la corne sud-est du fort, et des éléments avancent vers la tourelle 3212. La partie sud de la tranchée des Hongrois n'est pas prise.
Les petites silhouettes découvertes, à travers la fumée, par l'observateur, ce sont les hommes de la lre, parvenus à leur objectif. Un feu de bengale est allumé à la tourelle et le capitaine rédige son premier compte rendu : « 12 h 30 batterie et tourelle atteintes par le 11e, aperçoit Allemands quittant le Fort par corne nord-est, aucune liaison avec compagnie du régiment de gauche, mitrailleuse allemande en action a la gorge du Fort. Prends commandement éléments arrivés sur objectif : trois sections de la 11e, une de la 9e section Le Ber a dû obliquer à droite ».
Dès qu'il le peut, en fin de journée, le capitaine se rend auprès du commandant Lefebvre-Dibon, à son P.C. du dépôt. L'oncle Paul accueille avec joie son jeune capitaine : « Quelle belle attaque, nos hommes ont été épatants ! » - « Oui, mon commandant, mais maintenant, il faut tenir, j'ai au moins 50 % de mon effectif hors de combat, nous sommes complètement en flèche et j'ai vu les mitrailleurs allemands installés sur le coffre nord-est, vous pouvez le dire à Mangin.
- Et Le Ber, savez-vous ce qu'il est devenu ?
- Il est ici, où deux de ses hommes ont pu le traîner mourant, avec deux balles dans le corps en se portant seul, en avant de sa section, pour préciser l'emplacement d'une mitrailleuse allemande.
Le capitaine se précipite auprès de son cher compagnon qui ouvre les yeux : « Donnes ta main, que je la serre une dernière fois. Tu diras à ma femme et à mes enfants que je donne ma vie à Dieu, pour la France et la sainte cause de la Paix ».
Le capitaine embrassa son vieux frère d'armes et se sauva dans la nuit pour apaiser dans l'action son immense chagrin.
Lieutenant-colonel DENISSE
| Haut de page |
N° 390 - 1er trimestre 1988
DU PAQUEBOT « ATHOS »
par un sous-marin ennemi
le 17 février 1917 en Méditerranée
Le colonel (R) Chartres nous a fait parvenir le récit poignant du torpillage de l'« Athos » le 17 février 1917. Cet officier supérieur s'est attaché à rassembler les meilleurs renseignements sur ce drame dans lequel a notamment péri, dans des conditions héroïques, comme le récit le fait ressortir, le commandant Colonna d'Istria. Le « Souvenir Français » lui exprime ses biens vifs remerciements.
Le paquebot français « Athos » du port de Marseille, 12 529 tonneaux de jauge brute, appartenant à la Compagnie des Messageries Maritimes, et effectuant le voyage de retour n° 4 de la ligne d'Extrême-Orient, quitte Port Saïd le mercredi 14 février à 16 heures, à destination de Marseille ; il est escorté par sloop anglais.
L'« Athos » porte 1 844 passagers dont 734 ouvriers chinois et 769 Tirailleurs sénégalais du 77e Bataillon, ces derniers pris à Djibouti ; l'effectif de l'équipage est de 320 tout compris. Toutes les dispositions relatives au sauvetage ont été prises avec le plus grand soin, de nombreux appels et exercices ont été faits pour les passagers et pour l'équipage, une garde de police fortement organisée doit être fournie à la première alerte par le Bataillon sénégalais. Par ailleurs, le commandant et son second se sont attachés à inspirer à tous le calme et la confiance en cas de torpillage, et la suite montrera, à leur honneur, qu'ils y ont réussi dans toute la mesure du possible.
Le samedi 17 février au jour, le temps est très beau, horizon clair, pas de vent, petite houle du nord, les deux torpilleurs d'escorte se tiennent par le travers de l' « Athos » à environ 700 m, « Enseigne Henry » à bâbord, « Mameluk » à tribord. Le convoi fait route directe au sud 80° ouest vrai, la vitesse oscille entre treize nœuds et demi et quatorze nœuds.
À 12 h 27, par L. 35°24' nord et G. 18°32' est ; sans que rien soit venu déceler la présence d'un sous-marin, l'« Athos » est frappé par une torpille. Cette dernière atteint le bâtiment à bâbord dans le compartiment de la cambuse, à toucher la cloison arrière du compartiment des machines et à une profondeur d'environ quatre mètres. La cloison des machines est défoncée à sa partie inférieure bâbord, le compartiment de la cambuse et celui des machines sont envahis et remplis au niveau extérieur presque instantanément ; pas assez vite cependant pour empêcher l'officier mécanicien de quart M. Donzel et le premier chauffeur Cipriani de se précipiter sur les registres d'admission de vapeur aux machines, placés à l'avant du compartiment, et de stopper les dites machines en fermant ces registres, sans attendre l'ordre de la passerelle. Quelques secondes plus tard la chose eut été impossible.
M. Donzel et le chauffeur Cipriani ont ensuite le temps de fuir devant la trombe d'eau qui arrive derrière eux et de passer dans la chaufferie milieu, mais à ce moment précis les portes étanches sont fermées de la passerelle ; ils se trouvent bloqués dans la chaufferie arrière d'où ils ne peuvent réussir à s'échapper à temps. Tous deux vont être engloutis dans la chaufferie, victimes de leur dévouement, mais, grâce à ce dévouement, la mise à l'eau des embarcations est désormais assurée.
Aussitôt l'explosion, le commandant présent sur la passerelle met lui-même les transmetteurs d'ordres aux machines sur Stop, puis fait appeler tout le monde aux postes d'évacuation, le signal de détresse est lancé par T.S.F. avec indication de position.
Le second capitaine, les lieutenants Santi et Roubert, le maître de manœuvre, le capitaine d'armes rallient immédiatement la passerelle. Le commandant leur prescrit de faire embarquer, de tenir les embarcations prêtes à amener, et surtout de maintenir parmi les passages le calme et la confiance. Tous repartent immédiatement, chacun de son côté, et assurent avec un zèle vraiment digne d'éloges l'exécution des ordres et des intentions de leur commandant.
Ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, la fermeture à distance des portes étanches a été actionnée de la passerelle par le commandant, toutes les lampes témoin ont fonctionné sauf celles des portes des tunnels des arbres porte-hélice, portes dont les cadres ont été évidemment détruits ou faussées par l'explosion de la torpille. Il est donc certain que, par les tunnels, le vaste compartiment situé à l'extrême arrière sous la cale 5 a été, lui aussi noyé très rapidement.
Trois minutes environ après le torpillage, le chef mécanicien arrive à son tour sur la passerelle, rend compte au commandant de l'importance et de la gravité des avaries, puis reste à son côté, ils sont rejoints quelques instants après par le contrôleur des postes Maurel.
L'embarquement des femmes et enfants s'effectue dans un ordre parfait, sauf au life-boat n° 11. En arrivant à ce dernier, le second mécanicien Holstein, chargé de la surveillance, le trouve envahi et surchargé par des chauffeurs arabes et des Chinois, les uns et les autres étrangers au canot, il essaie vainement de rétablir le calme et de les faire partir. A un moment donné les balancines cassent et le canot cabane, toutes les personnes qui se trouvent dedans sont précipitées à la mer et parmi elles deux femmes et deux filles, il est impossible ensuite de redresser ce canot qui, sous l'influence de la bande sur bâbord, reste plaqué contre la muraille du bâtiment. C'est autant de perdu pour le sauvetage.
Toutes les autres embarcations sont amenées au ras de l'eau au signal de la passerelle et l'embarquement des passagers désignés s'achève en bon ordre. Cette opération, particulièrement délicate, dans des circonstances critiques, est menée à bien grâce au sang-froid et au dévouement du second capitaine, des lieutenants Santi et Roubert, du commissaire Ramel, des seconds mécaniciens Brun et Holstein et du maître d'équipage Bastelica, tous, sans se préoccuper un seul instant de leur salut personnel, se multiplient tant pour maintenir l'ordre et le calme que pour faire amener sans encombre douze embarcations chargées de monde. Pendant ce temps le bâtiment commence à s'enfoncer sérieusement par l'arrière, mais il ne prend heureusement qu'une légère bande sur bâbord et par ailleurs le temps est superbe et la mer calme.
Dès que la vitesse est suffisamment amortie, le commandant qui, sur la passerelle, attend anxieusement cet instant et voit que le temps presse, lance le commandement « Amenez partout ». Jetez tous les radeaux à la mer et débordez le plus vite possible ! L'ordre est exécuté rapidement grâce au dévouement des officiers ci-dessus désignés et du maître d'équipage ; toutes les embarcations arrivent à la mer sans encombre sauf le canot 10, qui mal gouverné, chavire dans une embardée.
Le maître d'équipage, dès que son canot a été amené, l'a laissé aux soins d'un matelot et a veillé à la mise à l'eau des diverses embarcations de tribord. Le canot 7 s'est trouvé le dernier et, au moment où il arrivait à l'eau, la fargue bâbord s'est engagée sous la flasque de l'échelle de coupée centrale rabattue le long de la muraille, le bâtiment s'enfonce de plus en plus et l'embarcation risque d'être défoncée et chavirée. De la passerelle, le commandant qui suit la manœuvre a vu le danger que court cette embarcation il crie au maître d'équipage « Embarquez et dégagez à tout prix ce canot ». Le maître s'affale rapidement dedans et s'arcboutant de toutes ses forces réussit à dégager l'embarcation et déborde. Il est d'abord entraîné par les remous au-dessus de la cale 4 déjà submergée puis réussit à s'écarter après avoir failli être écrasé par la chute du mât arrière.
Dix minutes se sont écoulées depuis l'instant du torpillage et les radeaux de l'arrière sont tous à la mer ; mais à l'avant malgré tous les efforts du capitaine Sylvestre et de l'adjudant Poagetoux chargés de la conduite du détachement des ouvriers chinois, les vingt-quatre radeaux destinés à ces derniers n'ont pu à beaucoup près être tous mis à l'eau. Beaucoup de chinois restent inertes devant le danger, beaucoup d'autres ont commencé par s'égailler dans les cabines pour piller et, après avoir perdu ainsi un temps précieux, se ruent en masse à l'avant et se battent entre eux pour l'occupation des radeaux, ce qui n'a d'autre résultat, que de retarder encore la mise à l'eau desdits radeaux et partout de multiplier le nombre des Chinois qui ne pourront se sauver.
Une fois toutes embarcations parties, le second capitaine suivi du capitaine d'armes Berengier, a rejoint son commandant sur la passerelle. Ce dernier est déjà entouré du chef mécanicien Mignau et du contrôleur des Postes Maurel qui ont refusé de l'abandonner. Le commandant Colonna d'Istria du 77e Bataillon de Tirailleurs sénégalais est sur le pont supérieur appuyé à la lisse tribord avant, il n'a pas fait un geste pour se sauver. La garde de police du Bataillon sénégalais est à son poste au complet baïonnette au canon, et, à côté d'elle, le capitaine Roy qui est de service ce jour-là et a fait ses adieux à sa femme partie dans le life-boat 2, les souslieutenants Gradizi, Jeannot Constans et Delaunay. Leur consigne est de quitter le bord les derniers avec le commandant du bataillon dans les life-boats doublés : il est certain désormais que ces life-boats ne pourront pas être mis à la mer, et le bâtiment s'enfonce toujours ; aucun ne se fait illusion sur son sort, mais tous, esclaves du devoir militaire, depuis le simple tirailleur jusqu'au commandant du bataillon restent stoïquement à leur poste.
De même le capitaine Sylvestre et l'adjudant Poagetoux rivés à leur tâche aussi obscure qu'ingrate du sauvetage des ouvriers chinois.
De même les lieutenants du bord Santi et Roubert et le commissaire Ramel.
Trois minutes après le départ du dernier canot l' « Athos » commence à s'enfoncer très rapidement par l'arrière, la disparition est imminente. Le commandant s'écrie :« Mes amis, il n'y a plus rien à faire tâchez de vous sauver » ! En moins d'une minute l'avant du navire se mate presque vertical, s'enfonce et disparaît.
Le second capitaine, le chef mécanicien, le contrôleur des Postes qui jusque-là ont refusé d'abandonner le commandant, réussissent à se sauver en se jetant à la mer, il en est de même de l'opérateur de T.S.F. Magary qui - bien que blessé légèrement à l'œil par la chute de la bobine de secours - est resté à son poste jusqu'au dernier moment.
Le chef mécanicien perd connaissance est recueilli par un canot et ne reprend ses sens qu'à bord du « Mameluk » ; le second capitaine et l'opérateur de T.S.F. après être restés plus d'une demi-heure à l'eau parviennent à se réfugier sur un radeau. Le contrôleur des postes Maurel se retrouve à la mer à côté du commandant de l' « Athos » mais ce dernier est frappé de congestion presque instantanément, le contrôleur, dont la conduite a été admirable d'un bout à l'autre, s'efforce tout en nageant de soutenir le commandant dans l'attente d'un secours quelconque. Heureusement au bout d'un certain temps, le torpilleur « Enseigne Henry » arrive à portée et aperçoit le groupe ; l'enseigne de Vaisseau de deuxième classe de Verdelhan des Molies, dont le nom mérite d'être retenu se jette immédiatement à la mer avec une bouée qu'il pousse devant lui en rejoignant le groupe ; tandis que le commandant du torpilleur hèle un canot de l'« Athos » qui arrive également à portée, le contrôleur Maurel, le commandant de l'« Athos » et l'enseigne de Verdelhan sont hissés dans ce canot qui les dépose au plus vite sur le torpilleur. Là de vains efforts sont faits pour rappeler à la vie le commandant de l'« Athos » qui expire au bout de quelques minutes sans avoir repris connaissance.
Sur le pont inférieur les seconds mécaniciens Brun et Holstein ont pu également se sauver en se jetant à la mer. Le premier a été recueilli par un canot ; le second a rejoint à la nage un radeau chargé de chinois, mais ces derniers l'ont repoussé ; il s'est finalement accroché à un caisson flottant et ne sera recueilli que vers seize heures par un canot qui le déposera au « Mameluk ».
Moins heureux le premier lieutenant Santi, le second lieutenant Roubert et le commissaire Ramel disparaissent avec le bâtiment.
Avec eux disparaissent également le commandant Colonna d'Istria, le capitaine Roy, les sous-lieutenants Grandizi, Jeannot Constant et Delaunay, ainsi que tous les tirailleurs sénégalais de la garde de police.
Avec eux disparaissent aussi le capitaine Sylvestre et l'adjudant Poagetoux chargés de la conduite des Chinois et enfin le sergent Mougeot mort en cherchant à sauver les prisonniers allemands dont il avait la garde.
Officiers du bord, officiers, sous-officiers, Tirailleurs sénégalais de la garde de police, tous auraient pu essayer de se sauver et beaucoup auraient sous doute réussi ; tous sont morts héroïquement les uns victimes de leur dévouement, les autres esclaves de l'honneur et du devoir militaire. Tous en la circonstance ont donné un exemple admirable et se sont acquis un titre immortel à la reconnaissance du pays.
Après la disparition de l' « Athos » les torpilleurs « Enseigne Henry » et « Mameluk » recueillent le personnel passager et équipage réfugié dans les embarcations, puis celles-ci retournent au sauvetage soit avec leurs armements soit avec des volontaires. Le second capitaine Rosoor, bien qu'ayant passé plus d'une demi-heure à la mer, avant d'être recueilli sur un radeau, transborde dans la première embarcation qui accoste ledit radeau, prend la direction du sauvetage des gens à la mer, et reste dans cette embarcation jusque vers 21 heures moment où il est recueilli définitivement par le torpilleur « Baliste ». Dans cette embarcation comme à bord de l' « Athos », cet officier a donné un exemple superbe de sang-froid d'énergie et de dévouement. Les armements des embarcations qui l'ont secondé pendant huit heures méritent une mention spéciale.
À partir de quinze heures, chacun des torpilleurs « Enseigne Henry » et « Mameluk » s'est trouvé avoir à son bord environ 650 personnes ; heureusement la mer était calme, car il y avait là une situation réellement inquiétante au point de vue de la stabilité de ces petits bâtiments. Entre 20 heures et 22 heures le torpilleur « Baliste », puis la canonnière « Moqueuse » sont arrivés sur les lieux et ont recueilli ce qui restait dans les embarcations, soit une centaine d'hommes.
Le beau temps se maintient, heureusement, et le dimanche 18 février dans l'après-midi, les 1 428 rescapés sont en sûreté à Malte.
La veille était bien organisée à bord de l' « Athos », le paquebot était escorté par deux torpilleurs et marchait à peu près à sa vitesse de route.
Toutes dispositions relatives au sauvetage avaient été prises avec le plus grand soin. Le commandant et le second capitaine conscients de la responsabilité que faisait peser sur eux la présence de 2 164 personnes, s'étaient attachés à inspirer à tous le calme et la confiance, la suite a montré, à leur honneur, qu'ils y avaient réussi dans toute la mesure du possible.
Tout, dans la présente enquête, donne l'impression d'un commandement remarquable, secondé par des officiers et un équipage parfaitement en main et d'un dévouement à toute épreuve.
En face d'un événement de guerre contre lequel ils étaient malheureusement désarmés, le commandant, les officiers, le contrôleur des services postaux, et tout l'équipage de l' « Athos » ont donné un exemple admirable. Tous ont droit à la reconnaissance du pays, et parmi eux, en première ligne, le commandant Dorise, le second mécanicien Donzel, les lieutenants Santi et Roubert, le commissaire Ramel et le premier chauffeur Cipriani morts en service commandé, victimes de leur dévouement au salut commun.
En ce qui concerne les passagers, l'officier enquêteur a fait ressortir au cours du présent rapport :
1. Le calme parfait de tous les passagers européens, sans oublier un Américain.
2. La conduite blâmable des passagers chinois qui, pour la plus large part, sont morts victimes de leur manque absolu de sang-froid et de leurs esprits de rapine, en dépit de tous les efforts du capitaine et de l'adjudant qui se sont sacrifiés pour eux.
3. L'exemple magnifique donné par la garde de police du 77e Bataillon de Tirailleurs sénégalais, officiers de service et commandant en tête ; tous ayant pu tenter de se sauver et tous morts héroïquement à leur poste, esclaves de l'honneur et du devoir militaire.
4. La conduite du sergent Mougeot, mort en cherchant à sauver les prisonniers allemands confiés à sa garde.
| Haut de page |
N° 392 - 3e trimestre 1988
DE LA GRANDE GUERRE
Lorraine - 25 août 1914
La défaite de nos armées de Lorraine, le 20 août 1914 à Morhange, au tout début de la Grande Guerre, est restée imprimée dans la mémoire française. La victoire incontestable remportée cinq jours plus tard par les mêmes armées fut alors presque inaperçue et est aujourd'hui oubliée. Elle a été occultée à l'époque par l'avance foudroyante du gros des armées allemandes vers Paris et par la victoire quasi miraculeuse de la Marne.
Si elle n'eut que des conséquences stratégiques secondaires elle n'en fut pas moins une page très glorieuse et comme un rayon d'espoir.
C'est pourquoi nous nous sommes plu à la retracer à grands traits.
(20 - 23 août)
On sait que, le 20 août 1914, les troupes françaises, après avoir franchi la frontière de Lorraine entre la Moselle et les Vosges pour se porter à la rencontre de l'ennemi en direction de la Sarre et avoir atteint facilement la ligne Côte de Delme (20 km nord de Nancy) - Dieuze - Sarrebourg, avaient éprouvé, dans le secteur de Morhange, au centre de leur dispositif, un très grave revers qui les avait forcées à une retraite précipitée tandis que, plus à droite, dans les Vosges et jusqu'à la trouée de Belfort, le front se maintenait sur la crête frontière, face à la plaine d'Alsace. Nous ne nous intéresserons ici qu'aux opérations en Lorraine proprement dite à l'Ouest d'une ligne : Mont Donon - Épinal.
Dans cette zone et de l'ouest à l'est, les forces françaises se répartissaient entre deux armées :
- La 2e du général de Castelnau, dans la région peu accidentée qui s'étend entre la Moselle vers Pont-à-Mousson et les abords de la forêt vosgienne à une vingtaine de kilomètres de cette dernière.
- La 1re du général Dubail.
Dans la même zone, la vie armée allemande du Kronprinz Ruprecht de Bavière était opposée à la 2e armée française ; la VIIe armée du général von Heeringen à la lre. Le général Dubail et le général von Heeringen étendaient leur commandement au-delà du Donon - jusqu'à la frontière suisse.
Alors que les deux armées françaises dépendaient chacune directement du commandant en chef, le général Joffre, le Kronprinz de Bavière, tout en assumant personnellement le commandement de la VIe armée, exerçait son autorité sur l'ensemble des vie et VIII, jouant ainsi en quelque sorte le rôle d'un commandant de groupe d'armées. Le général von Heeringen n'en communiquait pas moins directement avec le commandant en chef allemand, von Moltke à Coblence. Ajoutons que les généraux de Castelnau et Dubail étaient unis par une parfaite communauté de vues et un esprit de coopération sans réserve.
La composition des armées opposées dans la zone qui nous intéresse était la suivante de l'ouest à l'est :
- du côté français :
à la 2e armée, 2e groupe de divisions de réserve (trois divisions), 20e, 15e, 16e corps d'armée et 2e corps de cavalerie (deux divisions) à la 17e armée, 8e, 13e, 21e corps d'armée et 6e division de cavalerie.
Le fort moderne de Manonviller interdisait la voie ferrée et la grande route Nancy-Strasbourg à une dizaine de kilomètres à l'est de Lunéville.
- du côté allemand :
à la VIe armée : IIIe, IIe et ler corps d'armée bavarois et XXIe corps d'armée (prussien) et trois divisions de cavalerie.
en arrière : ler corps d'armée bavarois de réserve et trois divisions d'ersatz (1).
à la VIIe armée : XIVe, XVe corps d'armée.
en arrière : XIVe corps d'armée de réserve et une division d'ersatz, soit 16 divisions d'infanterie françaises contre 20 allemandes, avec, au bénéfice de celles-ci, une puissante artillerie lourde, dont les Français étaient pratiquement démunis.
(1) Divisions constituées à la mobilisation, avec des contingents en surnombre n'ayant reçu qu'une instruction réduite. Elles n'avaient été que peu engagées le 20 août.
Dès l'après-midi de la funeste journée du 20 août, le commandant de la 2e armée française, dont le centre avait été mis en déroute, s'était vu contraint d'ordonner une retraite générale en direction de Nancy et de la Meurthe. Force avait été au Commandant de la Ire armée, dont les troupes continuaient à faire front, de se conformer à ce mouvement en repliant sa gauche en liaison avec la 2e armée et en accrochant sa droite de son mieux au massif vosgien. Dès le 21, le général en chef avait pris l'affaire en mains et prescrit à la 2e armée de gagner par sa gauche les hauteurs du Grand Couronné de Nancy, à l'est de cette ville, et, par sa droite, celles qui s'élèvent entre Meurthe et Moselle, de Rosières-aux-Salines à Bayon, connues sous le nom de « hauteurs de Saffais-Belchamp », afin de s'y reconstituer. La Ire armée recevait mission de tenir solidement les Vosges en couvrant le flanc sud de la 2e.
Le 23 au matin, les deux armées, qui n'avaient été que mollement poursuivies et dont la retraite avait été heureusement couverte par leur cavalerie, avaient réalisé dans l'ensemble la directive du commandant en chef.
La 2e armée occupait par sa gauche (2e groupe de divisions de réserve) les hauteurs du Grand-Couronné qui couvrent Nancy à une dizaine de kilomètres à l'est et au nord-est, entre la Moselle à hauteur de Pont-à-Mousson et la Meurthe près de Dombasle. L'ennemi était arrêté devant elle à une distance variant de 4 à 5 kilomètres.
Au centre, le 20e corps, en assez bonne condition, était rassemblé derrière la (1) Divisions constituées à la mobilisation, avec des contingents en surnombre n'ayant reçu qu'une instruction réduite. Elles n'avaient été que peu engagées le 20 août.
Meurthe, entre Rosières-aux-Salines et Saint-Nicolas-de-Port, prêt à déboucher sur la rive droite où il avait livré, la veille, d'heureux combats d'arrière-garde de part et d'autre du Sanon, à Crèvic et à Anthelupt.
À droite, les 15e et 16e corps étaient installés sur les hauteurs de Saffais-Belchamp qui dominent le pays de 80 mètres en moyenne. Ces deux corps d'armée avaient reçu chacun, le jour même, le renfort d'une division fraîche qui venait de débarquer à Bayon et à Charmes. C'étaient deux bonnes divisions de réserve des Alpes, la 64e et la 74e. Elles avaient été affectées respectivement au 15e et au 16e corps. Le 15e faisait face à la direction de Blainville, le 16e à celle de Gerbéviller. Ce dernier s'étendait à droite jusqu'aux avancées de Bayon, avec la 32e division à gauche et la 74e à droite. La 31e, très éprouvée, était en réserve.
À droite du 16e corps, formant équerre et séparé de lui par un intervalle de quelque huit kilomètres, le 8e corps de la 1re armée s'était établi dans la partie nord de l'épais massif forestier qui longe la Moselle au nord de Charmes et de Châtel, sa 15e division à gauche, la 16e à droite. Ses avant-postes étaient installés entre Damas-aux-Bois et les abords de la Mortagne. Les gros cantonnaient ou bivouaquaient à 4 ou 5 kilomètres en arrière.
En avant de ces quatre corps d'armée, le 2e corps de cavalerie tenait la Meurthe de Blainville au confluent de la Mortagne et celle-ci jusqu'aux abords sud de Gerbéviller. Le 2e bataillon de chasseurs à pied, qui lui était rattaché, avait la charge des principaux passages : Blainville, Mont-sur-Meurthe, Lameth, Gerbéviller dont les ponts, à l'exception de celui de Blainville, étaient intacts.
La 6e division de cavalerie tenait la Mortagne à la droite du 2e corps de cavalerie. Ces deux grandes unités de cavalerie n'étaient pas au contact de l'ennemi qui, sauf à Lunéville qu'il avait occupé le jour même, n'avait pas encore atteint la Meurthe. Il était prévu qu'après leur repli, elles s'établiraient dans le vide ménagé entre le 16e et le 8e corps.
À l'intérieur du quadrilatère formé par les 15e, 16e et 8e corps, la Meurthe et la Mortagne, s'étend un pays tourmenté, boisé par endroits, sans bonnes routes du nord au sud, très favorable à l'action retardatrice. Il est parcouru, dans sa partie sud-ouest, par un petit cours d'eau, l'Euron qui, après avoir pris sa source au fond de la forêt de Charmes et avoir remonté vers le nord jusqu'à six kilomètres au nord de Damas-aux-Bois, s'infléchit vers l'ouest, peu au-delà d'un éperon dominé par le village de Rozelieures, pour aller se jeter dans la Moselle à Bayon. Sa vallée supérieure et la route qui la suit mènent droit, par Saint-Boingt et Damas-aux-Bois, aux ponts de Charmes et de Châtel sur la Moselle. La côte d'Essey, près de Saint-Boingt, les domine de près de cent mètres.
Le 13e corps, plus à droite, face au nord-ouest et au nord, barrait la vallée de la Mortagne et l'intervalle entre Mortagne et Meurthe, couvrant Rambervillers. Il avait échappé lui aussi à la pression de l'ennemi qui s'était arrêté devant lui en fin de journée à une dizaine de kilomètres de Baccarat.
Le 21e corps s'accrochait, de Baccarat à Celles par Badonvillers, aux contreforts du Donon que nous avions perdu le 21.
À l'exception des 64e et 74e divisions, les troupes des 15e, 16e, 8e et 13e corps étaient extrêmement fatiguées, voire épuisées. Elles étaient gravement appauvries en cadres. « la 16e division, avait écrit la veille, le commandant du 8e corps, ne se compose plus que de débris». Le moral ne pouvait pas ne pas s'en ressentir. Toutefois, la plupart des régiments avaient reçu dans la journée, de l'intérieur, un renfort en hommes qui avait comblé une partie de leurs pertes.
Dans l'après-midi, le général de Castelnau avait fait part à ses divisionnaires de son intention de prendre l'offensive à bref délai. Le général Dubail avait adressé au commandant du 8e corps l'ordre de se tenir prêt à intervenir dans le flanc gauche des forces allemandes qu'il pensait, comme le général de Castelnau, en marche en direction de l'ouest.
Bien différentes étaient les intentions du Kronprinz de Bavière. Ce n'est que dans la journée du 21 août qu'au reçu des comptes-rendus de l'avant il avait acquis la conviction d'une victoire totale. Il avait appris alors les conditions désastreuses dans lesquelles certaines unités françaises s'étaient repliées. Le bilan était magnifique : 18000 prisonniers par la vie armée, plus de 10000 par la VIIe, plus de 50 canons ! « Fuite sauvage des Français » avait-il téléphoné à Moltke. Mais il n'avait entamé la poursuite qu'avec retard. Le 22, malgré quelques résistances françaises d'arrière-garde, l'avance s'était poursuivie à grand train. « Fuite désordonnée des Français», communiquait encore un commandant de corps d'armée. Evidemment toute possibilité de réaction offensive de leur part était exclue pour longtemps. Or, la mission du Kronprinz de Bavière, arrêtée après maintes études en temps de paix, était simplement de mettre hors de cause les forces qu'il avait devant lui et, ceci fait, de remettre le gros de son armée à la disposition du commandant suprême en vue de son transport à l'aile marchante des armées allemandes. Sa mission était remplie. Il comptait donc s'arrêter sur la Meurthe en se couvrant par un fort détachement face à Nancy dont les Français devaient sans doute préparer la défense. Ses troupes avaient d'ailleurs subi le 20 août des pertes sérieuses et avaient grand besoin de repos. Il avait donc téléphoné le 22 dans la soirée, de son quartier général de Dieuze, à Coblence, pour demander des instructions en vue de l'embarquement d'une partie de ses forces vers l'ouest.
Or, tout autres avaient été les directives qu'il avait reçues :« Poursuite en direction d'Epinal, s'était-il entendu répondre. Il y a encore dans les Vosges des forces considérables qui doivent être extirpées ».
Convaincu, par les comptes-rendus emphatiques de Ruprecht, de la déroute irrémédiable des Français en Lorraine, enivré par les succès éclatants qui se dessinaient à Charleroi et dans les Ardennes, dopé par les clameurs de victoire de von Heeringen, Moltke estimait maintenant judicieux, plutôt que de neutraliser pendant plusieurs jours dans un transport en chemin de fer deux ou trois corps de la VIe armée, de les employer tout de suite à liquider, dans un nouveau Sedan, les forces françaises enfournées dans les Vosges entre Epinal et la crête frontière.
Ruprecht ne fut pas d'accord. Il désapprouvait l'abandon d'un plan mûri en temps de paix. Il ne pouvait s'embarquer dans cette expédition lointaine sans exposer dangereusement ses arrières et son flanc droit. Et puis, dans l'après-midi du 22 août, l'ennemi avait opposé une résistance énergique au passage du canal de la Marne au Rhin près de Crévic. Peut-être n'était-il pas si défait qu'on le croyait ? Enfin les troupes étaient éreintées. Ruprecht ne modifia pas ses ordres pour le 23 : prise de Lunéville, déjà serré de près, occupation de la rive nord de la Meurthe jusqu'à Dombasle, établissement d'un front défensif face à Nancy, jusqu'à Delme.
Le 23, tandis que ce programme s'exécutait sans difficulté, la discussion s'était poursuivie entre Dieuze et Coblence. « Rappelez-vous qu'après Waterloo il suffisait d'un tambour monté sur un cheval pour faire fuir les Français », téléphonait-on du bureau des opérations du Commandant Suprême à celui de la VIe armée. Ruprecht avait multiplié en vain les objections. Le siège de Moltke était, fait. « On n'a rien voulu entendre, devait écrire Ruprecht. On m'a pressé d'une manière presque offensante ». Dans l'après-midi, enfin, il avait reçu un message catégorique : « S. Exc. von Moltke estime qu'en raison de la situation générale les forces françaises devant les Vle et VIIe armées (1) se retireront cette nuit. Il s'agit de porter immédiatement en avant l'aile droite de votre armée avec tous ses moyens disponibles en état de marche et de pousser jusqu'à épuisement complet en direction du sud-est afin de capturer la centaine de mille hommes qui combattent encore dans les Vosges, en les coupant d'Epinal ». Il n'y avait plus qu'à s'incliner.
La disposition des forces de la Vle armée était alors la suivante.
Face à Nancy, de Delme aux abords nord du canal de la Marne-au-Rhin près de Crévic, un groupement composé de trois divisions d'ersatz (2) et du III` corps d'armée bavarois, sous le commandement du chef de ce dernier, le général Gelbsattel, est établi défensivement face au front défensif français et à quelques kilomètres de distance.
Des abords nord du canal de la Marne-au-Rhin vers Crévic à la Meurthe à hauteur de Blainville, le II` corps d'armée bavarois (4e division à droite, 3e à gauche) est bloqué depuis la veille par une vigoureuse résistance française au nord de la forêt de Vitrimont. Il a poussé quelques éléments sur la Meurthe au sud de ladite forêt.
Aux abords sud et est de Lunéville où il est entré en grande pompe dans l'après-midi après quelques combats d'arrière-garde, le XXIe corps d'armée (prussien) (31e division au sud de la ville, 42e à l'est) n'a plus de contact avec l'ennemi.
En arrière, le 1er corps d'armée bavarois de réserve, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Lunéville, et trois divisions de cavalerie (7e, 8e et bavaroise) fatiguées.
La droite de la VIIe armée s'est arrêtée à une dizaine de kilomètres au nord de Baccarat et est séparée du XXIe corps d'armée de la Vle armée par un intervalle d'une dizaine de kilomètres au centre duquel le fort de Manonvillers, investi, tient toujours.
(1) Il s'agit là surtout des forces combattant dans les Vosges face à la plaine d'Alsace.
(2) 4e, 8e et 10e.
Le Kronprinz de Bavière, le 23 août au soir, n'a, semble-t-il, que des renseignements assez vagues sur la situation des Français devant lui. Il a l'impression que tout leur effort s'est porté sur la défense de Nancy et qu'ils ont concentré leurs forces à cet effet sur les hauteurs du Grand-Couronné d'une part, et sur celles de Saffais de l'autre sans s'étendre à plus de 4 ou 5 kilomètres au sud de la Meurthe. Il paraît dépourvu d'informations sur les directions de Lunéville à Bayon et à Charmes, peut-être à cause de la carence de sa cavalerie et de l'importance des forêts qui dissimulent les rassemblements à l'aviation.
Quoiqu'il en soit, tard dans la soirée, il donne ses ordres pour la manoeuvre qui lui est imposée. Elle sera exécutée par le IIe corps d'armée bavarois et le XXI` corps, les seuls qu'il ait sous la main, agissant de concert mais indépendamment l'un de l'autre. Marchant droit au sud, ils prendront pour objectif le 24 août, la ligne Domptail - Saint-Pierremont (à 12 kilomètres de Rambervillers sur la rive est de la Mortagne) - Loromontzey (à 10 kilomètres au sud-est de Bayon) et se redresseront le lendemain vers le sud-est sur Rambervillers et sur Brouvelieures pour couper d'Epinal les forces opposées à la VII` armée contre lesquelles celle-ci poursuivra ses attaques.
Le IIe corps bavarois, quittant ses positions au nord de la forêt de Vitrimont, franchira la Meurthe au pont de Mont, celui de Blainville étant en partie détruit. Il laissera sa 4e division en flanc-garde au sud de Blainville face aux hauteurs de Saffais et marchera avec la 3` en direction de Rozelieures - Damas-aux-Bois. Le XXI` corps marchera sur Rambervillers, de part et d'autre de la Mortagne dont sa division de droite (31e) abordera la rive ouest par le pont de Gerbéviller. Les 7e et 8e divisions de cavalerie gagneront la région nord de Lunéville pour éclairer les deux corps d'armée les jours suivants. En raison de leur fatigue, les deux corps d'armée n'entameront leur mouvement que le 24 août à 7 heures mais, pour répondre à l'impatience du commandant suprême, Ruprecht a prescrit de lancer immédiatement des avant-gardes composées de « marcheurs capables » (marschfâhig) qui devront atteindre pour 12 heures la route Rambervillers-Charmes (à 28 kilomètres à vol d'oiseau de Lunéville).
Si Ruprecht désapprouvait le principe de l'opération, il ne doutait pas de son succès, convaincu qu'il était de la désorganisation des Français. Il n'était pas néanmoins sans inquiétude pour son flanc droit. La 4e division bavaroise ne pourrait guère s'étendre sur plus d'une dizaine de kilomètres au sud de la Meurthe. Mais au-delà ? Restait un risque auquel la précipitation qui lui était imposée ne lui permettait pas de parer.
Par ailleurs il était confiant que le groupement Gelfsattel le mettait à l'abri de tout ennui au nord de la Meurthe, face à Nancy.
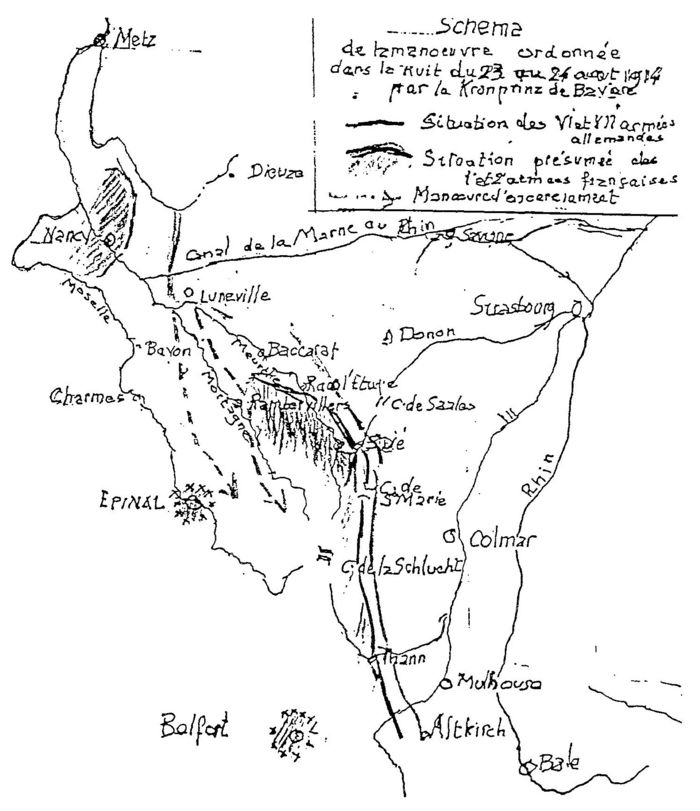
Les opérations allemandes
Dans la journée du 24 août, le IIe corps bavarois et le XXI` corps allaient être contrariés par l'action retardatrice du 2e corps de cavalerie (particulièrement de son artillerie, de ses groupes cyclistes et du 2e bataillon de chasseurs) et de la 6e division de cavalerie.
Grâce au brouillard, la 3e division bavaroise put franchir la Meurthe à Mont sans difficulté mais avec un grand retard et s'écouler vers le sud, par de grands bois mal frayés. Mais, au sortir de ceux-ci, à hauteur d'Einvaux et de Gerbéviller, elle tomba sous le feu de l'artillerie française, celle du 2e corps de cavalerie. Le temps de se déployer, de déterminer la situation de l'ennemi, de préparer une attaque, l'après-midi était avancée.
Sur ces entrefaites, l'ennemi avait disparu. Vers 17 heures on le retrouva à quelques kilomètres plus au sud. Ce fut le même scénario. La nuit vint. On ne pouvait s'engager dans les grandes forêts. La division bivouaqua à 7 ou 8 kilomètres au sud-ouest de Gerbéviller, avec un élément avancé à Rozelieures, sans contact avec l'ennemi.
À sa gauche, la 31e division du XXIe corps qui, de Lunéville, avait remonté la rive est de la Mortagne pour passer sur la rive ouest au pont de Gerbéviller, avait trouvé celui-ci farouchement défendu par des éléments du 2e bataillon de chasseurs.
Ce n'est que vers 17 h 30 qu'elle avait pu s'ouvrir le passage et occuper la ville en flammes. Elle dut s'installer pour la nuit à quelque cinq kilomètres au sud, sans' contact, elle non plus, avec l'ennemi.
Quant à la 4e division bavaroise, il lui fallut, pour passer la Meurthe, attendre que la 8e ait dégagé le pont de Mont. Elle s'établit défensivement au sud de Damelevières, (2 km ouest de Blainville) sur un front de dix kilomètres environ, face aux hauteurs, sous un bombardement continuel. Elle put néanmoins jeter un pont de bateaux à Blainville et y faire passer son artillerie. Mais il fut démoli aussitôt après. Elle se trouvait complètement isolée, à quelque dix kilomètres du reste de son corps d'armée.
Sur la rive est de la Mortagne, le commandant du XXIe corps, avec sa 42e division, avait eu plus de bonheur.
Il avait refoulé sans peine des éléments de la 6e division de cavalerie française et s'était arrêté à la tombée de la nuit à 10 kilomètres de Rambervillers, devant les positions solidement tenues par le 13e corps français, qu'il était trop tard pour attaquer.
En cette fin de soirée du 24 août, Ruprecht ne pouvait guère être satisfait. La 3e division d'infanterie bavaroise et la 31e étaient loin de leurs objectifs. Ses inquiétudes pour son flanc droit s'étaient accrues : vers 12 heures il avait été informé par son aviation de la présence de forces françaises importantes au nord-est de Bayon et il avait dû envisager l'éventualité d'une orientation de la 3e division bavaroise vers l'ouest.
Néanmoins, piqué au vif par l'insistance « presque offensante » de Moltke, il persista dans la manœuvre qui lui avait été imposée et prescrivit à ses deux corps d'armée de continuer leur marche en direction de Bruyères.
« Tout est organisé pour encercler l'ennemi dans les Vosges », fit-il téléphoner à Coblence. « Si nous ne pouvons y réussir ce ne sera pas de notre faute ! Mais la route n'est pas libre et l'infanterie est à bout de forces... ». Pour aider le XXIe corps dans sa poursuite il mit à sa disposition les 7e et 8` divisions de cavalerie.
À la VII` armée, tout allait normalement. Sa droite avait franchi la Meurthe à Baccarat et était engagée dans un combat frontal en avant de Rambervillers.
Du côté français, le 8e corps s'était, lui aussi, porté en avant. Dès 12 h 30, le général Dubail, informé du mouvement ennemi, lui avait ordonné de gagner du terrain vers le nord pour passer à l'attaque le lendemain 25. Dans l'après-midi, les 15e et 16e divisions qui venaient de recevoir des renforts de l'intérieur, s'étaient ébranlées. La 15e s'était avancée au nord de la côte d'Essey et la 16e était en retrait de quelque quatre kilomètres quand elles avaient reçu l'ordre de s'arrêter pour la nuit. Le 2e corps de cavalerie et la 6` division de cavalerie s'étaient repliées comme prévu dans l'intervalle entre les 8e et 16e corps.
Le général de Castelnau n'était pas non plus resté inactif. Il avait rapidement compris que la gauche de la VI` armée se dirigeait vers le Sud, défilant devant les 15e et 16e corps français et leur prêtant le flanc, tandis que ses arrières, au nord de la Meurthe, allaient rester exposés aux attaques débouchant de Nancy. Dès 11 h 30 il a donné l'ordre au 2e groupe de divisions de réserve et au 20e corps de prendre immédiatement l'offensive. Vers 15 h, leurs avant-gardes se sont portées en avant et elles ont progressé sans combat dans la large bande de terrain qui les séparait du front défensif allemand. Celles du 20e corps se sont installées de part et d'autre du Sanon, à hauteur de Crevic, la droite à la corne ouest de la forêt de Vitrimont, sur le terrain évacué le matin par le IIe corps bavarois, à trois kilomètres de Lunéville.
L'ennemi ne semble pas s'être aperçu de cette progression. L'historique de l'état-major allemand n'en parle pas et le Kronprinz de Bavière était si tranquille de ce côté qu'il avait accepté de se dessaisir d'une (1) de ses divisions d'ersatz - la plus au nord - au bénéfice du Kronprinz impérial. Elle venait de se mettre en route pour la Woëwre.
Pour Castelnau les perspectives sont prometteuses. Les troupes reposées. En plein accord avec Dubail, il a pris sa décision : la 2e armée attaquera sur tout son front demain 25 août à 4heures, de concert avec la gauche (8e et 13e corps) de la 1re.
L'effort principal sera fourni par le 16e corps qui attaquera de l'ouest à l'est sur la direction générale d'Einvaux-Gerbéviller en liaison avec le 8e qui attaquera droit au nord. Pour renforcer cette liaison, le 16e corps poussera dès ce soir une brigade de la 74e division et une forte artillerie sur un éperon avancé de la falaise, près de Borville, à 5 kilomètres au sud-est de Bayon et 3 de Rozelieures.
Au nord de la Meurthe, la droite du 2e groupe de divisions de réserve et le 20e corps poursuivront leurs attaques.
À droite du 8e corps, le 13e, qui s'est installé à son contact de part et d'autre de la Mortagne et en avant de Rambervillers, rejettera dans la Meurthe l'ennemi qui l'a franchie à Baccarat dans la journée.
Le 25 août va donc être décisif. Car le IIe corps bavarois et le XXIe vont eux aussi, à l'aube, prendre l'offensive pour poursuivre leur mission interrompue et atteindre en premier lieu l'objectif Loromontzey, Saint-Pierremont, Domptail qui leur avait été fixé pour le 24.
(1) La 10e.
Engagement et reflux du 8e corps
Au soir du 24, à l'ouest de la Mortagne, les positions de la 3e division bavaroise et de la 31e division prussienne d'une part, des 15e et l6e divisions françaises d'autre part, étaient, nous l'avons vu, distantes de quatre à six kilomètres. Dans la nuit, qui avait été calme, les deux divisions allemandes avaient pu recevoir la totalité de leur artillerie, plus celle du Il' corps bavarois, qui leur avait fait défaut en grande partie dans la journée. A l'aube, les quatre divisions adverses se portèrent en avant, pratiquement à l'aveuglette, deux à deux l'une contre l'autre, sur des axes identiques.
Dès 6 heures, le régiment de gauche de la 15e division s'était emparé de Rozelieures, faiblement tenu. Il progressait vers le nord, quand, à deux kilomètres plus loin, il se heurta au régiment de droite de la 3e division bavaroise qui avait eu le temps de se déployer à la lisière d'un grand bois. Rapidement éprouvé, découvert sur sa gauche et menacé de débordement, il se replia sous le feu, évacua Rozelieures et, décimé, reflua en désordre sur Damas-aux-Bois. Heureusement, le commandant de la 15e division eut le temps de barrer le défilé de l'Euron et la route de Damas en jetant à l'ouest de cette dernière, en face de Rozelieures, dans le grand bois Lalau, où l'ennemi avait déjà pris pied, deux bataillons réservés. Grâce à l'intervention de plusieurs régiments du 2e corps de cavalerie et de la 6e division de cavalerie combattant à pied, de leurs groupes cyclistes, puis du 2e bataillon de chasseurs à pied, la lutte pour la maîtrise du bois Lalau allait se poursuivre toute la journée. Il restera entre nos mains.
Le repli précipité du régiment de gauche avait entraîné de proche en proche celui de la 15e division entière, qui, après avoir largement progressé, s'était engagée contre la 3e division bavaroise. A 12 heures elle était revenue bien en deçà de sa base de départ. Tous ses régiments avaient été dépenses et très éprouvés. L'ennemi, fort maltraité lui aussi par l'artillerie française, n'avait que prudemment suivi. La situation de la division était néanmoins angoissante. La 16e division, au début de la matinée, avait progressé sans combat de plusieurs kilomètres puis s'était affrontée, à hauteur de Mattexey (1) à la 31e division prussienne. Après plusieurs heures de combat, la retraite de la 15e division l'avait laissée en flèche. A 11 heures, elle évacuait Mattexey sous « un bombardement épouvantable » et refluait, sans que son chef puisse compter la rallier à moins de plusieurs kilomètres en arrière.
(1) 5 km sud de Gerbéviller.
Vers 14 heures, les combattants de la 3e division bavaroise et de la 31e division prussienne pouvaient à bon droit s'estimer vainqueurs.
Il n'en était rien : depuis 9 heures environ, la 32e division française était maîtresse des hauteurs d'Einvaux qui, à 4 kilomètres au nord de Rozelieures, dominent le pays jusqu'à Gerbéviller. Elle avait débouché à 4 heures de la falaise au nord-est de Bayon, avait franchi sans rencontrer de résistance le vallon qui sépare celle-ci des hauteurs d'Einvaux et ne s'était arrêtée que parce qu'elle n'avait pas l'ordre d'aller plus loin. De là, elle avait à sa merci les arrières de la 3e division bavaroise. Le commandant du IIe corps bavarois n'en fut informé que tardivement. Mais, alors, son inquiétude fut extrême. Que les Français poursuivent leur avance au-delà d'Einvaux, il n'avait rien pour les contenir.
D'ores et déjà ses communications avec Mont-sur-Meurthe et Lunéville étaient coupées. Il était sans liaison avec sa 4e division. Bien que le récit du Service Historique allemand soit singulièrement discret sur ce qui s'est passé alors à son état-major, il n'est pas douteux qu'un vent de panique y souffla. Il en appela à son commandant d'armée : celui-ci n'avait rien de disponible à portée. Vers 14 heures, il décida de rompre le combat de la 3e division et de la replier, ainsi que l'artillerie de corps et ses convois, derrière la Mortagne par Gerbéviller. L'opération était délicate. Sans doute le commandant de la 3e division disposait-il de quelques réserves qu'il put faire remonter face aux hauteurs d'Einvaux, tandis que les unités engagées se maintenaient provisoirement sur place pour couvrir la retraite de l'artillerie et que la 31e division prussienne, prévenue de l'infortune de sa voisine, suspendait son offensive et s'installait défensivement à quatre ou cinq kilomètres au sud de Gerbéviller pour assurer le franchissement de la rivière.
Par chance, ce ne fut qu'après 15 heures que la 32e division française reçut l'ordre de reprendre son mouvement en avant. Elle ne s'y conforma sans doute qu'avec prudence. Vers 17 h 30, elle atteignit Morviller, à 4 kilomètres de Gerbéviller sans avoir pu intercepter la route de Damas à Gerbéviller, d'importance capitale pour la retraite de l'ennemi.
La 3e division bavaroise maintient son front jusqu'à la fin de la soirée. Ce n'est que vers 19 heures que l'infanterie de la 74e division française, s'étant avancée de l'éperon de Borville avec l'appui d'une puissante artillerie, d'une part, le 2e bataillon de chasseurs, le 27e d'infanterie de la 15e division, les cyclistes du corps de cavalerie et de la 6e division de cavalerie, jaillissant du bois de Lalau et de Saint-Boingt d'autre part, entrèrent à Rozelieures encombré de cadavres.
À cette heure, les 15e et 16e divisions françaises, qui avaient suspendu leur mouvement de retraite vers 16 heures à la suite du changement d'attitude subit de l'ennemi, avaient regagné dans l'ensemble leurs positions du petit matin. Leurs régiments exténués, après leurs lourdes pertes de la journée ne possédaient plus, dans bien des cas, qu'un fantôme d'encadrement.
Pendant que ce drame se jouait à la 3e division bavaroise, la 4e, complètement isolée et répartie sur un grand front, avait été attaquée par le 15e corps français au sud de Damelevières, culbutée et rejetée en désordre sur le pont de Mont-sur-Meurthe. La panique avait gagné Lunéville, que tous ses occupants évacuaient précipitamment, embouteillant les routes.
Sur la rive est de la Mortagne, en revanche, la 42e division prussienne du XXIe corps, et la 26e division du 13e corps français s'étaient affrontés toute la journée avec une égale vigueur, mais sans grands résultats. Le soir, à l'annonce des déboires des Bavarois, le commandant du XXIe corps avait ramené sa 42e division à hauteur de la 31e.
« Heures lourdes ! Troupes complètement épuisées ! » écrivait Ruprecht. Le IIe corps bavarois n'était pas son seul souci. Ce qui se passait au nord de la Meurthe ne l'angoissait pas moins.
Dans ce secteur, les Français s'étaient portés en avant dès l'aube. Or la situation du groupement de Gelbsattel était alors des plus précaires. Gelbsattel avait retiré du front, dans la nuit, le IIIe corps bavarois pour le mettre en réserve en vue de contre-attaques éventuelles. Il ne restait en ligne au nord du Sanon que les 4e et 8e divisions d'ersatz et, au sud, la division de cavalerie bavaroise. La 11e division du 20e corps français attaquait entre le Sanon et la forêt de Vitrimont droit sur Lunéville ; l'autre division du 20e corps, la 39e, au nord du Sanon ; le 2e groupe de divisions de réserve à gauche.
Avant que les Français aient pu prendre le contact des positions allemandes, Gelbsattel avait eu le temps de renforcer son front par l'engagement de son IIIe corps bavarois et d'alerter Ruprecht. Celui-ci dépêcha aussitôt à Gelbsattel le ler corps bavarois de réserve, déjà parvenu la veille à proximité de Lunéville, des bataillons isolés prélevés sur le blocus de Manonviller, une division de Landwehr, les 7e et 8e divisions de cavalerie enlevées au XXIe corps, le lei corps d'armée bavarois demandé à la VIIe aimée, la division d'ersatz de la Garde, alors près de Blamont, à 30 kilomètres de Lunéville.
Grâce à l'engagement du III' corps bavarois, le 20e corps français allait s'épuiser toute la journée dans une suite d'attaques et de contre-attaques acharnées. Si la lle division devait rester le soir, au prix de pertes cruelles, maîtresse du terrain, la 39e était rejetée finalement en deçà de sa base de départ. Le 2e groupe de divisions de réserve échoua devant les 4e et 8e divisions d'ersatz et se replia, mais celles-ci, qui voyaient le feu pour la première fois, démoralisées par l'artillerie française, lâchèrent pied en direction d'Arracourt, laissant le front dégarni jusqu'à l'intervention, des heures plus tard, de la 10e division d'ersatz, qui avait fait demi-tour sur la route de Metz pour marcher au canon.
La bataille devant Lunéville avait duré toute la journée. L'engagement du 1er corps bavarois de réserve, mélangé avec la 4e division refluant en désordre par le pont de Mont-sur-Meurthe sous la pression du 15e corps français, avait couvert les abords de Lunéville en flammes, en proie à la panique, encombrée d'équipages, de fuyards et de blessés.
La nuit avait mis fin à la bataille sans que les Français aient obtenu de résultats notables. Mais, dans l'état d'épuisement et de désorganisation où étaient ses troupes, Gelbsattel avait tout à redouter pour le lendemain. Aussi décida-t-il d'opérer dans la nuit un repli général de trois ou quatre kilomètres, en vue de reconstituer son front, en couvrant toutefois Lunéville et la route capitale de Lunéville à Dieuze. Le pire avait été évité.
Aux deux ailes, les 8e et 20e corps, au prix des plus lourds sacrifices continrent par leurs attaques les efforts divergents de la VIe armée allemande. Grâce à eux, le 16e corps put avancer rapidement au centre même du dispositif imprudemment dégarni du 1 le corps bavarois et forcer la vie armée allemande à un repli général.

(26-27 AOUT)
Les opérations du 26 août
Au sud de la Meurthe, les Français, fort fatigués, s'étaient arrêtés au soir du 25. Quelques tentatives de poursuite par leur cavalerie s'étaient vite interrompues.
La nuit, lit-on dans l'historique allemand, avait été marquée par « une extrême nervosité ». La 3e division bavaroise, l'artillerie et les convois du IIe corps bavarois, avaient pu s'écouler, non sans désordre, partie par le pont de Gerbéviller, partie par celui de Lamath, sous le couvert de la 31e division. Ce n'est qu'à la fin de l'après-midi du 26 que le IIe corps bavarois s'était retrouvé reconstitué, à mi-chemin entre Mortagne et Meurthe, avec une couverture très étirée sur la rive est de la Mortagne. La 4e division l'avait rejoint par le pont de Mont-sur-Meurthe, la partie est de la forêt de Vitrimont et le nord de Lunéville. Le corps d'armée avait pu recevoir vivres et munitions dont il était privé depuis deux jours, et dénombrer ses pertes. Il était réduit à 12 000 hommes et trois de ses généraux avaient été blessés. Toute la journée on avait redouté d'être attaqué avant de se retrouver en garde et Ruprecht avait été si inquiet que les 7e et 8e divisions de cavalerie, déjà exténuées par leurs allées et venues, avaient été déployées en repli éventuel derrière le IIe corps bavarois, sur la rive nord de la Meurthe. Mais les troupes françaises n'avancèrent qu'avec circonspection. Le 15e corps, débouchant par Mont-sur-Meurthe, vint se buter, aux lisières est de la forêt de Vitrimont, contre le 1er corps bavarois de réserve ; le 16e corps vint s'aligner sur la Mortagne de part et d'autre de Gerbéviller ; quant au 8e corps, il n'atteignit la rivière que le 27, à quelque six kilomètres plus au sud, et s'établit de part et d'autre, en liaison avec le 13e, au nord-ouest de Rambervillers, en face du XXIe corps prussien.
Au nord de la Meurthe, le 20e corps et le 2e groupe de divisions de réserve avaient eu la surprise, le 26 août au matin, de constater la disparition de l'ennemi. Ils avaient prudemment repris leur progression et, à quelques kilomètres, décelé les nouvelles positions où les troupes de Gelbsattel s'étaient déjà enterrées. Ils n'étaient pas en mesure d'en tenter l'attaque. Des deux côtés on était à bout.
Un moment, Ruprecht redouta que des forces françaises transportées de Haute-Alsace (le 7e corps d'armée sans doute) débarquent vers Toul et Nancy et viennent déborder sa droite, complètement découverte, en direction de Château-Salins, et il poussa vers Delme, pour parer à ce danger imaginaire, ses divisions de cavalerie déjà à bout de souffle.
Ruprecht en ces trois jours, avait vécu de lourdes heures. Un moment, le 25 au soir, il avait envisagé un repli général de son armée vers le nord en vue de retrouver sa liberté d'action et de repasser ensuite à l'offensive. Il y avait renoncé par crainte des conséquences morales sur la troupe et l'opinion publique.
Il remâchait son échec. C'en était fait de la manoeuvre napoléonienne qu'il s'était laissé imposer. « J'étais trop optimiste, s'avouait-il, je surestimais la grandeur de notre succès ».
Le 26 à midi, il informa le commandement suprême, sans rien dissimuler, de la gravité de la situation. La marche vers le sud devait être abandonnée. Il fallait se résoudre à la défensive. A 20 h 45, Moltke lui donna son accord.
La nuit fut calme. Le 27 août dans la journée, le Kronprinz de Bavière annonça au Commandant Suprême qu'il estimait la crise terminée et l'équilibre assuré.
Ruprecht avait abandonné pour un temps toute velléité offensive. Von Heeringen, en revanche continua ses attaques. Rencontrant chez Dubail une détermination égale, il dut s'avouer incapable de progresser directement sur Rambervillers et tenta de faire tomber la ville à revers par le col de la Chipotte et les cols au sud. Ces attaques partielles sur un terrain difficile n'aboutirent pas et n'empêchèrent même pas le général Joffre de transporter le 21e corps en Champagne à temps pour qu'il prenne part à la bataille de la Marne.
Le commandant en chef français avait voulu, avant de signer l'instruction générale n° 2 qui, au lendemain de la défaite des frontières, portait en germe la manoeuvre de la Marne, être délivré de tout souci par son aile droite mise à mal à Morhange. C'est le 25 août à 22 heures, au reçu du coup de téléphone victorieux de Castelnau, qu'il l'avait signée.
À quoi fut due la Victoire française ?
D'abord, sans aucun doute, à l'esprit offensif et à l'énergie des généraux de Castelnau et Dubail, et au coup d'œil avec lequel ils surent discerner et exploiter l'occasion qui se présentait à eux.
Sans doute aussi à l'abnégation de leurs troupes qui, malgré l'influence déprimante d'une grande défaite, les pertes subies, l'hécatombe de leurs cadres, leur épuisement physique au lendemain d'une retraite précipitée, retrouvèrent, au signal de leurs chefs, leur courage et leur résolution.
Mais aussi, et pour une part essentielle, à ceux qui donnèrent à Castelnau et à Dubail cette occasion inespérée : les grands chefs allemands, le commandant de la VIe armée et le commandant en chef lui-même. On a peine à croire à l'imprudence commise, sous la pression de von Moltke, par le Kronprinz de Bavière, en lançant son Ile corps bavarois et son XXIe corps vers le Sud sans données sérieuses sur la situation de l'ennemi, sans reconnaissances ni découverte par la cavalerie, sans couverture raisonnable du flanc droit.
Une présomption aveugle, la crainte d'être mal jugé s'il ne passait pas outre à ses propres réticences et son mépris a priori de l'adversaire peuvent seuls expliquer ces inconséquences. Onze jours plus tard, dans des circonstances analogues, mais dans d'autres proportions, les mêmes causes produiront les mêmes effets.
Cette bataille du 25 août est englobée dans l'ensemble des opérations qui, sous le nom de « bataille de la Mortagne », se déroulèrent en Lorraine entre le 21 août, lendemain de la bataille de Morhange, et le 11 septembre, repli des Allemands sur la frontière. Elle méritait une dénomination particulière. Le nom de Lunéville eût été justifié, cette ville ayant été au centre du champ de bataille, car on ne saurait dissocier les combats du nord et du sud de la Meurthe. Certains ont voulu lui donner le nom de « bataille de Rozelieures ». Il est inadéquat ; les combats devant Rozelieures n'ont constitué en effet qu'un glorieux épisode sans influence déterminante sur le sort de la journée.
On a dit souvent, d'autre part (1), que le Kronprinz de Bavière avait pour but, le 25 août, de franchir la Moselle entre Châtel et Bayon et de se porter en direction de Neufchâteau par la « trouée de Charmes » - dénomination donnée par Séré de Rivière au pays compris entre les places de Toul et de Belfort. Cette assertion est, on l'a vu, inexacte. L'idée, il est vrai, hantait l'état-major de Moltke. Dans la journée du 25 août, des officiers du grand quartier général étaient venus à Dieuze apporter au Kronprinz de Bavière une instruction en vue de la rupture du front français entre Toul et Epinal et de la jonction de la VIe armée, à l'ouest de Toul, avec la Ve armée du Kronprinz impérial. Ruprecht avait alors d'autres soucis... Le 27 août dans son « Instruction générale pour la suite des opérations », Moltke prescrivit à la VIe armée « au cas où l'ennemi reculerait » de franchir la Moselle entre Toul et Epinal en direction de Neufchâteau ». Mais « l'ennemi » n'a pas reculé...
(1) Et sans doute le général de Castelnau le croyait-il le 25 août 1914.
Général Jacques HUMBERT
| Haut de page |
N° 395 - 2e trimestre 1989
Dans le n° 392 de la Revue du « Souvenir Français » nous annoncions le décès du Colonel Winsback, président du Comité de Pierrefontaine-les-Varans et de Vercel dans le Doubs. C'est l'occasion d'évoquer la mémoire de la Société des Dames de Metz, dont son arrière-grand-mère Madame Winsback, avait éte l'une des plus dévouées. En voici l'histoire qui mérite que nous en conservions le souvenir.
Immédiatement après la guerre de 1870, les Allemands ont couvert les champs de bataille, particulièrement autour de Metz, de monuments magnifiques, élevés à la mémoire de leurs victimes, mais surtout à la gloire des armées allemandes, dont ils perpétuent le souvenir.
Une loi du 2 février 1872 pose la règle de la création et de l'entretien de ces monuments et des tombes qu'ils recouvrent.
Cependant, les femmes de Metz n'avaient pas attendu pour s'émouvoir de l'état d'abandon des tombes françaises autour de Metz ; leur piété et leur patriotisme s'étaient consacrés à ces soins et, dès 1875, il s'était formé une Société des Dames de Metz pour l'entretien des tombes. Madame Aldophe Bezanson, née Elisabeth de Viville, belle-sœur de M. Paul Bezanson, maire de Metz en 1870, fut la créatrice de cette œuvre et y consacra tout son temps, ses forces et son cœur. En 1876, elle groupa autour d'elle, afin de l'aider dans son œuvre, des collaboratrices dont nous ne citerons que : Madame Metzinger, veuve d'un sous-intendant militaire ; Madame Winsback, femme du docteur Ernest Winsback, qui s'était dévouée dans les ambulances ; Madame Charles Quentin, qui donna toute son active jeunesse à l'œuvre ; enfin, Mademoiselle Aubertin, fille du Colonel d'artillerie, vétéran du Premier Empire, mort à Metz en 1853.
La Société nationale d'encouragement au bien décerna, dans sa séance du 21 juin 1903, présidée par M. Loubet, Président de la République, une médaille d'or à Madame Bezanson et une médaille de vermeil à chacune de ses quatre collaboratrices, pour reconnaître le dévouement de ces femmes de cœur qui se sont vouées à une œuvre digne de leurs âmes généreuses.
Il serait trop long de donner les noms de toutes les dames messines qui se sont consacrées à cette œuvre. De 1871 à 1873, Madame Bezanson fut seule, puis elle groupa autour d'elle une dizaine de dames, dont Mesdames Winsback, Metzinger, Gilbrin, Pigeon, et fut nommée la première présidente du Comité. Elle céda la présidence à Madame Winsback en 1903. Les 7 septembre 1907, Mademoiselle Aubertin a été élue présidente du Comité formé de six dames.
La Société des Dames de Metz eut pour premier objet l'entretien du monument élevé à l'île Chambière, par le Conseil municipal de Metz, à la mémoire des 7203 soldats français morts dans les ambulances de Metz en 1870 et 1871. Ce monument avait été inauguré le 7 septembre 1871, avec une pompe solennelle, par le dernier maire français de Metz, M. Paul Bezanson, entouré de toute la population. Il avait été béni par le vénérable Évêque de Metz, Monseigneur Dupont des Loges. Tous les ans, à la même date, une messe était célébrée à la cathédrale. En 1885, Monseigneur Dupont des Loges, un an avant sa mort, voulant laisser son empreinte patriotique dans la ville où il avait conservé le dépôt du souvenir de la France, fondait un service solennel et perpétuel qui chaque année réunit, le 7 septembre, les vieux Messins groupés à la cathédrale autour de la Société des Dames de Metz.
Du cimetière Chambière, la Société des Dames de Metz étendit sa sollicitude au cimetière de l'Est, où elle éleva un monument, et aux tombes du cimetière de Saint-Simon.
Elle entraîna par son exemple les hommes de bonne volonté et inspira l'action de François-Xavier Niessen qui aboutit en 1887 à la fondation du « Souvenir Français ». Cette association continua et étendit à toute la Lorraine et à l'Alsace l'activité des Dames de Metz.
En 1908, dans ce cadre patriotique, Monsieur Jean-Pierre Jean fit ériger à Noisseville à côté de Metz un monument dédié : Aux Soldats Français tombés glorieusement au Champ d'Honneur.
L'inauguration de ce monument a donné lieu à des cérémonies imposantes où des photos ont été prises. Sur l'une d'elles on voit assises au premier rang Mesdames Winsback, Bezanson, Aubertin et Quentin, représentant le Comité des Dames de Metz. Ce sont alors 4 dames âgées attendrissantes dans leurs vêtements de l'époque, 30 ans après les temps héroïques où elles se dépensèrent sans compter.
Madame Ernest Winsback née Verbrugghe était d'origine belge et est devenue française (et quelle française !) par son mariage avec le Docteur Ernest Winsback qu'elle soutint et aida tout au long de sa carrière tant médicale que politique (à partir de 1880 il fut conseiller général et conseiller municipal de Metz). Il mourut à Nancy en 1905 entouré du respect et de l'affection de ses compatriotes.
Madame Winsback survécut 25 ans à son mari et mourut le 9 juin 1931 à 90 ans. Elle était titulaire de la Médaille des Combattants de 1870 et de la médaille de la Reconnaissance Nationale.
Elle restera comme un exemple pour toutes les femmes de France par son dévouement au service des autres et par les sentiments patriotiques qu'elle a su insuffler à sa descendance.
| Haut de page |
N° 397 - 4e trimestre 1989
Monsieur Marcel Chancé de Saint-Quentin, un ancien combattant de 1914 - 1918 précise les conditions dans lesquelles le caporal-clairon Pierre SELLIER a sonné le « cessez le feu » au cours des premiers contacts pour l'armistice du 11 novembre 1918.
Nous reproduisons ci-après un extrait des indications que fournit Monsieur Marcel Chancé.
Que s'est-il passé le 7 novembre 1918 ?
À 20 h 20 à Haudroy se présentent aux avant-postes du 171e R.I. plusieurs voitures allemandes tous phares allumés. Sur la première un porte-fanion avec un immense drapeau blanc. Un Allemand sur le marchepied sonne de la trompette. Le lieutenant Hengy, commandant la 3e compagnie du 17e R.I., muni d'une lampe de poche fait signe de stopper. Auprès de lui, le capitaine Lhuillier, commandant le 1er bataillon du 171e R.I., dans la lumière des phares, lève puis abaisse le bras. Les voitures allemandes s'arrêtent.
De la voiture de tête descend un officier qui demande le commandant des avant-postes. De la deuxième voiture descend le général von Winterfeld. Le chef de bataillon se présente : « capitaine Lhuillier ». Le général allemand, en un français impeccable, s'excuse du retard causé par le mauvais état des routes. Il veut présenter les membres de sa mission. « Général, répond Lhuillier, je n'ai pas qualité pour vous recevoir. Veuillez remonter en voiture et me suivre ». Le capitaine Lhuillier prend place dans la première voiture, appelle le caporal-clairon Pierre Sellier et lui donne l'ordre de sonner le cessez-le-feu. Le caporal-clairon Sellier, de pied ferme, exécute la sonnerie et prend la place du trompette allemand sur le marchepied de la première voiture. Dès la mise en route du convoi il sonne le garde-à-vous et les refrains des unités d'infanterie de la 166e D.I., 171e R.I., 19e et 26e bataillons de chasseurs. Ces sonneries sont répercutées par les autres clairons du secteur de la 166e D.I. Il a été convenu avec la mission parlementaire officielle ennemie que la suspension d'armes notifiée n'était valable que jusqu'à minuit. A partir de minuit les deux adversaires reprennent leur liberté d'action complète. Ainsi ce premier cessez-le-feu est-il limité dans le temps. Et il ne concerne que le secteur de la 166e division.
Marcel CHANCÉ
| Haut de page |
N° 411 - 2e trimestre 1993
Ils avaient voyagé toute la nuit, serrés l'un contre l'autre, dans des conditions dépourvues de confort.
Leurs vieux corps habitués à une vie régulière n'avaient pu trouver le sommeil et, partis la veille à midi de leur petit village des Pyrénées, ils offraient à l'aube froide, leurs visages tiraillés de fatigue.
Inexpérimentés, ils avaient mal organisé leur voyage, s'étaient trompé de train, avaient dû attendre dans des gares inconnues d'eux, des convois qui ne venaient pas.
« Nous serons là-bas dans la matinée, vers dix heures » venait de calculer, une fois de plus, le vieil homme.
Sa compagne s'impatientait davantage au fur et à mesure que le soleil sortait de la couche de brumes qui l'enveloppait. Ses mains s'agitaient autour de son cou pour y chercher la chaîne d'or où s'accrochait une montre ancienne dont les heures semblaient dormir sur le cadran.
« Nous n'arriverons jamais ! Comme c'est long. »
Enfin, voici les coteaux de Champagne, et la grande cité : REIMS.
Ils l'ont vue il y a quinze ans, la ville mutilée qui se reconstituait avec une étonnante vitalité. Puis ils l'ont revue dix ans plus tard. La visite d'aujourd'hui sera la dernière.
Un autocar les emmène à la Maison Bleue où s'étendent les champs des morts de la Grande Guerre. C'est là, dans le cimetière français, qu'ils sont venus s'agenouiller deux fois seulement en vingt ans - car leurs ressources plus que modestes ne permettent aucune dépense qui ne soit pas vraiment indispensable - sur la tombe de leur fils unique mort au champ de bataille, en Champagne, à l'âge de 23 ans.
Cette année, ils avaient voulu, d'un commun accord, que la fête de la Toussaint les vit auprès de leur enfant. Un secret avertissement leur avait dicté ce départ, comme un ordre d'adieu définitif. Ils vieillissaient, leurs membres faiblissaient, leurs yeux n'assisteraient plus jamais, peut-être, à la nostalgie naissante d'un jour de Toussaint où la nature, avant de s'endormir, se pare de toutes ses somptuosités.
Ils avaient emporté, dans un panier, des plantes de leur jardin, celles-là mêmes que François, le petit comme ils disaient encore, avait semées, puis soignées jadis.
D'autres fleurs, plus fraîches, dont ils venaient de faire l'acquisition, chargeaient leurs bras.
L'immense cimetière aux innombrables croix de bois semblaient les regarder venir par ses grilles grandes ouvertes et, à sa vue, les vieux, empoignés jusqu'au fond de l'âme, vacillèrent sur leurs jambes débiles et n'avancèrent plus.
De la terre mouillée montaient des senteurs végétales puissantes et saines, comparables à l'odeur humaine qu'avait exhalée, jadis, cette multitude d'hommes, jeunes et vigoureux pour la plupart.
Le vieux venait de fermer les yeux et voici que les longues allées de tombes se transformaient en sillons, chaque croix disparaissait et, à sa place, surgissait un paysan de son village qui, à la volée, semait la graine dans ce champ sans limites. Son garçon était là au premier rang, lui souriant de toutes ses dents et lui criant : « La moisson sera belle, père ! »
Il releva les paupières. L'odieuse réalité se dressait devant lui et il dut se retenir à sa compagne pour ne pas tomber.
Elle avançait, hésitante, le regard si brouillé de larmes qu'elle n'y voyait plus. « Te rappelles-tu encore où c'est ? Il y en a tant et tant ! C'est à s'y perdre ! »
Alors le vieux sortit de son calepin le plan où s'inscrivait l'emplacement de « sa croix ».
« C'est là, tu vois ? Allons vers la gauche, puis ce sera au bout de la rangée. »
Tant de fois, ils avaient contemplé ce plan, les soirs de tristesse où ce leur était un besoin d'invoquer leur garçon, de voir quelque chose qui leur parlât de lui... ne fût-ce que deux traits d'encre sur un chiffon de papier.
Maintenant ils étaient arrivés au terme du voyage.
À côté d'autres tombes où des femmes seules, des familles, des enfants se penchaient, s'agenouillaient, voici qu'elle paraissait, elle, la petite surface de terre qui recouvrait le corps aimé. Un lambeau de crêpe que la pluie avait verdi ceignait le bois, et, en dessous, le nom. Tout ce qui reste de lui, le distinguait de ses frères d'infortune dans cette mer de croix si pareilles qu'elles semblaient anonymes.
Ensemble, ils l'énoncèrent tout haut, comme si, de le nommer, cela allait ressusciter le mort : « François FORTSAL... »
L'émotion étreignait leur cœur, remontait à la gorge, et ils ne purent achever de lire.
Cassés en deux sur le tertre, ils disposaient leurs fleurs, s'adressant chacun à part soi, au disparu.
La vieille dame s'obstinait à le revoir bambin, le vieillard le recréait homme à l'époque où il devenait son compagnon de travail.
Elle murmurait : « Mon petit ». Il disait : « Mon garçon ».
À présent, les heures passaient trop vite. Ils ne pouvaient se résoudre à partir. Avoir rêvé si longtemps à ce voyage, en avoir fait la raison de vouloir vivre encore, avoir sacrifié leurs dernières économies pour l'accomplir, et voir s'évanouir si vite sa réalisation !
Ils avaient eu beau vaquer de-ci, de-là, auprès du petit jardinet, occuper leurs membres et leur esprit, circuler dans les allées voisines où la détresse des autres ne les consolait pas de la leur, cette station debout prolongée avait usé leur résistance.
L'air fraîchissait, les visiteurs s'en allaient, le cimetière perdait, avec le soleil déclinant, sa sérénité de ce matin. Les morts semblaient mourir une nouvelle fois, rentrer dans l'effacement, dans l'oubli et le grand repos dont les vivants les avaient tirés quelque temps.
L'instant de l'adieu était venu. Une marée de pensées déferlait dans le cerveau des vieux, mais les mots pour les traduire restaient noués dans leur gorge.
Cependant il fallait bien lui dire, au petit, que... c'était fini... qu'on ne reviendrait plus jamais, que c'était la dernière fois qu'on se retrouvait ainsi face, à face, lui... sous la terre et eux, penchés vers lui pour lui parler.
« Allons », encouragea la vieille dont la lèvre inférieure tremblait « dis-lui adieu pour nous deux, toi : moi, je ne pourrai pas, je n'aurai pas la force. »
Et le vieux commença :
« Mon garçon... je puis bien te le dire à présent, puisque c'est notre dernière visite, cela a été dur de vivre. Maintenant, ta mère et moi sommes bien vieux, notre carrière est achevée et bientôt nous irons te retrouver pour toujours. Nous n'avions que toi. Nous t'aimions tant ! C'est donc « ADIEU » qu'il nous faut te dire aujourd'hui. « Adieu mon enfant, mon fils... mon tout petit... »
Sa compagne faiblissait de plus en plus sur ses jambes et elle ne savait plus que répéter avec lui : « Mon tout petit... » Elle eût voulu embrasser le sol qui, plus heureux qu'elle, l'enveloppait depuis si longtemps. Elle eût voulu surtout emporter le tertre tout entier, ou prendre n'importe quoi, quelque chose qui fut un peu de lui.
Ses yeux affolés cherchaient, mais rien ne s'offrait à eux. Rien. La tombe était aussi pauvre que le mort. C'est alors qu'elle se baissa et que sa main ouverte se referma avec avidité.
Maintenant, c'était fini... plus jamais ils ne verraient la croix de bois où s'inscrivait le nom de leur garçon. Plus de projet à faire, plus d'espoir... sinon dans l'au-delà.
En trébuchant, comme pris d'ivresse, ils s'en allèrent. Les tombes semblaient former une ronde macabre autour d'eux et ils ne se retrouvaient plus.
Le vieux avait pris les devants, les yeux si troubles qu'ils apercevaient mal la grille de l'entrée et la prenait pour d'hallucinants fils de barbelés.
La vieille le suivant de près, dodelinant de la tête et serrant entre ses doigts crispés... quelque chose de lui, du petit... une poignée de la terre humide et odorante prise au jardinet qui recouvrait son corps.
Récit recueilli par L. ROTURIER dans les archives de son père,
combattant de 14-18, la Somme, l'Artois, Verdun.
| Haut de page |
N° 415 - 2e trimestre 1994
DE L'AVIATION DE RECONNAISSANCE,
EN SOUVENIR DES AVIATEURS DE 14-18...
ET DE BIEN D'AUTRES
 Lieutenant Paul Louis WEILLER, chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre Military Cross |
Malgré de tels états de service, Paul Louis WEILLER ne connut certes pas auprès du grand public de l'époque la renommée qui fut celle des GUYNEMER, FONCK, NUNGESSER, MADON et d'une façon plus générale des « chasseurs » admis dans la cohorte prestigieuse des « As de guerre » dès lors que leur nom avait figuré au moins cinq fois au communiqué officiel pour victoires aériennes homologuées. Les combats aériens, par les exploits individuels et souvent l'esprit de chevalerie qu'ils révélaient, faisaient contraste en effet avec l'anonymat de cette épouvantable guerre des tranchées dont nos fantassins eurent tant à souffrir. Ainsi s'explique sans doute l'engouement du public de l'époque pour les prouesses des As de guerre, en oubliant parfois non seulement les innombrables chasseurs qui n'étaient pas classés de la sorte mais aussi les équipages du bombardement et de l'aviation d'observation qui combattaient pourtant avec la même ardeur, encourant les mêmes risques et au prix des mêmes sacrifices. Paul Louis WEILLER connut d'ailleurs la plupart de ces As et notamment FONCK (127 victoires probables dont 75 homologuées) « chasseur superbement doué qui, par sa décision rapide et son talent au tir, mérite sans doute d'être appelé le plus grand » (1). Même s'il fut nommé plus tard membre honoraire de l'association des As de guerre en reconnaissance de ses services exceptionnels... et des quatre victoires obtenues en se défendant contre des chasseurs allemands, Paul Louis WEILLER est surtout connu pour avoir donné une impulsion décisive au développement de l'aviation d'observation et de reconnaissance. Centralien, passionné très tôt par les « aéronefs » - il reçut son baptême de l'air en 1908 à Villacoublay - Paul Louis WEILLER fut affecté en 1914 dans une unité d'artillerie où il eut tout de suite l'occasion de voler pour des missions de réglage de tir avant d'être lui-même breveté pilote (janvier 1915) et de recevoir sa première affectation en escadrille, la « V 21 » (2).

(1) Extrait d'un article de Paul Louis WEILLER lui-même paru dans la revue "Azur et or" de l'Association Nationale des Officiers de Réserve de l'Armée de l'Air (A.N.O.R.A.A.) de janvier 1992.
(2) Les escadrilles étaient désignées à l'époque par une lettre, ou un groupe de lettres, et un numéro. La lettre était l'initiale du type d'appareil dont l'escadrille était équipée. Ainsi V pour avion du type "VOISIN", SPA pour avion du type "SPAD" et C pour "CAUDRON", etc.
Dès le départ, Paul Louis WEILLER mit en évidence les possibilités nouvelles offertes par l'aviation d'observation dont il s'efforça de perfectionner les équipements et les conditions d'emploi. Ainsi fut-il le premier à avoir l'idée d'utiliser la photographie aérienne pour réaliser des cartes d'état-major fiables, ayant souvent constaté de grandes différences entre les cartes dont il disposait et ses propres observations du terrain. Ses méthodes de cartographie, définies dès janvier 1915 devaient être adoptées ensuite par le service cartographique des armées.
Un peu plus tard, il contribua beaucoup, avec d'autres, au développement de l'utilisation à bord des avions de la « Télégraphie sans fil (T.S.F.) » pour les missions de réglage d'artillerie. Enfin, s'appuyant sur sa propre expérience des reconnaissances profondes acquise tout au long de l'année 1917, il réussit à persuader le grand quartier général de créer un groupe d'escadrilles de « grande reconnaissance » destiné à opérer dans la profondeur des lignes allemandes - jusqu'à 100 km - afin de relever par la photographie les indices de préparation des actions allemandes.
Ainsi naquit en juillet 1918 le Groupement WEILLER composé de trois escadrilles de Bréguet XIV et d'une section spécialisée pour les vols de nuit, groupement qui marque l'entrée en scène de la « reconnaissance stratégique » et dont Paul Louis WEILLER définit le concept d'emploi - vol de groupe notamment, voire vols à très haute altitude - ainsi que l'armement même des appareils pour leur auto-défense. Grâce aux couvertures photo systématiques réalisées journellement, ce groupement eut un rôle très important tant dans la préparation que dans la conduite des grandes offensives de 1918, Paul Louis WEILLER, alors capitaine, traitant le plus souvent directement, pour l'emploi de son unité, avec le général WEYGAND, chef d'état-major du généralissime FOCH !
Une telle collaboration directe entre officiers si différents en grades peut surprendre aujourd'hui. Elle ne fut pas rare à l'époque. Les spécialistes de l'aéronautique, c'est-à-dire les aviateurs qui avaient l'expérience de la guerre aérienne étaient en effet en général très jeunes, tout comme l'était l'aviation militaire elle-même, née avec cette guerre. C'est ainsi que le général JOFFRE fit appel en septembre 1914 à un simple commandant, BARES, pour prendre la direction de l'aéronautique militaire aux armées : BARES était à l'époque le seul officier supérieur pilote de toutes nos armées ! C'est ainsi que le même JOFFRE, en février 1916, au début de la bataille de Verdun, confia à un commandant - DE ROSE - la mission de débarrasser le ciel de Verdun des avions d'observation allemands dont la mission était de régler les tirs de l'artillerie ainsi que des chasseurs chargés de les protéger : et le commandant DE ROSE, lui-même brillant chasseur, de recruter dans les escadrilles du front les meilleurs pilotes ; et de constituer avec eux 15 escadrilles d'élite qui devaient s'assurer de l'indispensable « maîtrise du ciel ». Verdun donna ainsi son nom non seulement à la plus grande bataille terrestre de l'histoire, mais aussi à la première bataille aérienne pour obtenir la supériorité dans la troisième dimension, notion alors toute nouvelle à l'époque et dont l'importance ne fera que croître avec le temps.
Général JOFFRE/commandant DE ROSE, général WEYGAND/capitaine WEILLER : un tel rapprochement traduit tout le poids des responsabilités confiées alors à ces aviateurs dont l'un d'eux, WEILLER, n'avait même pas encore 25 ans.
Tel fut le combattant de 14-18 auquel il nous faut rendre hommage, un hommage qui s'adresse aussi, à travers lui, à tous nos aviateurs de l'époque, qu'ils aient appartenu à la chasse, à l'observation ou au bombardement (3), hommage à ces quelques 18 500 pilotes et observateurs formés pendant ces quatre années de guerre et dont 30% - près de un sur trois - devaient périr soit au combat, soit par accident en cours de mission, ou à l'entraînement, hommage aussi aux aviateurs de la Deuxième Guerre Mondiale et à tous ceux qui se sont sacrifiés dans les combats que nos armées ont livrés jusqu'à nos jours. La liste en est longue. C'est le moment de souligner qu'en dehors des unités et des bases aériennes où le culte du souvenir est solidement entretenu, ainsi que dans les associations d'aviateurs, les monuments extérieurs commémorant les différentes étapes de l'histoire de notre aviation militaire sont peu nombreux.
Les batailles aériennes ne laissent en effet pas de traces au sol, sauf les destructions qu'elles ont pu causer... chez l'adversaire. Dans ces conditions, rares sont les monuments qui évoquent la participation de telle ou telle unité aérienne à telle ou telle grande bataille de notre histoire récente, sauf exception comme c'est le cas pour le très beau monument de Garches érigé en souvenir du Groupe de chasse LA FAYETTE (4).
(3) À la fin de la guerre, la France disposait de 258 escadrilles (3400 appareils) déployés au front, dont 126 escadrilles d'observation, 80 de chasse et 52 escadrilles de bombardement.
(4) Cf. l'article paru à ce sujet dans le numéro 401 du "SOUVENIR FRANCAIS" (4e trimestre 1990).
Le plus souvent, on trouve ici et là une stèle évoquant le sacrifice d'un pilote ou d'un équipage au combat. La plus célèbre se trouve à Poelcapelle, en Belgique, stèle - ou plutôt monument - en souvenir du capitaine GUYNEMER disparu le 11 septembre 1917 « en plein ciel de gloire » au-dessus de la ville. Chaque année autorités Air françaises et belges entourées de toute la population se rassemblent là pour commémorer la disparition de celui qui est le symbole de notre aviation militaire. Il y a aussi le monument de Rustenhardt, près de Colmar, là où fut abattu par la Flak allemande, le 4 février 1945, le commandant MARIN LA MESLEE, chasseur aux 20 victoires homologuées pendant la seule campagne de mai-juin 1940, chasseur dont le Groupe, le 1/5 « Champagne », totalisa à lui seul 111 victoires pendant cette même période de mai-juin 1940. A Paris même, au pont de Tolbiac, une plaque commémore le sacrifice d'un équipage du Groupe « Lorraine » (FAFL) - chef de bord lieutenant LAMY - qui, le 3 octobre 1943, au cours d'une mission de bombardement, choisit de diriger l'appareil gravement endommagé par la Flak vers la Seine, évitant ainsi tout risque de chute sur les habitations.
D'autres stèles, plus rares encore, rappellent le sacrifice d'un équipage ou d'un pilote, tué lors d'une mission d'entraînement, en pleine période de paix. Ainsi, si vous passez par Val d'Ajol (Vosges), au lieudit Leyval, vous trouverez en bordure d'un champ une simple pierre sur laquelle sont gravés deux noms et une date : commandant Hervé COURCELLE LABROUSSE, lieutenant Michel DUMAS, 9 janvier 1970. Cette stèle marque l'endroit où s'écrasa en pleine nuit, au retour d'une mission d'entraînement à très longue distance, un Mirage IV dont le pilote et le navigateur trouvèrent là la mort. Deux noms parmi tant d'autres...
Nous voici loin, apparemment, de Paul Louis WEILLER, je dis apparemment parce que la chaîne du souvenir est une chaîne continue, souvenir de nos aviateurs militaires morts au service de la France, souvenir aussi de ceux qui ont combattu et contribué, comme Paul Louis WEILLER, au succès de nos armes. Tant il est vrai que le souvenir de l'un rejoint celui de tous les autres.
Général (C.R.) Michel FORGET
Membre du Conseil d'Administration du S.F.
| Haut de page |
N° 425 - 4e trimestre 1996
L'année 1996 a été profondément marquée par la célébration du 80e anniversaire de la Bataille de Verdun. Notre Association y a, bien sûr, participé à Verdun comme à Paris. En ce dernier numéro de 1996, nous avons voulu évoquer un des aspects particuliers de notre action permanente, discrète (donc peu connue) et efficace, pour participer à la conservation du souvenir des " Morts pour la France " à Verdun.
1°) Rappel historique de la " Zone Rouge ".
Le 11 Novembre 1918, quand les armes se taisent, le champ de bataille de Verdun se présente comme une région lunaire, au sol bouleversé, minéralisé, entrecoupé d'une toile d'araignée de tranchées, boyaux, trous d'obus, sapes, ... et recouvert de 20 à 30 tonnes de ferraille à l'hectare. Le terrain est transformé en un immense cimetière, où restent ensevelis, dans l'argile, des dizaines de milliers de corps français et allemands (1), au milieu de nombreux projectiles non éclatés.
Neuf villages ont été anéantis pendant les combats, huit sur la rive droite de la Meuse (Haumont près Samogneux, Beaumont-en-Verdunois, Louvemont, Ornes, Bezonvaux, Douaumont, Vaux-Devant-Damloup et Fleury-Devant-Douaumont), un sur la rive gauche (Cumières).
Deux lois essentielles vont chercher à régler au mieux une situation si dramatique, sur les plans humains bien sûr, mais aussi économique et financier. La loi du 17 avril 1919 (2) fixe les conditions dans lesquelles l'État va procéder au rachat des terres devenues inhabitables et incultivables. La loi du 24 avril 1923 précise les conditions dans lesquelles les Eaux-et-Forêts reçoivent les missions de boiser ces terrains acquis par l'Etat et d'aider au reboisement des forêts communales dévastées, énorme travail portant sur plus de 13 000 hectares. C'est l'acte de naissance des deux futures grandes forêts domaniales, celle de Verdun (9 615 hectares sur la rive droite) et celle du Mort-Homme (2 884 hectares sur la rive gauche).
(1) L'Ossuaire de Douaumont, à lui seul, accueillera peu à peu les restes mortels d'environ 130 000 combattants français et allemands non identifiés, lors de leur exhumation des champs de bataille, et il est très probable que, de nos jours, des centaines de morts gisent encore, dispersés sur le terrain.
(2) Loi sur "la réparation des dommages causés par les faits de guerre".
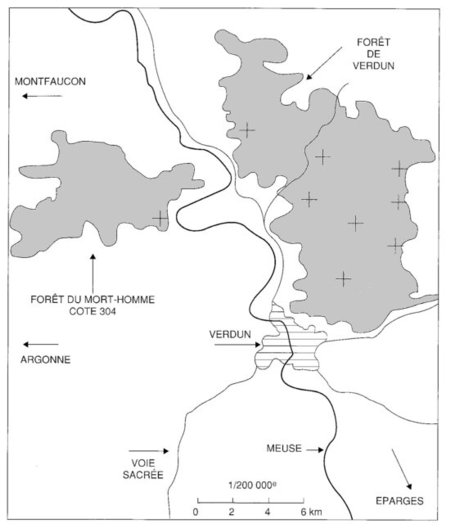 |
Nota : |
2°) Répartition des Missions.
I- L'office National des Forêts (O.N.F.), ex " Eaux et Forêts ".
- De 1929 à 1933, après des travaux préparatoires considérables (déblaiement, désobusage, exhumations, délimitation), il est procédé au reboisement des anciennes zones occupées par les villages, vergers, cultures, en Pin Noir d'Autriche (5 000 hectares) et en épicéa (3 500 hectares). Les anciens bois (un tiers de la surface) se sont reconstitués naturellement, en fournissant les taillis et perchis actuels, à base de charmes et hêtres.
- En 1974, débute la transformation en feuillus mieux adaptés aux conditions locales, par plantation de hêtres, sous l'abri des résineux, ou de feuillus précieux après coupe rase.
- De nos jours, grâce à l'action des forestiers, il est possible de revenir à la hêtraie, en moins d'une centaine d'années après la destruction des sols et de la végétation, alors que l'évolution naturelle des associations végétales n'aurait permis ce retour à la hêtraie qu'au bout de 3 ou 4 siècles. Cette transformation des résineux en hêtraie représente, dans le milieu forestier, l'un des exemples les plus remarquables au monde.
2 - L'État participe à la reconstruction, à proximité de leur ancien site, de certains villages détruits (Montfaucon d'Argonne, Bethincourt, Forges-sur-Meuse, Vauquois,...). En revanche, les neufs villages détruits de la "Zone Rouge" sont déclarés "Morts pour la France" et reçoivent la Croix de guerre avec palme, à titre posthume. Pour conserver leur souvenir, il est décidé d'ériger dans chacun d'eux une "chapelle-abri" à proximité de l'église détruite, de reconstituer un monument aux Morts et d'aménager l'ancien cimetière pour permettre à quelques anciens d'y être inhumés, près de leurs ascendants.
3 - Notre association.
Dès la fin des combats, mais plus encore après l'armistice de 1918, notre Association, sous l'impulsion de Monsieur Schleiter, Délégué Général pour la Meuse (devenu député-maire de Verdun en 1924), donne la mesure de son dévouement et de son efficacité : échange de correspondances avec 50 000 familles de morts à Verdun, entretien de près de 40 000 tombes (en attendant l'aménagement jusqu'en 1928, des nécropoles nationales), représentation des familles lors des exhumations, réalisation du jardin public à l'entrée de la Nécropole du Faubourg-Pavé et du cimetière communal de Verdun.
Après la Seconde Guerre mondiale, le manque d'entretien pendant les quatre années d'occupation, les dégâts causés par les intempéries 1 des monuments le plus souvent privés, datant déjà d'une vingtaine d'années et construits avec des crédits limités sur un wl chaotique, conduisent notre association à créer en 1949, une caisse d'entretien des monuments de la "Zone Rouge".
En 1961, le Général de Larminat, premier Commissaire général aux monuments commémoratifs des guerres et de la Résistance, découvre l'état de plusieurs monuments qui avaient besoin d'une importante restauration sous peine de disparaître, ainsi que celui des chapelles-abris condamnées au même sort, dès lors que personne ne pouvait les prendre réellement en charge. Ainsi naît le 24 novembre 1961 la première Convention liant le Ministère des anciens Combattants et notre Association, à l'égard des monuments du champs de bataille de Verdun.
En 1966, lors du cinquantième anniversaire des combats de 1916, nous éprouvons la fierté de présenter aux "Anciens" tous les monuments de la "Zone Rouge" en bon état de propreté et de conservation.
3°) Actions menées récemment par notre Association.
Le 29 avril 1994, est signée une nouvelle convention, actualisant la précédente et la rendant conforme à la réglementation en vigueur. Elle précise :
" Entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, d'une part, et l'Association "Le Souvenir Français" d'autre part.
il est convenu ce qui suit :
- article 1 : Le "Souvenir Français" accepte de pourvoir, dans la mesure du possible, à l'entretien et, le cas échéant, à la remise en état de tous ceux des monuments du champ de bataille de Verdun, ainsi que des chapelles et de leurs voies d'accès, qu'aucune autre organisation n'a plus effectivement en charge ;
- article 2 : Le "Souvenir Français" disposera à cet effet, outre de ses moyens propres, des ressources suivantes :
- les produits de ses activités de propagande locale et auprès des associations d'anciens combattants,
- les subventions allouées par les collectivités territoriales (Conseil régional, Conseil général, Conseil municipal),
- la subvention allouée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
- article 3 : Pour celle-ci, le "Souvenir Français" adressent une demande de subvention annuelle au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande sera appuyée des éléments justificatifs indiqués ci-après :
- compte rendu de l'assemblée générale du dernier exercice,
- comptes financiers du dernier exercice,
- projet de budget général,
- situation de la caisse "VERDUN" à l'intérieur du budget,
- programme des travaux envisagés pour l'année, avec devis estimatifs et plan de financement de ces travaux.
La participation financière du ministère des anciens combattants et victimes de guerre apparaîtra explicitement parmi les recettes de l'association ".
L'effort financier consenti, chaque année, par notre association mérite d'être souligné, car bien peu de citoyens français et de touristes étrangers en ont conscience, lorsqu'ils parcourent l'ancien champ de bataille de Verdun. C'est ainsi que lors des cérémonies récentes du 80, anniversaire, notre action a été passée sous silence, tout particulièrement dans la presse, à la radio et à la télévision.
| Années | Montant des travaux entre- pris par notre Association |
Subventions de l'Etat | Dépenses restant à la charge de notre Association |
| 1987 | 129 770 | 50 000 (39 %) |
79 770 (61 %) |
| 1988 | 167 645 | - (3) | 167 645 (100 %) |
| 1989 | 143 971 | - (3) | 143 971 (100 %) |
| 1990 | 116 090 | - (3) | 116 000 (100 %) |
| 1991 | 151 721 | - (3) | 151 721 (100 %) |
| 1992 | 213 000 | - (3) | 213 000 (100 %) |
| 1993 | 197 964 | - (3) | 197 964 (100 %) |
| 1994 | 132 195 | 75 000 (57 %) |
57 195 (43 %) |
| 1995 | 164 806 | 50 000 (30 %) |
114 806 (70 %) |
| 1996 | 131 630 | 66 000 (50 %) |
65 630 (50 %) |
| Total pour 10 années |
1 548 792 | 241 000 (16 %) |
1 307 792 (84 %) |
C'est ainsi que cette année, notre Association a appliqué son effort, en liaison avec le S.I.V.O.M. (4) des villages détruits en 1916 à la rénovation des chapelles-abris de Bezonvaux, Haumont près Samogneux, Louvemont-Cote du Poivre, du cimetière de Beaumont en Verdunois, du monument aux morts de Fleury devant Douaumont, et du carrefour de la chapelle Sainte-Fine.
(3) On remarquera que pendant 6 années, l'Etat n'a pas respecté les termes de la Convention.
(4) Syndicat inter-communal à vocations multiples.
4°) Un cas exemplaire.
À mi-route entre le Mémorial de Fleury et le glacis du fort de Souville, se trouve le carrefour de la Chapelle Sainte-Fine, d'où partent les routes venant de Verdun et se dirigeant vers les forts de Vaux et de Douawnont. Ce carrefour très fréquenté a son histoire qui mérite d'être rappelée.
Avant la Première Guerre mondiale, se dressait encore à ce carrefour les ruines d'une ancienne petite chapelle, dite chapelle Sainte-Fine (5). Ce carrefour fut l'objet de combats acharnés ; c'est, en effet, là que sont venues se briser les dernières vagues d'assaut Allemandes, le 23 juin 1916. Au-delà de ce carrefour, l'ennemi aurait eu Verdun sous ses yeux, ce dont il rêvait, avant de s'en emparer. Le 12 juillet, c'est la dernière attaque désespérée mais infructueuse des Allemands pour s'emparer du fort de Souville. Le 24 octobre, ce carrefour est une base de départ de la grande contre-offensive française aux ordres du général Mangin, permettant de reconquérir tout le terrain perdu et plus particulièrement les forts de Vaux et de Douaumont.
En souvenir de ces combats, ont été érigés à ce carrefour :
 |
- un sobre monument rappelant la Chapelle Sainte-Fine ; - l'imposant monument dit du "Lion abattu" (6) à la mémoire de la 130e division aux ordres du Général Toulorge, des 260e et 307e brigades, des 39e, 239e, 405e et 407e d'infanterie, du 211e d'artillerie, des Escadrons du 7e chasseurs et de la garnison du fort de Souville. |
Citons pour terminer quelques publications particulièrement utiles pour circuler dans la "Zone Rouge" et s'y retrouver sans perdre de temps :
- La carte touristique locale "Forêts de Verdun" et du "Mort Homme", au 1/25 000e (édition 1995), réalisée et éditée par l'I.G.N., avec la collaboration de l'O.N.F. et du Mémorial de Verdun ;
- Le guide vert Michelin "Alsace, Lorraine" ;
- La documentation, présentée :
- au Mémorial de Verdun
- au bureau du tourisme de la ville de Verdun.
(5) Du nom d'une petite fille paralytique morte à San Gimignano (Toscane), le 12 mars 1253, à l'âge de 15 ans.
(6) Le monument est l'œuvre du sculpteur animalier R. Paris. Les pierres du soubassement ont été prises dans les ruines de Verdun. Le "Lion mort" taillé à Neuilly dans l'atelier du statuaire a été exposé au Salon de 1922. Le monument, inauguré le 1er octobre 1922, a été, aussitôt après, confié par le comité directeur, à notre Association qui vient de le rénover entièrement.
* *
- Après la Première Guerre mondiale, apparaît sur le champ de bataille de Verdun, une "Zone Rouge", de la couleur du sang versé par 880 000 morts et blessés, français et allemands, au cours de 300 jours de combats acharnés ;
- 80 ans après ces combats, les derniers survivants et les innombrables visiteurs de toutes nationalités parcourent une "Zone Verte" parsemée de monuments et de tombes, soigneusement entretenus ;
- Notre association a patiemment et généreusement participé à cette métamorphose. N'est-il pas vrai que le vert est la couleur de l'espérance ?
| Haut de page |
N° 428 - 3e trimestre 1997
UN SOLDAT AU CHEMIN DES DAMES (*)
(*) Extrait du livre « Les chemins de l'histoire 1914-1918 ». Jean-Daniel Destemberg. Editions du Signe. Allier. 1996.
La bataille de Verdun, qui devait sonner la victoire allemande, a duré une année.
À son terme, les deux armées se retrouvent usées, épuisées, avec, au bout du compte, rien de nouveau. Du côté français, le moral reste bon, mais la guerre commence à être longue.
L'échec allemand a démontré la valeur de l'armée française et redonné un espoir aux combattants qui pouvaient douter de l'issue finale.
Les pays neutres, jusqu'alors attentifs aux événements, commencent à penser que l'invincibilité allemande annoncée n'est qu'une légende. Ils regardent maintenant les alliés avec plus de déférence. Certains vont même emboîter leurs pas dès la première occasion. La guerre va devenir une guerre mondiale.
Le front de l'Est est stabilisé. A l'Ouest, l'offensive franco-britanique sur la Somme a entaille nettement l'armée allemande.
Si nous avions eu à subir leur formidable offensive sur Verdun, c'est à leur tour de subir l'attaque de la Somme ; à leur tour, également, d'être hachés sur place dans la boue de l'automne 1916.
À la fin de l'année, l'Etat-Major français est dirigé par le général Nivelle, l'organisateur de la reprise de Douaumont.
Dans la Somme, le redressement allemand s'est effectué de façon comparable au nôtre, à Verdun.
On décide alors de porter un grand coup, et, celle fois-ci, de façon définitive : les Allemands seront raccompagnés à la frontière. Tous les moyens seront employés pour obtenir un véritable succès. On choisit la saison : le printemps 1917.
On choisit le lieu : le Chemin des Dames.
La préparation est formidable. 5 200 canons sont amenés en ligne. L'effectif de 2 armées va participer à l'offensive : les 5e et 6e armées françaises.
Le 16 avril 1917, l'attaque est déclenchée.
L'assaut initial est furieux. Les troupes progressent rapidement. Mais, au cours de la journée, le mouvement se ralentit.
L'artillerie, malgré son grand nombre, n'a pu écraser totalement les défenses allemandes. La crête du Chemin des Dames, occupée par l'ennemi, est creusée d'anciennes carrières de pierres aménagées et fortifiées. L'Etat-Major allemand, ayant appris les intentions françaises, avait préparé sa défense avec une particulière minutie C'est donc face à des réserves presque intactes que les vagues françaises vont se trouver. Le massacre est total.
Nivelle ne s'avoue pas vaincu ; il maintient l'offensive pendant 8 jours, au prix de 6 000 morts par jour. Les régiments français sont anéantis. A tel point que l'opinion s'émeut et que le président de la République, Raymond Poincaré, donne l'ordre d'arrêter le massacre.
Alors, l'action se modifie. Les régiments appelés en renfort sont dirigés vers les secteurs charnières. La stratégie s'adapte aux éléments.
Parmi ces unités de soutien, se trouve le soldat Pierre Damet du 152e RI.
Pierre Damet était né à Thiel-sur-Acolin (Allier). Je l'ai connu vers la fin de sa vie. Il habitait à Fourilles (Allier). Lorsque j'allais lui apporter quelques soins nécessaires à son grand âge, c'était prétexte à de longues conversations.
Malheureusement, et je le regrette maintenant, j'étais toujours obligé d'écourter ces entretiens, car d'autres malades m'attendaient.
Un jour, cependant, je le lançais sur un sujet qui me combla. Il me raconta son Chemin des Dames. Tout commence, pour Pierre Damet, le 13 mars 1917. Le 15-2 quitte la région de Dannemarie, en Alsace, pour subir un entraînement intensif à l'arrière du front.
Après deux mois d'instruction, il est dirigé vers le secteur du Chemin des Dames. La fameuse attaque du 16 avril n'avait pas donné les résultats qu'on attendait d'elle. La tentative de percée avait échoué, et les chars d'assaut sur qui on fondait tant d'espoir gisaient lamentablement sur le terrain. Le moral était au plus bas. Des mutineries avaient éclaté.
Il ne s'agissait plus, dès lors, que de maintenir les gains partiels obtenus, ou de les élargir sur les différents points de la crête où la profondeur de défense faisait défaut.
Ainsi, en maintenant la pression, les réserves ennemies ne seraient pas remises à disposition d'autres secteurs du front.
Le 13 mai au soir, le 15-2 s'installe en réserve de division, en arrière du Chemin des Dames. La grande attaque a été arrêtée. Seules des attaques locales sont maintenant prévues. De toute évidence, l'honneur de ces attaques semble réservé au 15-2.
Aussitôt, les reconnaissances du terrain commencent. Le colonel Barrard explore tous les recoins de son futur champ de bataille. Au bout de 8 jours, tout est prêt. L'attaque peut avoir lieu.
Elle se déclenche le 22 mai. Le régiment a pour mission d'enlever le plateau des Casemates et le Talus, afin de posséder la crête militaire nord du plateau de Vauclerc, point stratégique déterminant.
L'attaque est menée par les 1er et 2e bataillons. A 16 h 20,1e 2e bataillon du commandant Thiéry bondit sur le parapet et se rue sur ses objectifs. Dans son élan, il franchit les Casemates, surprenant ainsi le barrage d'artillerie allemand, qui ne se déclenche que longtemps après. Des petits groupes ennemis armés de mitrailleuses, de fusils et de grenades, enfouis dans des trous d'obus et disséminés, essaient de freiner l'avance française.
Les 2 compagnies de tête, la 6e et la 7e, emportées par leur élan, balaient les dernières résistances et poussent même des reconnaissances jusque sur les pentes nord du plateau.
Malheureusement, la compagnie du 334e R.I. qui devait opérer à gauche est clouée sur place dès sa sortie des tranchées.
Le 1er bataillon du commandant Toussaint, pour sa part, attaque à droite. La 3e compagnie du capitaine Flottes se porte à l'assaut à 16 h 23, franchit le tir de barrage, enlève brillamment le Talus organisé et s'installe dans des tranchées allemandes bouleversées par le tir français.
L'ennemi, qui a pu abriter ses réserves dans les nombreuses et immenses sapes qu'il a aménagées, n'est pas embarrassé pour contre-attaquer.
C'est ce qu'il ne manque pas de faire dès le 22 mai au soir. Précédée par un très violent tir à obus asphyxiants, une puissante contre-attaque est lancée. Le 2e bataillon se défend avec une énergie féroce et conserve les positions acquises malgré des pertes très importantes.
Les jours suivants, les contre-attaques recommencent. Le 15-2 ne lâche pas un bout de tranchée. Il s'y accroche avec une bravoure hors du commun.
Le harcèlement succède alors aux actions d'envergure. Le 15-2 résiste toujours et ceci pendant 9 jours.
Le 31 mai, enfin, il est relevé et envoyé au repos aux environs de Fismes. Là, les douze jours passés ne sont que des demi-vacances, car, toutes les nuits, les avions allemands viennent bombarder. Le ronflement des moteurs, le crépitement des mitrailleuses et le bruit des canons antiaériens créent une atmosphère bien peu différente de celle des premières lignes.
D'ailleurs, le l4 juin, le 15-2 remonte au Chemin des Dames. On lui a laissé entendre, toutefois, que ce n'est pas pour attaquer, mais pour tenir le secteur d'Hurtebise, secteur relativement calme.
En fait, la région du Monument est très sérieusement menacée. Comme le Monument est situé sur la crête au-dessus des lignes françaises, il est nécessaire d'organiser un dégagement de ce secteur.
L'attaque est confiée au 3e bataillon.
Rappelons en quelques mots l'origine de ce monument.
En 1814, pendant la campagne de France qui fait suite à la tragique retraite de Russie, Napoléon a livré bataille en cet endroit aux Russes, Anglais et Prussiens coalisés entre le 5 et le 8 mars 1814. Ses dernières recrues, qu'on avait baptisées les « Marie-Louise », du nom de l'Impératrice, y ont été fauchées comme les blés à la ferme d'Hurtebise. Ce fut pourtant une victoire et un Monument aux « Marie-Louise » fut élevé ultérieurement.
En 1917, malgré les tirs d'artillerie, ce monument résiste encore. Il constitue même un repaire symbolique que les Français ne veulent pas abandonner.
Le 24 juin au soir, le 3e bataillon vient prendre position pour l'attaque.
Le 3e bataillon, plusieurs fois maltraité, disloqué, reconstitué après la bataille de la Somme, se voit donc confier une mission de la plus haute importance. Employé aux tâches ingrates de ravitaillement et d'aménagement des tranchées, le 22 mai précédent, il va enfin pouvoir montrer ses capacités.
Notre témoin, le soldat Pierre Damet, appartient à ce 3e bataillon. Dans les rangs, le moral est très bon. On relève, en première ligne, le 43e B.C.P. et, au cours de la nuit, le dispositif d'attaque se met en place. Chacun attend l'heure H !
Le commandant Lacroix vient les encourager. Le secteur est difficile, certes, avec un impressionnant bouleversement de terrain, mais l'artillerie est là pour précéder l'infanterie et anéantir les défenses allemandes.
À l'heure dite, le 25 juin, les braves soldats du commandant Lacroix surgissent des tranchées de départ. L'artillerie allonge le tir.
Notre témoin, rassemblant tout son courage, se lance vers l'objectif. Tous les copains sont là. C'est une course folle vers la tranchée ennemie. L'artillerie française, qui tire sans relâche, a provoqué un nuage de fumée au travers duquel les attaquants s'enfoncent.
Mais ce nuage de fumée masque des points de résistance allemands. Lorsque nos Poilus arrivent sur la crête d'Hurtebise, les mitrailleuses les accueillent.
Le colonel Barrad, qui suit l'avance à la jumelle, voit alors ses soldats, qui fonçaient tête baissée, tomber les uns sur les autres.
Le soldat Pierre Damet continue sa course ; il n'est pas touché. Autour de lui, des vides se sont creusés mais l'assaut se poursuit. Il ne sait même plus où il est ; les ligues allemandes ne sont plus reconnaissables ; l'artillerie a tout nivelé.
C'est de trous d'obus en trous d'obus qu'il continue l'attaque. Beaucoup de copains sont encore là, il n'a pas le temps de savoir lesquels. Il court, il saute, éperdument... vers l'objectif.
Le colonel Barrard voit soudain disparaître ses hommes, au-delà du but préalablement fixé.
Emportées par leur élan, les compagnies de tête, la 10e du capitaine Thomas et la lle du capitaine Gros, ont largement dépassé la crête et atteignent alors les entrées nord de la célèbre Caverne du Dragon.
Soudain, l'artillerie allemande se réveille. Les soldats du 15-2 subissent un nouveau supplice. Décimés par le bombardement, ils se regroupent à proximité de la grotte et reprennent la lutte.
Pendant ce temps, des éléments du service de Santé du bataillon pénètrent les premiers dans la Caverne ; l'honneur revient alors à l'aide major Duchamp et à l'aumônier Py de faire prisonnier 150 Allemands abasourdis et décontenancés.
Il semblerait, et la légende ira bon train, que l'aumônier Py, un brave et simple capucin, le crucifix en main, ait achevé de décider ces Allemands à se rendre, grâce à une petite harangue à laquelle, probablement, ils ne comprirent rien.
Alors, nos deux héros veulent absolument accompagner leurs prisonniers au colonel.
Notre témoin raconte : « On assista à un spectacle unique. On vit s'éloigner un cortège on ne peut plus pittoresque, fait de prisonniers hébétés et penauds, encadrés par un moine persuasif et un médecin conquérant ».
Une exploration plus complète est ensuite entreprise par les deux compagnies et permet d'augmenter d'une centaine le nombre des prisonniers de la grotte.
Cette conquête aura un important retentissement.
Après l'échec de la grande offensive, ce succès sera célébré dans tous les journaux.
Le 15-2 est honoré et reçoit, le 10 juillet suivant, sa quatrième citation à l'ordre de l'Armée. Cette citation lui vaut la fourragère aux couleurs de la médaille militaire que le président de la République en personne lui remet à Paris au cours de la revue du 14 juillet.
Quelques jours après, le 15-2 apprend que tout le terrain qu'il a conquis au Chemin des Dames vient d'être repris par l'ennemi.
Le haut commandement lui demande immédiatement de retourner en ligne. A peine reconstitué, le 15-2 est en place pour le 24 juillet.
À 4 h 15 du matin, le 2e bataillon se porte à l'assaut ; les tirailleurs ennemis les reçoivent à coup de grenades. C'est une mêlée sanglante, au cours de laquelle tous les officiers du bataillon sont tués ou blessés. Pour ménager l'effet de surprise, l'artillerie française n'avait pas tiré avant l'attaque.
Alors, des renforts ennemis arrivent en grand nombre. Partout, la progression est arrêtée net.
Seuls quelques soldats atteignent une partie de leur objectif, le Talus organisé, et s'y maintiennent malgré les contre-attaques.
Lorsque le corps colonial arrive pour rétablir l'équilibre, c'est sur un champ de bataille-cimetière du 15-2 qu'il s'avance.
En effet, au cours des attaques du 22 mai, du 25 juin et du 24 juillet 1917, le 15-2 aura perdu 40 officiers et près de 1000 soldats.
Habitué aux grandes actions depuis le début de la guerre, le 15-2 subira encore d'autres épreuves à Reims, à Verdun, au cours de la deuxième bataille de la Marne, pendant la contre-offensive et enfin pendant la campagne de Belgique.
C'est d'ailleurs en entrant en Belgique, le 3 Septembre 1918, que ce glorieux régiment apprendra sa 7e citation à l'ordre de l'Armée, lui valant ainsi l'attribution de la fourragère à la couleur du ruban de la Légion d'honneur.
Enfin, ce sera la victoire totale le 11 novembre 1918.
Régiment de France le plus décoré, après la Légion Etrangère et le R.I.C.M., le 15-2 défilera le l4 juillet 1919 sous les ovations d'une foule parisienne reconnaissante.
Le soldat Pierre Damet y était. Il se souvenait de tous les détails. Comment oublier un pareil moment ?
Et lorsque sur son lit de malade, à la fin de sa vie, il m'accordait quelques mots balbutiés, il concluait toujours par un sourire accompagné d'un "j'étais du 15-2 !".
Docteur Jean-Daniel DESTEMBERG
Délégué général de l'Allier.
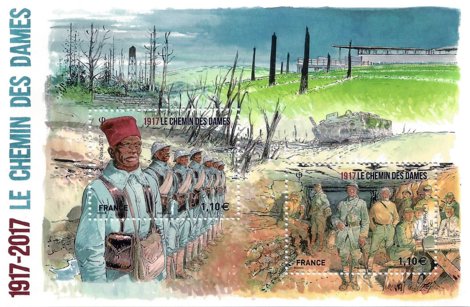
| Haut de page |
N° 431 - 2e trimestre 1998
Le drame des " Malgré-nous ".
Le drame de la jeunesse alsacienne remonte à 1871, quand elle dut servir sous l'uniforme allemand. Chaque année des milliers de conscrits vont se réfugier à Belfort, Nancy et Paris pour échapper à leurs obligations militaires, et souvent pour s'engager dans la Légion Etrangère.
La situation devient encore plus terrible à partir de l'été 1914. Il faut faire la guerre contre la France et ses Alliés. Et parfois, dans une famille, un fils est dans l'Armée allemande et un autre dans 1'armée française. De nombreux Alsaciens s'étant rendus aux Français dans la région de Saint-Blaise (Bas-Rhin) en août 1914, l'Etat-Major allemand décide d'envoyer les soldats originaires d'Alsace et de Lorraine annexées sur le front russe et de les disséminer dans toutes les unités (deux ou trois par compagnie), le plus souvent dans les régiments prussiens.
Mais jusqu'en 1918, les Alsaciens-Lorrains sont bien de nationalité allemande, selon les dispositions du traité de Francfort signé par la France le 10 mai 1871. L'Empire allemand a le droit pour lui.
Tout autre sont les choses à partir d'août 1942, l'Alsace et la Moselle ayant été rattachées de fait et non en droit au IIIe Reich. A nouveau il faut aller combattre sur le front de l'Est, rarement face aux Anglo-Américains et aux Français. Et toujours dans les mêmes conditions : éparpillement au maximum dans les unités de la Wehrmacht. Avant août 1942 une grande campagne de propagande a été lancée pour le recrutement de volontaires ; elle se solde par un échec : à peine 2 000 hommes s'engagent, c'est-à-dire moins, en proportion, que dans tout autre région française pour le LVF et les Waffen SS. Seuls ces volontaires accèdent à des grades de sous-officiers et rarement d'officiers. Les autorités ne se laissent pas prendre deux fois à la feinte mise au point par Charles Augst, le seul Alsacien affecté à l'Afrika Korps avant la bataille de Tunisie ; ce jeune homme manifeste son admiration pour le Maréchal Rommel et son désir de servir sous ses ordres, désir exaucé. Mais au premier jour de combat sur le front sud-tunisien, il se débrouille pour tomber aux mains des hommes de la VIIIe Armée britannique, qui comprennent beaucoup mieux la "musique" alsacienne que les Soviétiques et même les Américains. Les Anglais le remettent aussitôt aux Français et Charles Augst rentre, en 1944, en Alsace en libérateur avec la croix de guerre et une blessure reçue dans les combats en Bourgogne au sein de l'Armée de de Lattre.
Sur 140 000 mobilisés, 40 000 ne reviendront pas, tués, disparus, morts en captivité, principalement au camp de Tambov en Russie près de l'Ukraine. Sur 40 000 prisonniers des Russes dont beaucoup se sont fait prendre sans avoir lutté énergiquement (mais que faire quand une troupe d'assaut souvent composée de Mongols surgit en hurlant dans la tranchée ? Il faut bien défendre sa peau !). 10 000 au moins mourront en captivité, pour certains, victimes des libérés de l'été 1944, sans que ceux-ci l'aient voulu. En juillet de cette année-là, à la demande du Général de Gaulle, un convoi de 1 500 hommes rhabillés à neuf, est formé à Tambov et dirigé sur l'Iran, occupé au nord par les Soviétiques, au sud par les Anglais. A Téhéran, à la ligne de démarcation, les libérés ont le tort, sous les yeux de l'escorte soviétique de piétiner leurs uniformes russes et d'embrasser les tenues britanniques qui leur sont distribuées. Ils ont tant souffert dans la forêt de Tambov ! Et une fois débarqués en Algérie, où la plupart demandent à servir dans la 1ère Armée française, ils racontent leurs misères et les Soviétiques l'apprennent. Il n'y aura plus de nouveaux convois vers Téhéran comme cela avait été prévu.
Les prisonniers rentreront dans les années 1945, 1946 et 1947 et de moins en moins nombreux par la suite. Le dernier des derniers franchira le Rhin en avril 1955 (2 ans après la mort de Staline). Il s'appelait Jean-Jacques Remetter et était le frère du célèbre gardien de but de l'équipe de France de football, qui lui s'était "éclipsé" pendant l'occupation, ce qui aurait mis sa famille en danger si Jean-Jacques avait fait la même chose. Pour sauver les siens, celui-ci aura dû suivre un chemin de croix de 12 années...
Un autre fait mal connu est l'incorporation d'office de la classe 1926 (née en 1926, donc classe 46 en France) tout entière dans la Waffen SS - une sorte de Malgré-nous "privilégiés"- Cela aura des conséquences au moment du procès de Bordeaux, quand comparaîtront les responsables du massacre d'Oradour de juin 1944. Il y aura des Alsaciens devant ce tribunal : un seul avait été volontaire. Les autres avaient été capturés par la suite par les Anglais sur le front de Caen, là où la bataille fut la plus violente en Normandie - forcément quand on s'appelle Division SS Das Reich...
Le fait que la plupart des Allemands furent tués dans cette bataille, en combattant avec fanatisme, augmentera la proportion des Alsaciens au procès, dont deux au moins avaient donné l'alerte à des gens se dirigeant vers Oradour pendant le massacre.
Autre fait encore, une quarantaine d'officiers de réserve alsaciens de l'Armée française sont convoqués en 1943 "Le Führer vous rend votre grade français dans les Waffen SS". A part deux ou trois, tous refusent, arguant qu'ils ont prêté serment à l'Armée française. Ils rentrent chez eux. Nouvelle tentative en 1944. Quelques-uns faiblissent à leur tour, mais la majorité des 40 refuse encore, ce qui les conduit en camp de concentration, pour la plupart à Neuengamme, où plus de la moitié d'entre eux périront, payant de leur vie leur attitude héroïque.
L'Alsace était tellement quadrillée (des dizaines de milliers d'Allemands habitaient à Strasbourg de 1940 à 1944, à la place des expulsés et de ceux qui n'étaient pas rentrés de la Dordogne à l'été 1940), qu'il n'était pas possible que la Résistance se développe dans cette région comme ailleurs en France. Mais l'efficacité des filières d'évasion, faisant passer les évadés français et alliés au-delà des Vosges et en Suisse (ex. le Général Giraud) fut exceptionnelle malgré les risques mortels encourus par les passeurs, dont aucun ne demandait d'argent alors que l'occupant offraient des récompenses pour la capture des évadés (qui avaient bien sûr les poches vides).
Quelle que soit la cause du décès, les Malgré-nous eurent, pour 24 mois de combat (1943-1945) plus de morts que leurs aînés en 52 mois de guerre en 1914-1918. Et la mortalité fut grande parmi eux une fois la paix revenue. En 1998, ils ont presque tous disparu.
Ces choses-là doivent être expliquées sans relâche à ceux qui habitent loin des rives du Rhin et de la Sarre.
La Délégation générale du Bas-Rhin
| Haut de page |
N° 432 - 3e trimestre 1998.
LES PLÉNIPOTENTIAIRES ALLEMANDS PASSENT LES LIGNES.
Le 5 novembre, des ordres étaient donnés pour la réception des parlementaires allemands. Ils étaient aiguillés vers la première ligne de l'aimée Debeney sur l'axe Givet-La Capelle-Guise.
Dans la nuit du 6 au 7 novembre, le Haut Commandement Allemand faisait connaître les noms des plénipotentiaires, savoir :
- le Ministre d'État Erzberger, Président ;
- le Général Major von Winterfeldt ;
- le Ministre plénipotentiaire Comte Oberndorff ;
- le Capitaine de vaisseau Vanselow ;
auxquels étaient joints le Capitaine Geyer, du Grand État-Major général et le Capitaine de cavalerie von Helldorf, interprète.
Les Allemands demandaient en même temps une suspension d'armes provisoire qui ne fut accordée que sur la route Fourmies-La Capelle. Ceci donna lieu à des méprises. Des soldats allemands sortirent de leurs tranchées disant : « Kamerades, guerre finie ». Des officiers, des hommes de troupe, porteurs de fanions voulaient entrer dans nos lignes pour « serrer les mains de leurs braves adversaires français ». Les habitants emmenés par les Allemands commençaient à rentrer chez eux en chantant.
Laissons la parole au Général Weygand : « La nuit est venue, le temps est affreux, une pluie fine tombe sans abattre un brouillard assez épais. A 20 heures enfin les sentinelles distinguent un halo de lumière et perçoivent quelques notes de la sonnerie "Cessez-le-feu", quelques secondes après, un convoi de voitures automobiles se présente à vive allure sur la route, phares allumés ; à l'avant de la première, un immense drapeau blanc se détache dans la nuit ; sur le marchepied, un trompette debout continue de sonner. Un geste arrête les voitures. Un jeune capitaine de 25 ans s'avance. C'est le Capitaine Lhuillier commandant le bataillon du 171e Régiment d'Infanterie. Il reconnaît les parlementaires et monte dans la première des cinq automobiles. Sur le marchepied, le Caporal clairon Sellier a remplacé le trompette allemand et l'on se remet en marche vers La Capelle. Le clairon sonne le "Garde à Vous", tandis que nos poilus regardent le résultat de quatre ans de lutte et de souffrances ».
Que se passait-il, au même moment, du côté français ?
AU GRAND QUARTIER DE FOCH.
Le 7 novembre, le Maréchal Foch accompagné du Général Weygand, du Commandant Riedinger, du Capitaine de Mierry et de l'officier-interprète Laperche, quittait Senlis avec la délégation britannique présidée par l'Amiral Wemyss, Premier Lord de l'Amirauté.
Senlis, quartier général du Commandant en Chef, n'était-elle pas le point où devraient normalement être conduits ceux qui venaient implorer la cessation des hostilités ?
Mais Senlis était près de la capitale, la ville eut été envahie de curieux de tous les pays. D'autre part, Senlis avait été odieusement traitée en 1914 par l'armée allemande. Le Maire et quelques otages innocents, avaient été fusillés. Les habitants n'auraient sans doute pu contenir leur légitime indignation.
C'est pourquoi le Maréchal adopta la forêt de Compiègne où son train pourrait le conduire.
Le wagon du Maréchal avait été aménagé en bureau par la Société des Wagons-Lits, peu de temps avant le 11 novembre. C'est dans la forêt de Compiègne que le wagon portant le numéro 2419 D fut utilisé comme bureau pour la première fois. Il devait encore servir aux entrevues de Trêves le l6 décembre 1918 et les 16 janvier et 13 février 1919.
La solitude de la forêt de Compiègne devait assurer, le 11 novembre, le calme, le silence, l'isolement et le respect de l'adversaire vaincu.
VERS RETHONDES.
Reportons maintenant notre pensée vers les plénipotentiaires allemands arrêtés à Haudroy. Aussitôt après, ils furent conduits à La Capelle, à la Villa Pâques, où ils furent reçus par le Commandant de Bourbon-Busset et le Commandant Ducornez. Le Général von Winterfeldt, ancien attaché militaire à l'Ambassade d'Allemagne à Paris, présente les membres de la délégation.
Celle-ci est invitée à laisser sur place ses voitures ornées de l'aigle impérial qu'elle retrouvera au retour et à monter dans les voitures françaises.
On quitte La Capelle, la route est défoncée, le trajet pénible.
On arrive enfin à Homblières auprès de Saint-Quentin, où le Général Debeney commandant la 1re Armée Française, reçoit les Allemands dans un presbytère ruiné et dévasté.
Un simple repas est servi avec le pain et le vin du soldat.
On se remet en route vers Tergnier où un train attend les Allemands. On y arrive vers 3 heures du matin. La ville est dévastée. Le spectacle qu'elle offre impressionne les Allemands. « La gare est éclairée par des torches. Sur le quai une Compagnie de Chasseurs impeccable, présente les armes dans un décor de féerie » (Général Weygand).
Le wagon-salon du train des plénipotentiaires est l'ancien salon de Napoléon III tendu de satin vert avec l'N couronnée.
Le train des plénipotentiaires part pour une destination inconnue. Il fait une nuit noire ; les vitres du wagon ont été masquées.
8 novembre. 7 heures. Le train s'arrête. Où est-on ? Par les fenêtres enfin démasquées que voit-on ? (Un taillis marécageux, un temps gris, un ciel bas et pluvieux, ainsi s'exprime le Commandant de Bourbon-Busset.
À quelques Mètres, un autre train arrêté dans la brume. Un gendarme dévoile le secret : on est en forêt de Compiègne.
Le train du Maréchal et celui des Allemands sont reliés par un caillebotis qu'on sera obligé d'utiliser pour se rendre de l'un à l'autre, tant le terrain est mauvais.
Les deux trains sont garés sur deux tronçons de voies ayant leur origine dans la station de Rethondes. Ces voies étaient des épis destinés à l'artillerie lourde lorsqu'elle tirait en direction de Noyon.
Peu de temps après leur arrivée, le Maréchal Foch fait prévenir les plénipotentiaires qu'il les recevra dans son train à 9 heures. Les négociations vont commencer. Il devra en résulter la capitulation sinon c'est l'invasion par une offensive qui dans six jours sera déchaînée sur le front de Lorraine par le Général de Caltenau.
DANS LE WAGON-BUREAU DU MARECHAL
Lorsque les plénipotentiaires eurent été introduits, le Maréchal Foch fit son entrée et salua militairement.
M. Erzberger présenta les membres de la mission allemande, le Maréchal présenta à son tour les officiers qui l'accompagnaient :
- le premier Lord de l'Amirauté Sir Rosslyn Wemyss ;
- le Contre-Amiral Anglais Hope ;
- et le Chef d'État-Major le Général Weygand.
M. Erzberger remit ses pouvoirs et le Maréchal se retira dans le compartiment voisin pour les examiner.
Il rentra peu après et invita les quatre délégués allemands à prendre place sur l'un des grands côtés de la table. Aux deux petits côtés de la table étaient assis deux officiers secrétaires : le Capitaine von Helldorf et l'Officier interprète Laperche.
Voici prise sur le vif, et d'après la brochure « Comment fut signé l'Armistice », la physionomie de l'entrevue, conforme d'ailleurs au récit que l'on peut lire dans les Mémoires du Maréchal Foch et dans le livre du Général Weygand :
Le Maréchal : Quel est l'objet de votre visite ?
Erzberger : Nous venons recevoir les propositions des Puissances Alliées, relatives à la conclusion d'un armistice, sur terre, sur mer, dans les airs, sur tous les fronts et aux colonies.
Le Maréchal (froidement) : Je n'ai pas de propositions à vous faire.
Oberndorff (intervenant) : Nous désirons prendre connaissance des conditions auxquelles les Alliées consentiraient un armistice.
Le Maréchal : Je n'ai pas de conditions à faire.
Erzberger (timidement) : Cependant le Président Wilson...
Le Maréchal (d'un ton sec) : Je suis ici pour vous répondre si vous demandez l'armistice. Demandez-vous l'armistice ? Si vous le demandez, je puis vous faire connaître les conditions auxquelles il sera obtenu.
Erzberger et Oberndorff (ensemble) : Ia.
Le Général Weygand donne lecture du texte proposé par les Gouvernements Alliés.
Erzberger : Puis-je donner communication de ces propositions à mon Gouvernement ?
Le Maréchal : Vous pouvez les envoyer par courrier spécial.
Erzberger : En raison des difficultés de communication, je demande que ce délai de réponse fixé à 72 heures soit prolongé de 24 heures.
Le Maréchal : Le délai de 72 heures a été fixé par les Gouvernements Alliés. Il sera maintenu. J'attendrai votre réponse jusqu'à 11 heures du matin (heure française).
Pendant cette conversation le Maréchal avait un calme de statue, l'Amiral anglais jouait avec son monocle, les Allemands étaient abattus, consternés.
La séance dura trois quarts d'heure et le Général Weygand y donna lecture des clauses principales des conditions de l'Armistice telles qu'elles avaient été arrêtées à Versailles le 4 novembre.
Après cette lecture, M. Erzberger avait demandé que les opérations militaires fussent arrêtées. Relus du Maréchal tant que la délégation allemande n'aura pas accepté les conditions exposées. Même refus opposé à une intervention du Général von Winterfeldt.
Devant ce refus, les Allemands demandent l'envoi à Spa d'un courrier allemand porteur du texte des conditions d'armistice.
Le Capitaine von Helldorlf partit pour Spa à 13 heures. Il éprouva de grandes difficultés pour franchir les lignes allemandes et pendant son voyage. A son arrivée de grands événements avaient eu lieu : l'Empereur avait abdiqué et la direction des affaires confiée au député Ebert.
La République était proclamée.
Dans l'après-midi du 8 novembre, le Comte Oberndorff, le Général von Winterfeld et le Capitaine de vaisseau Vanselow eurent des entretiens particuliers avec le Général Weygand et l'Amiral Hope dans le but d'obtenir pour les délégués allemands certains éclaircissements.
Dans la journée du 9 novembre, les Allemands remettent des observations relatives aux conditions d'armistice.
Mais la fermeté du Maréchal Foch reste la même. Dans la journée du 9 novembre, tandis que les pourparlers continuent, il adresse aux Commandants d'Armées, le télégramme chiffre n° 5 828 :
« L'ennemi désorganisé par nos attaques répétées cède sur tout le front. Il importe d'entretenir et de précipiter nos actions.
Je fais appel à l'énergie et à l'initiative des Commandants en chef et de leurs armées pour rendre décisifs les résultats obtenus ».
Les pourparlers d'armistice se continuent par échange de notes dans la journée du 10.
Enfin, entre 19 et 20 heures arrivent par la T.S.F. deux messages sous le n° 3 084 (chiffre adopté pour en marquer l'authenticité) :
« 1° Le Gouvernement Allemand accepte les conditions de l'armistice qui lui ont été imposées le 8 novembre ;
2° Le Sous-Secrétaire d'État Erzberger est autorisé à signer l'armistice ».
Enfin vers 21 heures arrive un très long télégramme chiffré du Maréchal von Hindenburg, pour lequel les Allemands demandent le temps de le déchiffrer.
Le Maréchal von Hindenburg exposait de façon très pressante que « la signature étant décidée, il importait pour épargner des vies humaines d'arriver sans retard à la suspension des hostilités ».
Telle était l'atmosphère dans laquelle allait s'ouvrir l'entrevue du 11 novembre.
LA DERNIÈRE ENTREVUE : 11 NOVEMBRE.
À 2 h 05, les Allemands font connaître qu'ils sont prêts à entrer en séance. Introduits aussitôt dans le wagon du Maréchal, la séance s'ouvrit à 2 h 15.
Le Général Weygand donna lecture du texte définitif des conditions d'armistice.
Il comprend vingt-quatre articles spécifiant notamment la cessation des hostilités six heures après la signature de l'armistice, l'évacuation des pays envahis, la rétrocession de l'Alsace et de la Lorraine, l'abandon d'un matériel de guerre, canons, minenwerfer, avions, mitrailleuses, matériel de chemin de fer, occupation des têtes de pont sur le Rhin, retour des prisonniers, etc.
La durée de l'armistice était de 36 jours.
Le 11 novembre à 5 h 10, après trois heures d'explications, les Allemands acceptaient de signer. Le Maréchal signait le premier.
À 7 heures, le Maréchal, porteur de la convention d'armistice parlait pour Paris.
À 11 heurcs, la sonnerie « Cessez-le-feu » retentissait cette fois sur le front pour tout de bon. Le sang avait cessé de couler.
À 11 h 30, les Allemands quittaient la forêt de Compiègne pour Tergnier où ils retrouvaient leurs autos.
LE 11 NOVEMBRE A PARIS.
Dès le matin se répandit à Paris le bruit de la présence du Maréchal. Sa voiture fut entourée par la foule qui l'acclamait lorsqu'il se rendit rue Saint-Dominique pour remettre au Président du Conseil Clemenceau, le texte scellant la Victoire. Puis ce fut à l'Élysée, au Président de la République Raymond Poincaré.
L'après-midi, au Palais-Bourbon, séance qui devait être inoubliable et sur laquelle passe un souffle ardent de patriotisme et d'union.
Nos Morts, nos Grands Chefs et en particulier Foch et Joffre ainsi que Clemenceau furent acclamés.
Clemenceau proclama que « la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, serait toujours le soldat de l'idéal ». Puis il salua vivants pour la grande œuvre de reconstitution sociale à laquelle ils étaient appelés.
Que dire de la joie populaire, sinon qu'elle fut débordante. Ce fut une magnifique journée de la vie française.
Cependant, le Maréchal Foch après ses visites au Président du Conseil et au Président de la République, se dérobait discrètement aux acclamations de la foule et, suivant son expression, « filant par la rue Lafayette, n'ayant pas vu la floraison des drapeaux de la capitale », regagnait son quartier général à Senlis.
Le lendemain 12 novembre, il expédiait de Senlis aux Armées, l'Ordre du Jour n° 5 961 ainsi conçu :
« Officiers, Sous-Officiers et Soldats des Armées Alliées ; après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'Histoire, sauve la cause la plus sacrée : la liberté du monde.
Soyez fiers,
D'une gloire immortelle vous avez paré vos drapeaux,
La postérité vous garde sa reconnaissance ».
La duré de l'Armistice du 11 novembre était de 36 jours. Les plénipotentiaires devant participer à la signature de la paix n'étant pas tous arrivés, l'armistice signé à Compiègne dut être prolongé.
Trois réunions furent tenues à Trêves les 13 décembre 1918, 16 janvier 1919 et 16 février 1919. Elles eurent lieu dans le wagon du Maréchal et avec les mêmes représentants que le 11 novembre à Compiègne.
Le 28 juin 1919, la Paix était signée à Versailles. Elle devait durer 20 ans.
Extrait de la brochure
éditée par l'Imprimerie du Progrès de l'Oise,
Compiègne
| Haut de page |
N° 436 - 3e trimestre 1999
Le 11 novembre est le jour dédié à la mémoire de ceux qui sont morts au combat lors de la Première Guerre mondiale. La multitude des noms inscrits à la suite des uns des autres sur les stèles communales. jusque dans le plus lointain village, témoigne toujours de l'ampleur des sacrifices subis pendant quatre années, en vue de délivrer des territoires français envahis jusqu'aux portes de Paris. |  |
L'année 1998 a été par exemple celle de la commémoration du 80e anniversaire de la mort glorieuse d'un français hors du commun : Joost VAN VOLLENHOVEN.
Joost Van Vollenhoven (VV), comme l'indiquent son prénom et son nom est de souche néerlandaise. Ses parents sont fixés de longue date dans l'Algérois ; ils ont trois fils qui seront les premiers à opter pour la nationalité française ; deux d'entre eux mourront au combat. Joost, sujet du texte, et un de ses frères tué au Maroc en octobre 1917.
Voici donc un itinéraire d'exception, franchi à vive allure. Il s'engage dans la marine sur un voilier entreprenant le tour du monde ; cela lui permettra de mûrir ; il entre ensuite à l'Ecole d'Administration coloniale. Il s'y avérera brillant, sortant major de sa promotion à l'âge de 27 ans. De plus, la même année, il soutient à Paris une thèse de doctorat en droit sur " le fellah algérien ", qui expose déjà de façon magistrale les réformes à apporter à l'administration. Faisant d'une pierre trois coups, il ajoute en même temps une traduction d'un ouvrage allemand. En effet, cet homme est polyglotte, connaissant le hollandais, l'anglais et l'allemand. Dès sa sortie de l'Ecole coloniale, il est appelé au Cabinet de Doumergue, alors Ministre des Colonies ; et sans tarder il deviendra aussi professeur à l'école dont il vient de sortir. Mais, rapidement, il est appelé à de plus hautes fonctions.
Enumérons :
- 1906 : Il est nommé secrétaire général du gouvernement de l'AOF (Afrique Occidentale Française), puis délégué du Gouverneur Général à Dakar, pour stimuler le développement du port.
- 1907 : En Guinée (Konakry) il exerce les fonctions de gouverneur, par intérim. Le fait qu'il soit si jeune (30 ans) pour assumer cette fonction provoque des remous contestataires chez les chefs de service dont la carrière est déjà solidement établie. Mais la personnalité simple, franche, sportive et avenante de Van Vollenhoven (VV) est déjà un atout que confirme aussitôt une nature de chef.
- 1908 : Il est nommé secrétaire général de l'AEF (Afrique Equatoriale Française) à Brazzaville, chargé de la direction des finances, sous les ordres du Gouverneur Général Merlin.
- 1911 : Conflit diplomatique franco-allemand à propos du Maroc. Le futur Général Messimy, a choisi Van Vollenhoven comme conseiller technique : c'est l'homme qu'il faut. En effet, d'une part il parle couramment l'allemand ; d'autre part et surtout, étant secrétaire général de l'AEF depuis trois ans, c'est un homme de terrain qui a appris à connaître cette immense région de l'Afrique Noire. Or, l'Allemagne a une colonie dans cette région, le Kamerun, qui voisine avec les territoires de l'AEF. C'est donc VV qui conseille la cession de territoires bordant le haut cours de la Sangha (affluent de la rive droite du Congo) et qui touchent l'est de la colonie allemande. En échange il demande la liberté d'établir le protectorat français sur le Maroc qui est alors proche de la guerre civile. La proposition acceptée, fera reculer de trois ans la déclaration de guerre dont l'étincelle aura lieu à Sarajevo.
- 1912 : A 35 ans, et après neuf années de services dans l'Administration Coloniale, il est nommé gouverneur ; c'est le plus jeune dans ce grade.
- 1913 : Il est secrétaire général du Gouverneur Général Sarraut, en Indochine, mais peu après cette nomination, Sarraut devient ministre des Colonies dans le cabinet Viviani. VV devient ipso facto Gouverneur Général par intérim, fonction qu'il assume jusqu'à l'arrivée du titulaire, Monsieur Roume, en mars 1915.
- 1915 : Dès qu'il a remis ses fonctions à son successeur, plutôt que de rester en disponibilité, et donc inactif, il décide de servir dans l'armée où il est Sergent de réserve. Sur le bateau qui le ramène en France, il renonce à la 1re classe, à laquelle sa qualité de haut fonctionnaire lui donne droit, et voyage avec les hommes de troupe, en 3e classe. Il utilise ses relations pour être envoyé rapidement sur le front.
- Début mai 1915 : 1ère citation à l'ordre du Corps d'Armée ; mais blessé par un éclat d'obus à la cuisse son immobilisation durera plusieurs mois. A peine remis, il demande à reprendre le service ; il sera le chef d'Etat-major de la 6e Brigade de chasseurs à pied, que commande le Général Messimy, le même qui avait choisi VV comme conseiller technique aux pourparlers de Berlin en 1911.
- Juillet 1916 : Il participe à la bataille de la Somme.
- Septembre 1916 : Blessé au bras : il doit être évacué.
- 2 janvier 1917 : Il est nommé Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur avec cette citation : "officier d'EM d'une haute valeur intellectuelle, remarquable par son autorité, sa bravoure et son mépris du danger..."
- Avril 1917 : Réaffecté à son régiment d'origine, le RICM, dont il a toujours porté l'uniforme, celui des "Marsouins" ou Infanterie coloniale. Il vient d'être nommé capitaine. Le mois suivant, le Ministère des Colonies le reprend à son service en le nommant Gouverneur Général de l'AOF. C'est sur le croiseur "Dupleix" escorté de deux contre-torpilleurs qu'il quitte Brest à destination de Dakar, accompagné de son chef de cabinet militaire, le futur Général Mangeot.
- De mai 1917 à janvier 1918 : VV assume ses fonctions de Gouverneur Général de l'AOF.
- 17 janvier 1918 : Coup de théâtre : « adresse une lettre de démission à son ministre. En effet, celui-ci vient de nommer un Haut-Commissaire pour l'Ouest Africain : le député noir Blaise Diagne. Dans son esprit, il estimait qu'un autochtone serait mieux placé pour dialoguer avec ceux qui étaient chargés de faire des levées de tirailleurs.
Le gouvernement était, en effet, hanté par l'appréhension de voir se renouveler les troubles qui eurent lieu l'année précédente. et que l'on pensait liés à une levée de 50 000 hommes pour tout le territoire de l'AOF.
En même temps que sa démission, comme en 1915, et pour ne pas rester inactif en disponibilité, il demandait de reprendre son poste de capitaine au Régiment colonial du Maroc. Sa requête fut accueillie favorablement.
- Fin janvier 1918 : Il est à nouveau au Front.
- 28 mars : Pour avoir animé la défense de Roye, au sud du département de la Somme, il méritait une nouvelle citation : " Officier remarquable à tous égards, toujours sur la brèche et possédant au plus haut degré le sentiment du devoir. Malgré un bombardement violent, a réussi, en donnant l'exemple à tous, à fortifier et organiser d'une façon parfaite de secteur de sa Compagnie " .
- 12 avril : Les troupes allemandes se rapprochent de Compiègne. Nouvelle bataille à Caisnes à quelques kilomètres au sud-est de Noyon. Placée en arrière garde, la Compagnie de VV est chargée de protéger la retraite de son bataillon, lors d'une suprême offensive allemande.
Ce ne sera que le 11 juin que le Général Mangin, (celui qui avait réussi à reprendre les forts de Douaumont et de Vaux fin 1916), arrête l'assaut apparemment irrésistible de Von Hutier à Méry-Courcelles à quelque 20 kilomètres au nord-ouest de Compiègne. Mais des renseignements recueillis, une riposte menace en direction de Villers-Cotterêts (Aisne). Le 13 juillet, le RICM est transporté dans la forêt de Retz, au nord de Villers-Cotterêts et le 18 juillet Foch donne l'ordre de contre-offensive sur tout le front, de Reims à Amiens. Le même jour, le RICM progresse au-delà de Parcy-Tigny faisant plus de 800 prisonniers : c'est le lendemain, alors que la progression continue que VV tombe atteint d'une balle à la base du crâne : transporté au poste de secours, il ne décède que le lendemain matin 20 juillet 1918.
Il fut enseveli dans le bourg voisin, à Longpont, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Soissons.
Dès 1920, le Général Massimy, des anciens du RICM, des collègues de l'administration coloniale formèrent un comité destiné à exalter et perpétuer la mémoire de cet homme prestigieux. Le monument érigé grâce à leur diligence à Longpont, sur sa tombe, ne fut inauguré qu'en 1938 en présence du Président de la République entouré d'autorités civiles et militaires.
Le Régiment d'Infanterie coloniale du Maroc, " splendide régiment dont la valeur et l'entrain sont légendaires... " disait, le Général Mangin a été décoré de la double fourragère aux couleurs de la Légion d'Honneur et de la Croix de Guerre, la Médaille Militaire à son drapeau et dix citations à l'ordre de l'Armée, une citation au Corps d'Armée et deux citations à la Division, c'est là un palmarès d'excellence. " Le premier régiment de France " se plaisait à dire VV, comme le rappelle le Colonel Modat, commandant du RICM au Général Massimy dans une lettre adressée peu après ce 20 juillet 1918 ; et il ajoute " Adoré de ses hommes, VV en avait fait une unité hors ligne, et quand on lui rappelait que ce rôle de commandant de compagnie était peut-être ingrat et terre à terre, il se récriait vivement, affirmant sa grande joie de faire son devoir, tout son devoir ".
Mais ce palmarès d'excellence a été acquis, au prix du sang, celui de 13 000 morts tombés dans ses rangs...
" Les hommes n'ont pas le droit de pleurer tant qu'il leur reste la force de combattre " disait encore VV et c'est le Général Messimy qui rappelle cette phrase gravée dans son souvenir alors qu'il se recueille devant cette tombe ornée de quatre bas-reliefs qui rappellent que ce héros militaire fut aussi un grand administrateur, gouverneur général de l'AOF.
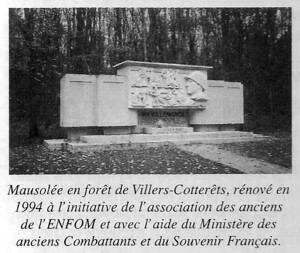 |
Ces quatre bas reliefs évoquent : |
Chez cet homme, il y a apparemment deux aspects différents, d'une part l'organisateur et le gestionnaire, d'autre part un soldat de haute envergure. Mais ce ne sont en fait que deux faces différentes d'une même personnalité, celle d'un chef dont les objectifs sont précis, et qui sait insuffler à ses subordonnés la volonté de les réaliser. Outre le sens du devoir et du service à rendre à la Nation comme aux individus, il y a aussi l'impossibilité de rester inactif ; c'est ainsi, pensons-nous, qu'il faut interpréter ces deux comportements de mars 1915 et de janvier 1918 : plutôt que de rester en disponibilité dans l'attente d'une nomination administrative du niveau de sa compétence, il donne toute son énergie à l'Armée en guerre, et en première ligne de combat.
Si l'on a pu dire de Bayard qu'il fut le dernier grand modèle des chevaliers du Moyen-Age, il n'en demeure pas moins que l'esprit chevaleresque, s'est perpétué jusqu'à la fin des grandes guerres européennes ; VV n'est qu'un exemple parmi une multitude de héros qui ont combattu jusqu'à sacrifier leur vie. Mais il y avait en lui une grandeur qui le hisse au-delà de celle du simple guerrier.
| Haut de page |
N° 442 - 1er trimestre 2001
La mobilisation d'août 1914 n'a pas, semble-t-il, beaucoup surpris les familles françaises, même dans les campagnes et les montagnes reculées. Pourtant on devrait déchanter rapidement car cette guerre allait se révéler plus brutale, meurtrière et destructrice que jamais.
Ce sont cinq frères, Elie mon grand-père, Denis, Joachim, Etienne et Urbain qui tous ensemble sont appelés à être mobilisés aux premiers jours d'août 1914 et à rejoindre leur régiment dans le sud de la France. Ils étaient originaires de Prades près de Sainte-Enimie dans les Gorges du Tarn, d'une famille de 8 enfants dont les parents. Basile et Marie (Fages) Mathieu, qui s'étaient mariés à Sainte-Enimie. Ils étaient maçons, tailleurs de pierres construisant maisons, ponts, monuments, et instituteur.
Des cinq, un seul est revenu. Etienne, bien mal en point puisque lors d'un assaut une balle ravinant la partie gauche de la tête, alla se ficher dans le cœur. Il restera infirme à vie. L'aîné des enfants, Basile, 40 ans au début de la guerre n'a pas été mobilisé ainsi que le dernier, Maurice, 18 ans en 1918, qui a pu rester à la maison après une sérieuse intervention du père auprès du préfet de la Lozère...
À part le souvenir, il reste les noms inscrits sur les monuments et le mur de l'ancienne école de Prades.
Joachim, instituteur, de la classe 1900, est mobilisé au 111e RI à Antibes. Le régiment débarque mi-août à Diarville près de Charme en Moselle. C'est la campagne de Lorraine, qui le mène à Biderstroff (20 août), 7 km au nord-est de Dieuze, où le 111 subira de lourdes pertes, puis c'est la retraite de Morhange jusqu'à Velle sur la Moselle et des va-et-vient entre la Moselle et Lunéville (bois de Bareth) jusqu'au 30 août. Le 1er septembre, le 111e rejoint Bar-le-Duc puis à pieds qu'il atteindra le 7. Il participe à la bataille de la Marne, 14 km à l'ouest de Bar-le-Duc puis se porte le 15 au Mort-Homme en Argonne où il subira des combats acharnés dans des conditions très éprouvantes jusqu'à sa dissolution en juillet 1916. Joachim sera tué le 27 février 1916 dans les bois de Malancourt, 5 km à l'ouest du Mort-Homme lors d'une attaque surprise et massive, au moment du déchaînement de la bataille de Verdun. Sa dépouille repose au cimetière militaire d'Esne-Malancourt, tombe 2 865.
Elie, tailleur de pierre, de la classe 1904, est mobilisé au 142e RI à Mendes. et rejoint le 342 (5e bataillon, 18e Compagnie). Le régiment fait mouvement sur Mirecourt en Lorraine, avance jusqu'à Angviller à 10 km à l'est de Dieuze (son frère Joachim était alors à trois kilomètres), participe à la retraite de Morhange et aux combats de Gerbeviller (bois de Bareth ) au sud de Lunéville, est de nouveau engagé en Woëvre où, courant septembre, il se distingue dans des combats très âpres. Début octobre, le 342 fait mouvement vers la Belgique via Compiègne. Il prend part à la bataille des Flandres du 1er au 5 novembre, à Wyschaète, à 10 km au sud d'Ypres, où les combats très acharnés sont particulièrement lourds en pertes humaines. Elie est tué le 4 à 11 heures près de l'ancien moulin du village, attesté par le sergent Bresson Grégoire et par Hermet Marius. Sa dépouille repose sans doute à l'ossuaire du Mont Kemel avec 5 000 autres.
Denis, maçon, de la classe 1910, est mobilisé au 24e BCP à Villefranche-sur-Mer, puis au 64e BCP, à la 7e Compagnie. Le 26 août le 64 débarque à Boves près d'Amiens, après un bref détour par les Vosges. Il est au contact de l'ennemi le 28 à Péronne où il résiste vaillamment et subit de lourdes pertes. Puis c'est la retraite jusqu'à l'Ile Adam au nord de Paris, la bataille de l'Ourcq et celle de l'Aisne à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Soissons. Les 11 et 12 octobre, le bataillon fait mouvement vers Soissons où il prend position à l'ouest de Crouy. Il sera soumis à des feux roulants d'artillerie et à des attaques très meurtrières. Le bataillon ne cédera pas. Denis est tué le 12 janvier 1915 à Crouy, lors de la dernière action menée dans le secteur. Sa dépouille repose au cimetière militaire de Crouy, tombe 693.
Urbain, maçon. de la classe 1913, bien qu'ajourné par deux fois, est mobilisé au 23e RIC à Marseille le 8 mai 1915. Il rejoint la 6e Compagnie du 22, le 10 à Massiges, 15 km au nord-est de Suippes en Champagne. Le 8 juin, le 22 fait mouvement en train vers Amiens. Il se porte au contact de l'ennemi en réserve à Coullement à 10 km au nord-est de Doullens, puis c'est le retour sur Amiens où il réembarque pour la Champagne. C'est de nouveau le secteur de Massiges où tout le monde s'enterre et se prépare à 1'offensive générale du 22 septembre. Le 22, attaque le 25 en direction du nord de Massiges vers le mont Tétu. Le 26. Urbain est décoré à l'ordre du régiment. Le 29, Urbain est tué à l'est du mont Tétu, lors de bombardements intenses. Sa dépouille repose sans doute à la Nécropole nationale de Minaucourt.
Etienne, maçon, de la classe 1896, rejoint à 38 ans le 142 à Mende. Il sera affecté au 3e RI. Après la campagne de Lorraine (Dieuze, retraite de Morhange. Lunéville...), c'est la bataille de la Marne dans le secteur de Bar-le-Duc puis l'Argonne fin septembre entre Avocourt, Malancourt, Vauquois. Il sera blessé grièvement aux Eparges (20 km au sud-sud-est de Verdun), le 24 avril 1915 au moment où il s'élançait à l'assaut. La balle qui l'a frappé a pénétré dans la poitrine par la clavicule gauche après lui avoir entaillé la tête et est venue se ficher dans le cœur. Rapatrié à Marseille, il rejoindra sa famille plus d'un an après.
La mobilisation de cinq enfants de la même famille n'arrête pas de nous surprendre. Que d'inquiétudes pour les parents et les épouses. A tout le moins au décès n'aurait-on pas pu transférer en des lieux moins exposés les frères survivants...
Par deux fois, les 111e et 342e se sont retrouvés, lors de la campagne de Lorraine et de la retraite de Morhange en août 1914, très près l'un de l'autre en particulier au bois Bareth près de Lunéville où ils étaient à moins de 300 m. Les frères devaient l'ignorer.
La lecture des journaux d'opérations est édifiante. Ils mettent bien en évidence les longs déplacements en chemin de fer ou en camions, fruit d'une énorme organisation, et ceux naturellement à pied sur des distances interminables avec le lourd barda sur le dos, la rudesse des bivouacs aux conditions souvent très difficiles par le froid, la pluie, la neige, surtout pendant l'hiver 1914 particulièrement rude, dans l'eau et la boue parfois la poussière, les conditions d'hygiène le plus souvent absentes, les longues veilles dans l'attente de l'assaut et des pilonnages, la faim et la soif dans l'espoir des ravitaillements qui n'arrivent pas et enfin la certitude de l'attaque meurtrière tant de fois renouvelée, dont on pèse si on en reviendra ou pas, ... c'est tout un cortège de souffrances morales et physiques que devaient subir ces hommes de Lozère, dont le courage et l'abnégation font toujours aujourd'hui notre étonnement et notre admiration.
Cette famille aura payé un lourd tribut à la nation, aucune reconnaissance particulière, comme certaines autres de Lozère. C'est notre sentiment du devoir et de la reconnaissance que de garder dans notre cœur familial la mémoire de ces sacrifices.
Mais on est surpris que la leçon ait si peu porté et que quelques années plus tard, la France, l'Europe aient dû subir un nouveau conflit plus pervers encore, laissant d'autres traces de désolation. On respire mieux aujourd'hui que l'Europe se construise enfin dans la paix. Que les bonnes volontés persévèrent, instruments patients et intelligents de son édification, qui, malgré les difficultés, doivent croire dans cette entreprise.
J. LENAIN
Adhérent au Souvenir Français
| Haut de page |
N° 430 - 1er trimestre 1998.
DE CHAMBIERE A NOISSEVILLE 1871-1914
(La Résistance Mosellane à l'annexion allemande)
1 - LE SOUVENIR FRANÇAIS de la Moselle, fort de 15 000 membres, célèbrera le 4 octobre prochain, le 90e anniversaire de l'inauguration du monument érigé à la mémoire des défenseurs de Metz, lors des batailles d'août et septembre 1870.
Il faut en premier lieu rappeler les origines de cet événement :
Après la déclaration de guerre à la Prusse les combats se situent rapidement autour de la forteresse messine ; malgré une victoire tactique à Borny le 14 août, les troupes impériales sont ensuite attaquées par l'ouest à Rezonville le 16, Gravelotte et Saint-Privat le 18 août 1870. L'impéritie du Commandant en Chef de l'armée du Rhin, Bazaine assure la victoire prussienne et ensuite le retrait sous les remparts de Metz qui doit capituler le 27 octobre au Château de Frescaty, rendant 147 000 prisonniers, 54 drapeaux, 1 400 canons, 200 000 fusils aux vainqueurs.
Enfin le traité de Francfort légalise l'annexion de la Moselle et de l'Alsace au nouveau Reich, malgré la protestation des 40 élus de ces régions à l'Assemblée Nationale de Bordeaux en février 1871.
2- LES DÉBUTS D'UN SOUVENIR FRANÇAIS EN MOSELLE :
 Dès le 7 septembre 1871, après un office de deuil en la Cathédrale de Metz, l'évêque Monseigneur Dupont des Loges conduit avec le Maire de Metz un cortège de 40 000 personnes vers le cimetière de Chambière où la ville de Metz a fait ériger un mausolée d'une hauteur de 12 mètres, qui est inauguré ce jour là.
Dès le 7 septembre 1871, après un office de deuil en la Cathédrale de Metz, l'évêque Monseigneur Dupont des Loges conduit avec le Maire de Metz un cortège de 40 000 personnes vers le cimetière de Chambière où la ville de Metz a fait ériger un mausolée d'une hauteur de 12 mètres, qui est inauguré ce jour là.Depuis cette date, l'office est régulièrement célébré à la diligence du Souvenir Français de Metz-Ville, au début septembre. Le 1er novembre sert au fleurissement des tombes de 1870, 1914-1918, 1939-1945.
Dans cet esprit rappelons également l'action des Dames de Metz (Mesdames Winsbeck, Quentin, C1. Auvertin) qui avaient soigné les blessés au moment du siège, et qui faisaient célébrer cet office commémoratif tous les ans.
À partir de 1873 l'opposition à l'occupant s'exprime par l'élection de députés "protestataires" au Reichstag de Berlin.
Cependant une première génération née depuis 1871, atteignait l'âge adulte au début du XXe siècle, le gouvernement allemand pensait à ce moment là à un 26e état "fédéré".
C'est dans ces conditions, après la fondation en 1887 à Neuilly, du Souvenir Français, qu'un Lorrain de Vallières, né en 1872, Jean-Pierre Jean, lança le mouvement du Souvenir Français sur le territoire officiellement allemand en 1906.
Les Comités se multiplient en particulier dans les régions proches de la "fruntière avec la France", mais aussi à Bitche, Forbach, Boulay, Sarrebourg. Depuis 37 ans la Moselle est "allemande" !
Jean-Pierre Jean, modeste typographe, employé au Journal "Le Messin", veut concrétiser matériellement le Souvenir Français, et c'est le projet d'érection du Mémorial en l'honneur des soldais français tombés lors des batailles de 1870.
3 - LE MONUMENT MEMORIAL.
De nombreuses démarches furent entreprises auprès des autorités allemandes. La 1ère réunion se tint en Mairie de Noisseville le 13/1/1907. L'emplacement retenu fut le lieu dit l'Amitié (le terrain étant offert par MM. Beck et Pallez). On choisit le sculpteur Hannaux et un comité d'honneur composé d'éminentes personnalités lorraines se forma, qui recueillit par souscription 57 554 marks. Enfin la 15 mai 1908, le Comte de Zeppelin, Gouverneur de la Lorraine "allemande", adressa à Jean-Pierre Jean, l'autorisation visée personnellement par l'Empereur Guillaume II.
a) Description du Monument :
 Un groupe principal en bronze, avec au premier plan un soldat en tenue 1870 qui tombe mourant dans les plis d'un drapeau tricolore, que soutient une France casquée avec un coq gaulois sur le casque. Le souvenir est exprimé par les traits d'une jeune lorraine en costume local. Notez l'inscription sur une croix de Lorraine : "aux soldats français tombés glorieusement au champ d'honneur".
Un groupe principal en bronze, avec au premier plan un soldat en tenue 1870 qui tombe mourant dans les plis d'un drapeau tricolore, que soutient une France casquée avec un coq gaulois sur le casque. Le souvenir est exprimé par les traits d'une jeune lorraine en costume local. Notez l'inscription sur une croix de Lorraine : "aux soldats français tombés glorieusement au champ d'honneur".b) Les cérémonies d'octobre 1908.
Dès le samedi 3, célébration des offices des cultes chrétiens et israélite à Metz. Le 4 octohre au matin le plateau de l'Amitié à Noisseville fut littéralement occupé par des dizaines de milliers de Lorrains venus par la roule, les chemins, ou la plupart par le train Metz-Nouilly (0,5 km de Noisseville). 70 000 billets pour « Nùlly » déplorait le préposé allemand de la gare de Metz. La police allemande estima la participation à 100 000 personnes. Après l'office solennel dans l'église de Noisseville, le cortège mené par J.-P. Jean, accompagné des hautes autorités allemandes civiles et militaires, se dirigea vers le Mémorial. Après les discours des officiels on dévoila la sculpture : "La Lorraine en deuil pleurant au pied d'un fantassin français blessé". La foule vit surtout les drapeaux français ; on cria "Vive la France" des drapeaux français furent agités, on chanta la Marseillaise ; le tout dans le calme. Ce fut un véritable défi aux maîtres du pays après 37 ans d'annexion.
c) Les conséquences de cette cérémonie.
Cette prise de conscience amena le Souvenir Français à s'organiser en Comité Lorrain du Souvenir Français en décembre 1908, sous la présidence de Jean-Pierre Jean (existence légale grâce à la loi d'empire de mars 1908 sur les associations...). C'est l'exaltation du passé français.
En 1909 développement des comités locaux, on dépasse 2 000 adhérents.
Enfin création de sociétés sportives, telle "La Lorraine sportive" dont l'uniforme (vareuse bleue, culotte blanche, képi français, galons), ressemblait à ceux de l'armée française. On défilait à Metz en jouant au clairon "Au drapeau, Sambre et Meuse". Le Souvenir Français avait réveillé le sentiment français en terre d'Empire. Il fut dissous et transformé par ses membres en Souvenir Alsacien/Lorrain. Quant à la Lorraine sportive, dissoute en janvier 1911 par les autorités allemandes, elle se transforma en Jeunesse Lorraine, dissoute elle-même le 29/12/1911.
Le Souvenir Alsacien-Lorrain lui-même fut dissous le 23 janvier 1913.
Tout cela n'empêcha pas un rapport officiel adressé à la Chancellerie disant : "Après 43 ans d'annexion nos troupes campent en pays ennemi dans le Reischland (Alsace et Moselle)..."
Raoul GAMA
Délégué Général de la Moselle
Jeudi 7 mars 2002 (RL)


Dimanche 5 octobre 2008

Lundi 6 octobre 2008


| Haut de page |


| Haut de page |
| | Retour menu "Vie associative" | Page précédente | Haut de page | Page suivante | |
| raconte-moi-woippy | Retour menu |