| | Retour page précédente | |
HISTORIA N° 145 - Décembre 1958.
LA GRANDE GUERRE
14-18
On l'appellera toujours la « Grande Guerre », parce que, la première, elle s'est étendue au monde entier. En cette année où on fête le 40e anniversaire de l'armistice qui mit fin aux tueries, Pierre Gaxotte a pensé qu'il était bon de faire, pour ceux qui l'ont vécue comme pour ceux qui ne la connaissent qu'à travers les livres, la synthèse, de cette période où les destins de tant de nations se sont joués. Il est précieux d'avoir ainsi l'histoire de ces années difficiles et glorieuses à la fois.
- La guerre, mon général ? Vous n'y pensez pas !
C'était au printemps de 1912. Un jeune officier venait de s'exclamer ainsi devant le général Joffre, nommé depuis quelques mois chef d'état-major général de l'armée. De cette voix basse, égale, blanche qui lui était particulière, Joffre répondit :
- Si, j'y pense. J'y pense même toujours. La guerre, nous l'aurons. Je la ferai. Et je la gagnerai !...
Deux ans plus tard, le fameux communiqué du 25 août '914, commençant par ces mots : « De la Somme aux Vosges... » apprenait que la France était envahie. La formidable machine de guerre allemande déferlait sur le pays. Partout les armées françaises reculaient. Des colonnes de réfugiés s'étiraient sur les chemins.
Le 3 septembre, des rapports d'aviateurs français et anglais signalaient que toute la première armée allemande, sous les ordres de von Kluck, filait vers la Marne qu'elle s'apprêtait à traverser.
Des villes et des bourgades évocatrices de villégiatures paisibles, au bord de la Marne ou du Grand-Morin : La Ferté-sous-Jouarre, Meaux, Coulommiers, Vitry, Sézanne, devenaient des points stratégiques, presque aux portes de Paris.
Alors, pendant trois jours, impassible, presque muet, Joffre le taciturne va échafauder ses plans de bataille.
Plus tard, la paix revenue, il dira à Poincaré, qui le questionnait sur la bataille (le la Marne, à la fin d'une des séances hebdomadaires de l'Académie française :
- Eh ! mon Dieu ! Monsieur le Président, je ne sais pas trop moi-même qui l'a gagnée, mais je sais bien qui l'aurait perdue!...
Le 28 juillet 1911 avait paru, au Journal Officiel, un décret nommant le général Joffre (Joseph, Jacques, Césaire) chef d'état-major général de l'armée, vice-président du Conseil Supérieur de la Guerre, généralissime en puissance. Cette nomination mettait fin à une crise de commandement qui, après la retraite du général Michel, avait failli disloquer le ministère.
Né à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), en 1852, d'un père tonnelier, Joffre était grand, massif, taciturne et passait pour franc-maçon, circonstance de nature à rassurer ceux des républicains qui n'aiment pas les généraux. On le savait ami du directeur de la très radicale Dépêche de Toulouse, des Sarraut et de Doumergue.
Ancien Polytechnicien, il avait opté pour l'arme du génie, fait carrière aux colonies, fortifié la frontière du Haut-Tonkin, pris Tombouctou, fortifié Diego-Suarez et commandé le deuxième corps d'armée à Amiens.
Depuis 1909, il siégeait au Conseil Supérieur, avec la direction des services de l'arrière (chemins de fer, transports, parcs, approvisionnements). De son prédécesseur, il héritait une armée à refaire et un plan de concentration - dit plan XVI - qui supposait que les Allemands viendraient docilement livrer bataille, entre Toul et Epinal, à l'endroit laissé libre par les constructeurs de nos camps retranchés. Rien n'était au point, ni la doctrine, ni l'entraînement, ni l'équipement.

En 1907, les réductions sur les crédits d'armement ayant atteint le tiers des sommes jugées nécessaires, le généralissime désigné avait donné sa démission avec éclat. En 1910, le pays avait eu pour ministre de la Guerre un extraordinaire général Brun, qui répondit une fois à un député inquiet :
- Ne vous échauffez pas... Vous êtes de ces emballés qui croient encore à la possibilité d'une guerre...
Et, une autre fois, à un chef de bataillon d'origine alsacienne, qui lui apportait des renseignements sur la transformation de l'artillerie allemande :
- C'est intéressant, très intéressant. Mais, mon pauvre ami, vous croyez donc que là guerre éclatera jamais ?
À peu près vers le même temps, un illustre universitaire, Charles Seignobos, professeur d'histoire moderne à la Sorbonne, expliquait, dans un article de la Gazette de Francfort, qu'il n'y aurait plus de guerre, parce que les guerres usent les armées et que les militaires ne voudraient pas abîmer leur jouet. Le temps de « la revanche » était bien passé.
Joffre, en trois ans, fit de son mieux. Il réorganisa le commandement, et quand le gouvernement allemand eut, par les deux lois de mars 1911 et de juin 1912, augmenté ses effectifs d'active, pour les porter à plus de 800 000 hommes, il demanda et obtint le vote du service de trois ans, qui rétablissait à peu près l'équilibre (700 000 hommes pour nous).
Le vote -de la loi ne fut pas acquis sans peine. Joffre assistait son ministre. Il entendit un député exposer que « les trois ans, c'est l'armée abêtie, passive et prête à tout dans la main de chefs ennemis de la République... », et un autre s'écrier que c'était « une attaque brusquée de la réaction », « un attentat contre la démocratie », « un attentat contre les nations ».
Il écoutait tout, impassible, indifférent, faisant semblant de dormir quand il était attaqué personnellement. Mais il n'oublia pas ces séances, et si, en 1915 et 1916, il n'a pas aimé que les parlementaires, même avec de bonnes intentions, vinssent rôder aux armées et autour des quartiers généraux, c'est parce qu'en 1913 ils ne lui avaient pas donné bonne opinion d'eux-mêmes.
En mai 1914, la France vota. Le bloc des gauches (socialistes et radicaux) remporta une victoire écrasante. Il avait pris pour plate-forme : la folie des armements et l'abolition des trois ans.
Le ministère Viviani promit de revenir dès que possible à un service raccourci et s'engagea, en contrepartie, de ce maintien provisoire, à faire voter l'impôt sur le revenu. Il est assez remarquable que le corps électoral, quatre mois avant la guerre de 1914, ait envoyé au Parlement la législature la plus antimilitariste qu'ait connue la République jusqu'alors. La conduite de la guerre n'en sera pas facilitée.
Nous étions assez mal renseignés sur les intentions allemandes, car notre service de renseignements était sorti en débris de l'affaire Dreyfus. On en savait assez cependant pour redouter que la guerre ne fût Das, comme en 1870, limitée à la frontière germano-française.
Par un traître, qui avait agi sous le coup d'une grave offense personnelle, on avait eu vent du plan Schlieffen, lequel comportait l'invasion de la Belgique et une immense manœuvre de débordement par les vallées de la Sambre et de l'Oise, de façon à tourner les forces françaises engagées face à l'est.
On savait aussi que divers travaux avaient été entrepris dans la région de Cologne-Aix-la-Chapelle pour accroître le rendement des voies ferrées, mais on n'en savait pas beaucoup plus et comme, en ce temps-là, on n'avait pas encore l'habitude des violations de traités, beaucoup tenaient le plan Schlieffen pour une rêverie d'école.
En outre, même si l'invasion de la Belgique par l'Allemagne était certaine, nous devrions attendre, pour agir, qu'elle fût un fait accompli, par crainte de nous aliéner l'opinion mondiale, et spécialement l'opinion anglaise.
Était-il du moins possible de s'entendre avec le gouvernement belge pour le cas où... ? Diverses démarches faites en 1912 échouèrent toutes également.
Bref, pour garder le rôle et le prestige de l'innocence, le gouvernement français ne voulut pas que la région du nord fût équipée en vue de la concentration, car les travaux eussent été trop voyants. Comme l'a écrit Poincaré, les raisons diplomatiques et morales l'emportèrent sur les considérations militaires.
Tout cela ne s'accordait guère avec les projets arrêtés en commun avec la Russie: pour ne pas donner à l'Allemagne la possibilité d'écraser d'abord l'un de ses adversaires et de se retourner ensuite contre l'autre avec toutes ses forces, les deux puissances devaient, en même temps, s'engager à fond avec diligence.
C'est pour répondre à ces exigences contradictoires que fut élaboré le plan XVII. Joffre n'avait pas de génie. Mais il connaissait son métier pour y avoir beaucoup réfléchi. Son plan fut un plan à tiroirs, en vue de plusieurs éventualités : la concentration s'arrêterait à l'Oise, mais la plus forte armée (général Lanrezac) serait placée à gauche et, en cas d'entrée en Belgique, elle serait renforcée par une réserve maintenue provisoirement dans la région d'Hirson, par le corps d'Afrique et par l'armée anglaise, éventuellement. En outre, tout était prévu pour la faire glisser, en cas de besoin, cent kilomètres plus au nord.
La manoeuvre générale comportait deux actions : une attaque en Lorraine pour y fixer le plus de monde possible, une attaque à travers les Ardennes (l'inverse du plan Hitler de 1940) pour attaquer de flanc la droite ennemie en marche.
Si, dans les années qui ont précédé 1914, quelque chose semblait garantir la paix, c'est que les vaincus de 1871 ne songeaient plus à reconquérir l'Alsace-Lorraine. Plus peuplé que la France (60 millions d'habitants contre 39), pourvu d'un gouvernement plus stable et mieux obéi, le Reich était si fort que personne ne pensait à l'attaquer.
D'ordinaire, le vainqueur se garde (le remettre en question sa victoire. C'est cependant ce que Guillaume II a fait et, depuis 1901, une série continuelle d'incidents et de conflits (discours de Tanger, en 1905, affaire des légionnaires déserteurs à Casablanca, en 1908, envoi d'un navire de guerre à Agadir, en 1911, cession par la France d'une partie du Congo contre les mains libres au Maroc, en 1911) avait montré notre voisine de plus en plus exigeante, difficile, redoutable. On la sentait pressée par un trop-plein d'hommes, emportée par des rêves d'expansion à tout prix, de plus en plus travaillée par le pangermanisme et par le vertige de la force.
Mais l'inquiétude, vivement ressentie dans les provinces les plus exposées à l'invasion et par un certain nombre d'intellectuels, en marge du monde politique, n'avait pas pénétré la foule.
Quand, le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, fut assassiné à Sarajevo par des terroristes bosniaques, plus ou moins encouragés par les nationalistes serbes, elle n'y vit d'abord qu'un fait divers. Au fond, elle croyait la guerre impossible. Elle se figurait que si Guillaume II et les officiers prussiens en avaient le désir, le peuple allemand ne les suivrait pas. Le procès de Mme Caillaux, qui avait tué le directeur du Figaro, occupait bien davantage l'attention.
On se doutait si peu de ce qui allait se passer que le président de la République, Poincaré, accompagné de Viviani, s'en alla, sans trop d'inquiétude, rendre une visite au tsar Nicolas.
Ils quittèrent Saint-Pétersbourg le 23 juillet, comme un ultimatum autrichien était remis à la Serbie. Le gouvernement de Vienne exigeait non seulement la dissolution de toutes les associations s'adonnant à la propagande contre l'intégrité territoriale de l'Autriche-Hongrie, l'arrestation de toutes les personnes suspectes de trafic d'armes (demandes acceptables), mais encore la collaboration à l'intérieur de la Serbie de la police austro-hongroise (condition qui fut rejetée le 25).
Le 28, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie et, par le jeu des alliances,, toute l'Europe s'enflamme. La France avait vu dans l'alliance russe une garantie de paix: c'est par le slavisme que venait la guerre.
Le 1er août, à 15 h 55, la mobilisation générale est décrétée, pour commencer le dimanche 2. On rassure encore les Français. On leur dit que « la mobilisation n'est pas la guerre ». Viviani ordonne que nos troupes se retirent à dix kilomètres de la frontière :
Mais il est impossible de refuser le combat. Si nous avions déclaré notre neutralité, l'Allemagne , aurait exigé comme gage la remise de Toul et Verdun. Et que serait-il arrivé ensuite ?
Le peuple français le comprit. La mobilisation bien préparée eut lieu avec ordre et confiance. L'assassinat du chef socialiste Jean Jaurès par un déséquilibré ne causa pas le moindre trouble. Pour sa défense, les illusions balayées, la nation se trouva unie.
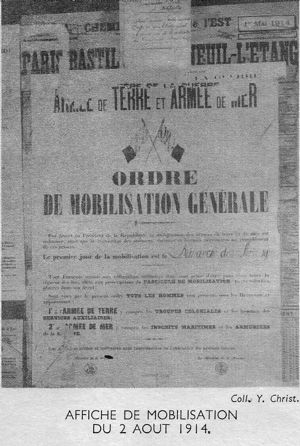 Ce qu'elle ne savait pas, c'est à quel point la préparation allemande était supérieure à la sienne. Nos soldats avaient encore le pantalon rouge, donné jadis à l'armée pour sauver la garance méridionale, qui ne trouvait plus d'acheteurs.
Ce qu'elle ne savait pas, c'est à quel point la préparation allemande était supérieure à la sienne. Nos soldats avaient encore le pantalon rouge, donné jadis à l'armée pour sauver la garance méridionale, qui ne trouvait plus d'acheteurs.La déclaration de guerre de l'Allemagne à la France est du 3 août au soir, l'invasion de la Belgique du 4 au matin, la déclaration de guerre de l'Angleterre à l'Allemagne du 5 au matin, le premier fort de Liège est enlevé le 8, le dernier le 16.
En France, des transports de concentration commencent le 5 et sont terminés le 12 pour les troupes actives : ils ont exigé 2 500 trains. Le transport des divisions de réserve et des divisions territoriales, du 12 au 18, en exigea 4 500.
La première bataille (20-24 août) fut une défaite, un peu par la faute de certains exécutants, beaucoup parce que les véritables forces de l'ennemi nous étaient inconnues.
La droite allemande était, en effet, beaucoup plus puissante et elle s'étendait beaucoup plus à l'ouest que Joffre ne l'avait pensé. Elle comprenait un certain nombre de corps de réserve portant les mêmes numéros que les corps d'active ils n'avaient pas été décelés par nos services de renseignements. La supériorité allemande en artillerie lourde et en mitrailleuses était certaine, écrasante.
Bref, sur tout le front, échecs. Mulhouse prise doit être évacuée. Les armées Dubail et Castelnau, engagées dans la région Sarrebourg-Dieuze sont arrêtées et repoussées. L'attaque par les Ardennes (général de Langle de Cary) est brisée. Sur la Sambre, à Mons, à Charleroi, notre gauche, renforcée par l'armée anglaise de French, est rejetée, de position en position, et en grand danger d'être enveloppée.
Le 24, Joffre donne l'ordre de retraite ; Verdun (général Sarrail) servira de pivot au repli. L'instruction générale n° 2, en date du 25 août, vingt-deux heures, prescrivait que, durant cette retraite, la liaison entre les armées devrait être maintenue à tout prix et que l'offensive serait reprise, dès que la gauche serait suffisamment renforcée.

Couverte par quelques contre-attaques réussies (dont l'une dans la région de Guise), la retraite s'effectua avec assez d'ordre pour ne jamais dégénérer en déroute.
Alors que le généralissime allemand von Moltke, neveu du vieux feld-maréchal de 1870, ne dirige l'avance que de très loin, s'en remettant aux inspirations de ses subordonnés, le Français ne cesse d'informer ses généraux d'armée et contrôler leurs mouvements. Il se rend à plusieurs reprises auprès de French; qui a reculé trop vite et qui pense se retirer sur les côtes. II constitue, avec des forces prélevées dans les Vosges, en Algérie et à l'intérieur, deux nouvelles armées, l'une (général Foch) qu'il intercale au centre distendu, l'autre (général Maunoury) qui s'engagera à l'extrême-gauche.
Le 30, enfin, alors que l'armée allemande commence à dessiner un énorme arc de cercle entre Paris et Verdun, avec des communications très allongées et passant par la Belgique et le Luxembourg, il fixe les principes de la nouvelle offensive.
Le mérite de Joffre, dans cette semaine décisive, fut de garder un calme imperturbable, en dépit du flot de mauvaises nouvelles, d'imposer peu à peu son ascendant aux Anglais, de ne rien précipiter et de réunir toutes les chances dans sa main. De la petite salle d'école de Bar-sur-Aube, où il a installé son quartier général, il suit, heure par heure, le mouvement de la droite allemande.
Contournera-t-elle Paris par l'ouest pour se porter sur la Basse-Seine ? Attaquera-t-elle la capitale ? Passera-t-elle à l'est, pour poursuivre l'armée française que les généraux von Klück et von Bulow croient en débandade complète ?
En attendant, les transports à l'arrière s'effectuent avec célérité. Hommes, munitions, approvisionnements, arrivent à pied d'œuvre.
Le 3 septembre, enfin, les avions et les reconnaissances de cavalerie du camp retranché de Paris annoncent que l'armée von Klück, arrivée à Senlis, ne poursuit pas son mouvement dans la même direction, qu'elle a obliqué vers le sud-est, qu'elle et sa voisine poussent vers la Marne, qui va être atteinte le jour même par les têtes de colonne.
Il est assez piquant que Joffre ait connu les positions et les mouvements exacts de von Klück, avant même que celui-ci n'en ait rendu compte à son chef suprême.

La bataille de la Marne est fort mal nommée. Elle s'est livrée sur l'Ourcq, sur le Grand-Morin, sur l'Ornain, dans l'Argonne et très peu sur la Marne, sauf à cheval sur les deux rives, à Meaux, à l'extrémité gauche de l'arc de cercle et à Vitry-le-François, presque à l'autre bout.
 En gros, le front dessinait une sorte de poche incurvée au sud, dont le fond était jalonné par les villes et les bourgs dé Nanteuil, Meaux, Coulommiers, Sézanne, Sommesous, Vitry, Revigny et Souilly.
En gros, le front dessinait une sorte de poche incurvée au sud, dont le fond était jalonné par les villes et les bourgs dé Nanteuil, Meaux, Coulommiers, Sézanne, Sommesous, Vitry, Revigny et Souilly.Les ordres de Joffre prescrivaient (après une journée de demi-repos) de prendre l'offensive le 6 septembre. Le but à atteindre était d'écraser la droite ennemie aventurée et, si possible, de désarticuler le centre. Un message numéroté 3948 devait être lu aux troupes. C'est le célèbre ordre du jour « A l'heure où s'engage la bataille... »
Le 5, Joffre se rendit au Q.G. anglais pour obtenir la coopération de French. D'une voix égale, assez basse, il expliqua ce qu'il comptait faire, puis il fit ressortir que le succès de la manœuvre à sa gauche, dépendait, pour une bonne part, de la vigueur et du cran des Britanniques.
Sa voix se fit forte et passionnée et, comme il craignait encore quelque réticence, il abattit son poing sur la table et conclut durement :
- Il y va de l'honneur de l'Angleterre, monsieur le maréchal.
Le maréchal était ému. Il essaya de dire quelques mots en français. N'y parvenant pas, il se tourna vers l'officier qui était près de lui.
- Dites-lui que tout ce qui est humainement possible de faire, nos boys le feront.
Un général corrigea aussitôt que les boys ne seraient pas prêts à six heures du matin, mais seulement à neuf.
- On n'y peut rien, répliqua Joffre. Qu'ils partent dès qu'ils pourront. J'ai la parole du maréchal, cela me suffit.
En fait, la bataille qui devait s'engager le 6, avait commencé le 5. Le général Gallieni, gouverneur de Paris et subordonné de Joffre, avait ce jour-là, de sa propre autorité, poussé en avant l'armée Maunoury (les derniers arrivés furent transportés en taxis) et accroché von K1ück.

Compromis à droite, l'ennemi chercha une riposte au centre (contre Foch) et le pivot de Verdun : il échoua doublement. Repoussé également devant Nancy (Castelnau au Grand-Couronné), il était le 12 en retraite sur tout le front. La bataille s'achevait sur une victoire incontestable.
Le gouvernement, réfugié à Bordeaux avec les Chambres, en éprouva une sorte de vertige. Il avait peur du général victorieux. Certains calculaient que l'Alsace reconquise augmentait la représentation « cléricale » à la Chambré.
Les drapeaux pris furent soigneusement cachés pour ne pas trop exalter le public, le ton des communiqués, baissés de plusieurs tons. Joffre eut même la surprise de lire sous sa signature quelques phrases qu'il n'avait pas écrites.
L'offensive russe en Prusse orientale devait se terminer en désastre, mais lancée très tôt, elle avait soutenu le moral des civils (« Les cosaques à cinq étapes de Berlin » titrait un journal parisien) et surtout contraint Moltke à prélever, à l'ouest, deux corps d'armée qui lui avaient manqué cruellement.
Schlieffen, dit-on, était mort en répétant : « L'aile droite ! Renforcez l'aile droite ! Guillaume Il l'avait affaiblie pour sauver son royaume de l'invasion : le roi de Prusse avait fait battre l'empereur d'Allemagne.
| Haut de page |
HISTORIA N° 146 - 1er trim. 1959.

par PIERRE GAXOTTE
de l'Académie française
Au lendemain de la victoire de la Marne, la guerre avait trompé toutes les prévisions. Les états-majors avaient célébré, des deux côtés, les vertus de l'offensive après cinq mois, les armées s'enterraient dans les tranchées, la guerre de mouvement se muait en une guerre immobile qui ressemblait plus aux sièges de Vauban qu'aux campagnes de Napoléon.
On avait cru à la bataille décisive rien n'était décidé et les munitions manquaient. Les économistes avaient prophétisé une guerre courte, en soutenant que les richesses des nations ne permettaient pas de la faire longue : le crédit et la monnaie de papier firent surgir des ressources qu'on ne croyait pas pouvoir mobiliser.
L'immensité de la catastrophe devint elle-même une raison d'aller jusqu'à la victoire complète. La guerre de peuple à peuple se montrait seulement plus acharnée, plus sanglante que les petites guerres dynastiques d'autrefois et personne n'était capable d'y mettre un terme par les moyens qui réussissaient jadis.
Comment s'y prendrait-on pour forcer le front ennemi ? Plus généralement, était-il possible de laisser l'armée totalement inactive, comme on le fit en 1939-1940, durant la « drôle de guerre » au risque de détruire le moral de la troupe, sur qui l'ennemi, très actif, aurait eu toujours l'ascendant ?
L'année 1915 fut mauvaise. Les combattants lancés contre les barbelés et contre les tranchées ennemies, pour améliorer une position ou pour détruire un observatoire, eurent souvent le sentiment que les résultats à espérer ne valaient pas les sacrifices qu'on leur demandait.
Les opérations plus importantes, après des succès initiaux, s'arrêtèrent vite, sans que la muraille adverse, un moment ébranlée, ait pu être abattue sur une assez large profondeur.
Le plan français cependant n'était pas déraisonnable. Entre Verdun et la mer, le front allemand dessinait un angle droit, une équerre, dont le sommet se trouvait au nord de Soissons, sur les plateaux calcaires qui dominent l'Aisne d'une pente très abrupte.
Serrer sur ses deux flancs cette équerre, les rompre simultanément en Artois et en Champagne, pénétrer jusqu'aux lignes de « rocade » qui, courant derrière le front allemand, assurent ses liaisons latérales, disloquer ces liaisons et du même coup contraindre l'ennemi à refluer sur la base trop étroite de la Meuse : telle sera la pensée de Joffre dès la fin de 1914. Telle sera aussi celle de Foch en 1918.
Mais, en 1915, les moyens offensifs manquaient. Les moyens défensifs, mitrailleuses, grenades, mortiers, l'emportaient de beaucoup par le feu sur l'assaut de l'infanterie, sans que l'artillerie possédât encore la puissance et la mobilité nécessaires, pour les réduire au silence sur un assez vaste espace.
Presque partout, la défense allemande comportait plusieurs lignes de tranchées successives, la première n'étant occupée que par peu d'hommes mais par beaucoup de mitrailleuses sous casemates. Les boyaux en zigzag qui réunissaient les tranchées l'une à l'autre étaient garnis des deux côtés de banquettes de tir et couverts par des réseaux, de telle sorte qu'ils pouvaient se transformer en tranchées de tir, donnant des feux flanquants en arrière de la ligne. Enfin, les villages, les fermes, les moulins isolés étaient organisés sur toutes leurs faces pour pouvoir résister, même investis, les voûtes des caves étant redoublées par du béton. Des abris souterrains pour l'infanterie complétaient le système.
L'offensive de mars en Champagne, l'offensive de mai-juin en Artois, l'offensive de septembre en Champagne, de mieux en mieux préparées, avec une artillerie de plus en plus dense et des effectifs de plus en plus nombreux, enfoncèrent en général les premières défenses allemandes, mais, à chaque fois, il fut impossible d'alimenter la bataille et de soutenir l'effort.
Il en resta, dans l'esprit des unités engagées, des souvenirs d'affreux corps à corps. En septembre, par exemple, en Champagne, les troupes d'assaut passent la nuit du 24 au 25 dans les boyaux et les parallèles de départ.
À neuf heures du matin, elles sont prévenues que l'attaque est pour le quart. L'artillerie pilonne les lignes ennemies depuis trois jours. Les capitaines ont l'oeil fixé sur leur chronomètre. Les ordres passent de bouche en bouche. On approvisionne les fusils. Les baïonnettes sont assujetties. Quelques-uns s'embrassent. Certains, les joues rouges, parlent vite. La plupart se taisent. Une attente angoissante crispe le caeur.
Au quart, l'artillerie allonge le tir. Les commandements éclatent. « Les grenadiers en tête ! » « En avant la troisième ! ». Les fantassins sautent des tranchées. Les clairons sautent avec les autres. « Allons ! Dépêchons... Dehors !... » La vague fonce en hurlant. Il faut lire dans les livres des témoins, ce que furent ces heures atroces, où la France fut si grande.
Mais tant de sang versé restait vain.
Désespérant de « percer » à l'ouest, les Alliés essayent de forcer les Dardanelles (la Turquie s'était rangée aux côtés de l'Allemagne, en octobre 1914), n'y réussissent pas, parce qu'on ne réduit pas des fortifications avec des bateaux (février-mars 1915) et reportent à Salonique les troupes débarquées. Les Russes avaient occupé la Galicie, mais ils étaient battus en Pologne : le désir de leur venir en aide avait beaucoup pesé sur les décisions d'attaque en France.
« Il faut, écrivait le général Foch, chargé du front nord, renoncer à l'assaut brutal en masses plus profondes et denses, avec les réserves sur les talons de la première ligne, visant à enlever d'un seul bond plusieurs séries d'obstacles jusqu'à percer, car il n'a jamais réussi... » Il faut « armer fortement l'offensive tactique », la vouloir « peu coûteuse en hommes », donc « beaucoup d'artillerie... beaucoup d'artillerie lourde avec beaucoup de munitions ».
Il faudrait surtout des moyens nouveaux. En janvier 1915, les Allemands ont lancé les premiers obus à gaz asphyxiants qui chargèrent le soldat d'un nouvel accessoire, le masque. Mais l'obus à gaz n'est pas décisif. Le général Joffre fait adopter par les Russes et par les Italiens (en guerre à nos côtés depuis mai 1915) le principe d'une offensive simultanée à l'est et à l'ouest. Le terrain choisi en France s'étend de part et d'autre de la Somme, sur 45 km de front. Quarante-deux divisions y participeront, avec 1700 pièces d'artillerie lourde.
De son côté, dans son rapport de Noël 1915 à Guillaume II, le général von Falkenheyn disait :
« Les tentatives de rupture en masse contre un adversaire moralement intact, bien armé et qui n'est pas trop inférieur en nombre, même en accumulant les hommes et le matériel n'ont pas beaucoup de chances de succès. Le défenseur réussira dans la plupart des cas à verrouiller les zones enfoncées... Les poches, fortement exposées à l'action des feux de flanc, menacent de devenir un cimetière pour les masses qui les occupent. La difficulté technique de conduire et de ravitailler ces masses est presque insurmontable. »
Falkhenheyn proposait donc d'attaquer Verdun, point d'appui du front français depuis la retraite de 1914. Si Verdun tombait, tout notre front de Lorraine s'écroulerait en même temps. Si les Français s'obstinaient à défendre le camp, ils y épuiseraient leur armée, alors que les conditions géographiques et les facilités de communication permettent aux Allemands de n'engager que « des forces pas très considérables ».
Les Allemands furent prêts les premiers, mais si précautionneux que soient les préparatifs d'une offensive, il est impossible de les dissimuler tout à fait. En janvier 1916, Joffre, alerté par Gallieni, alors ministre de la Guerre, envoya Castelnau inspecter les défenses de Verdun.
Il trouva la première ligne à peu près organisée, bois des Caures, bois d'Hanmont (rive droite), bois des Corbeaux (rive gauche), la deuxième embryonnaire. Il fit aussitôt venir deux divisions de réserve pour y travailler. Les voies ferrées desservant la ville étant, ou coupées, ou sous le feu de l'ennemi, ou réduites à un chemin de fer d'intérêt local à voie étroite, une route à double circulation, sens montant et sens descendant, fut établie et un immense parc de camions réuni à l'arrière.
Le 20 février, la route est prête, le 21 l'attaque, précédée par un raid de zeppelins sur la France (la plupart furent détruits) commence par un bombardement de 210, de 380 et de 420. Le nombre des batteries est tel que nos observateurs en avion renoncent à compter celles qu'ils repèrent. A cinq heures, la première attaque d'infanterie est lancée, pour occuper saut par saut le terrain rendu intenable par l'artillerie...
 La journée la plus critique est le 24. La lutte qui se livre rive droite, sur les collines couvertes de neige, dans les bois hachés par les projectiles, sur un sol qui n'a plus de forme, dans le fracas assourdissant et meurtrier des milliers d'obus, est si confuse qu'il est impossible d'en suivre les péripéties.
La journée la plus critique est le 24. La lutte qui se livre rive droite, sur les collines couvertes de neige, dans les bois hachés par les projectiles, sur un sol qui n'a plus de forme, dans le fracas assourdissant et meurtrier des milliers d'obus, est si confuse qu'il est impossible d'en suivre les péripéties.Mais quand tombe la nuit, la ligne française est si compromise que le général Herr, commandant l'armée, le général de Langle, commandant le groupe d'armée, avisent Joffre, alors installé à Chantilly, qu'ils craignent d'être contraints de repasser la Meuse.
Joffre refuse. On tiendra sur la rive droite : tel est l'ordre et il envoie Castelnau pour le faire exécuter. Quant au général Herr, à bout de forces, il est remplacé par un chef connu pour son calme, le général Pétain. Pétain arrive à son Q. G. pour apprendre la stupéfiante nouvelle de la perte du fort de Douaumont, que ne défendait aucune garnison. Castelnau étend son commandement à toute la région et à minuit il reçoit de Chantilly ce message :
« Ordre est donné de résister sur la rive droite de la Meuse, au nord de Verdun. Tout chef qui, dans les circonstances actuelles, donnera un ordre de retraite, sera traduit en conseil de guerre. » Joffre avait confiance dans ses subordonnés, mais il tenait à être bien compris. » La bataille dura sept mois. La plupart des divisions françaises y participèrent, inondant de leur sang ce sol désormais sacré. On se battit pour une crête, pour la corne d'un bois, pour cent mètres de tranchées, pour un ravin, pour les ruines d'un hameau. En juin, l'ennemi tente encore un immense effort qui échoue.
Du 21 février au 15 juin 1916, l'artillerie française a consommé 10 300 000 obus de 75, 3 800 000 obus de calibres moyen et gros. Mais il est impossible de chiffrer le courage, l'abnégation, la volonté. » En septembre, la situation est retournée. Les Français (général Nivelle, général Mangin) passent à la contre-attaque et inaugurent une tactique nouvelle. Après une préparation d'une violence extrême, le barrage d'artillerie s'avance suivant un horaire fixé, précédant de peu la vague d'infanterie qui, peut-on dire, colle à ses éclats.
Jusque-là, le barrage avait ressemblé à un écran qu'on lève de temps à autre et qu'on pose plus loin. Maintenant, il progresse d'une façon lente et continue, avec des insistances sur les points difficiles et des pauses pour permettre la réorganisation des troupes. L'infanterie a répété son rôle sur un terrain analogue. Les forts de Douaumont et de Vaux sont repris.
En décembre, nouvel assaut préparé avec la même minutie : le barrage roulant est précédé d'un autre, par des pièces à tir courbe, qui coupent la retraite à l'ennemi ou, comme on disait, qui l' « encage ». En pratique, le front est reporté à la ligne de février.
Ces grands succès étaient dus pour une part à l'offensive de dégagement lancée le 24 juin de part et d'autre de la Somme par les Français (général Foch) et par les Anglais. Par suite des pertes subies à Verdun, le plan primitif avait été quelque peu modifié et la coopération de nos alliés demandée.
Le but de l'opération était toujours de porter une masse de manaeuvre sur les lignes de communication ennemies, en prenant pour axe de l'avance la route Bapaume-Cambrai. Les Français devaient attaquer sur un front de 12 km, les Anglais sur un front de 25 km. Le 1er juillet, l'infanterie sortit des tranchées ; ce fut d'abord un succès quasi total.
Les Alliés avaient la maîtrise de l'air à 10 contre 1, et leur artillerie de destruction avait surclassé la défense.
 La bataille dura quatre mois : elle montra que nos méthodes étaient les meilleures, qu' « on ne recommençait pas les bêtises de l'an passé », comme disait Foch, et elle épuisa l'armée allemande.
La bataille dura quatre mois : elle montra que nos méthodes étaient les meilleures, qu' « on ne recommençait pas les bêtises de l'an passé », comme disait Foch, et elle épuisa l'armée allemande.Cependant, après une progression de 15 à 20 km, il fallait s'arrêter.
Pourquoi Y Tout d'abord, le front d'attaque était, malgré tout, trop étroit, et nos moyens ne nous permettaient pas encore d'opérer sur un espace plus large : l'avenir dépendait de l'industrie ; le sort de la guerre, de plus en plus, se jouait dans les usines et dans les arsenaux... Ensuite, après chaque succès, il fallait, avant de monter une nouvelle progression, procéder à des déplacements d'artillerie et de munitions dans un terrain dévasté, d'où un rythme trop lent, qui à chaque fois permettait à l'adversaire de se reprendre et d'engager ses réserves.
Joffre prévoit donc, pour le ler février 1917, une offensive d'ensemble entre Arras et l'Oise et, quinze jours plus tard une seconde en Champagne, entre Craonne et Reims, de part et d'autre du plateau calcaire.
Le 16 mars, Hindenburg, successeur de Falkenheyn, fait reculer ses armées entre la Scarpe et l'Aisne, sur une profondeur qui dans la partie centrale (Roye, Ham, Noyon) atteint 40 km. Le terrain abandonné est systématiquement dévasté. Les journaux publient des photographies d'arbres en fleurs sciés au ras du sol. Si le plan de Joffre avait été exécuté, les Allemands eussent été surpris en cours de déménagement. Mais à ce moment Joffre n'était plus commandant en chef.
Depuis que la bataille de la Marne avait mis Paris à l'abri des Allemands, la vie parlementaire avait repris, avec sa vaine agitation. Tout n'était pas parfait au grand état-major, mais tout était pire à la Chambre. Dans les discussions tout se mêlait, la vente des apéritifs, les sentiments religieux des officiers de carrière, l'impatience de la victoire, le vieil antimilitarisme qui avait triomphé aux élections de 1914 et qu'irritait la puissance forcée du généralissime. Les généraux appelés au ministère de la Guerre, Gallieni, Roques, en attendant Lyautey, eussent voulu prendre la direction des opérations. De Salonique, où il a été envoyé pour avoir trop cabalé, Sarrail alimente la campagne contre Joffre. Les députés envoyés en inspection dans la zone des armées ne se contentent pas d'enquêter sur les objets précis de leur mission. Ils provoquent et en reviennent les serviettes bourrées de griefs, ramassés au petit bonheur.
À plusieurs reprises, sous prétexte d'être mieux informée, la Chambre siège en « comité secret » (les comptes rendus des séances courent aussitôt Paris). Joffre y est accusé de s'entourer d'un état-major clérical, de refuser des renforts à Sarrail parce qu'il est républicain, de vouloir conduire la guerre par gloriole... On l'accuse d'impéritie, de menées factieuses, de complot ténébreux.
Briand le défend mollement, puis cède. Joffre quittera le commandement en chef, pour présider un vague comité de coordination, le 13 décembre. Encore, à la rédaction du décret (27 décembre 1916) tourne-t-on les phrases de façon à lui ôter toute influence. Exaspéré, il donne sa démission. Pour atténuer le trouble de l'opinion, on le nomme maréchal de France, ce qui semble lui laisser une prééminence, mais on oublie de lui remettre le bâton. Finalement, Poincaré le lui remet en catimini dans son bureau de l'Elysée.
Le successeur de Joffre était le général Nivelle : c'est lui qui avait repris Douaumont et Vaux. Briand et les parlementaires étaient convaincus qu'il avait trouvé la recette pour gagner la guerre. Lui-même n'était pas loin de le penser aussi. Mais il n'y avait pas de commune mesure entre l'opération de Douaumont, engagée sur deux ou trois kilomètres de large pour la reconquête d'une position définie, et la percée du front ennemi.
Cependant, disait Nivelle, dans sa première note de doctrine, « la rupture du front est possible à condition de se faire d'un seul coup par une attaque brusquée de vingt-quatre ou de quarante-huit heures ». Après quoi « le terrain sera libre pour aller où l'on voudra, à la côte de la mer du Nord, comme à la capitale belge, à la Meuse ou sur le Rhin. Alors, il y aura une splendide moisson de gloire pour les armées française et britannique ». On imagine avec quelle avidité triomphante les politiciens se jetèrent sur des phrases aussi prometteuses.
Nivelle décida tout de suite d'abandonner l'attaque par la Somme qui était prête et d'en monter une autre à l'articulation même du front allemand, sur et contre le plateau de l'Aisne, creusé de grottes, de vallées et de ravins, terrain particulièrement difficile. Il fallut reprendre les préparatifs : d'où retard.
Dans l'intervalle, la révolution russe était survenue, la vieille armée tsariste, souvent repoussée, mais jamais anéantie se dissolvait dans l'anarchie. Les Allemands sont libres de prélever sur leur front oriental tous les renforts dont ils peuvent avoir besoin pour fermer une brèche et colmater une poche. La disgrâce de Joffre a surexcité les ambitions parlementaires. Tout le monde veut dire son mot dans la préparation de l'offensive. Le gouvernement consulte les subordonnés de Nivelle sur la confiance qu'il convient d'accorder à son plan. Les réponses sont en sens divers. Nivelle offre sa démission, on le supplie de la reprendre (6 avril).
L'attaque a lieu le 16 avril au matin. Elle obtient un succès initial, mais la seconde position ennemie n'est abordée que sur un point. Le 16 au soir, il est certain que la percée ne sera pas faite.
Le 10 mai 1917, désormais tenu, par ceux-là mêmes qui l'avaient appelé, pour un dangereux illusionniste, le général Nivelle est remplacé par le général Pétain. On disait à la Chambre : « Enfin, nous avons trouvé un général qui n'attaquera pas. »
L'échec du 16 avril fut désastreux pour le moral de l'armée, d'autant plus désastreux que, du fait des indiscrétions et des interventions civiles, la préparation de l'offensive s'était faite presque au grand jour. On avait colporté les espérances gigantesques.
Une déception énorme déferla. Jusqu'alors, en dépit des épreuves, l'armée avait tenu. Et pourtant Verdun avait été un enfer. Qu'on se représente le transport en camions, sur la route unique, la relève en pleine nuit dans les tranchées bouleversées et semées de cadavres, avec ses piétinements et ses lenteurs, le séjour dans les trous d'obus, l'enlisement dans la boue tenace, les attaques de l'ennemi, les lance-flammes, les gaz, le spectacle des camarades broyés, hachés, enterrés, le bombardement continu, hallucinant, secouant les corps... Mais l'espérance avait soutenu.
Cette fois, on a peine à croire à la victoire possible. On n'a pas percé. On ne percera pas. Et puis le fantassin a des raisons particulières de se plaindre : les cantonnements de repos sont mal organisés, impossibles ; les permissions (en principe une d'une semaine tous les quatre mois) sont données sans ordre ; la nourriture arrive froide ; le courrier est toujours en retard ; il y a de plus en plus d'embusqués ; le soldat est traité comme un outil...
Tous ces griefs n'étaient pas mal fondés. Mais, cette fois, la révolution russe a donné l'exemple. Le défaitisme encouragé s'affermit. Il a son journal, Le Bonnet rouge, ses agents actifs. Des tracts nombreux sont envoyés aux armées, sous forme de lettres. D'autres sont distribués aux permissionnaires dans les gares. Le ministre de l'Intérieur, Malvy, ne fait rien contre la propagande défaitiste. Les discours prononcés à la Chambre contribuent à ruiner la confiance et la discipline. Des socialistes de tous les pays s'assemblent à Stockholm pour y discuter de la paix. Des grèves éclatent dans les usines de guerre et les combattants s'indignent d'être, eux, au front tandis que leurs camarades mobilisables comme eux gagnent vingt francs-or à l'abri du danger.
La première mutinerie éclate le 20 mai, dans une unité au repos depuis longtemps et très soumise aux impressions de l'arrière. Les hommes refusent de monter au front et se répandent dans les rues du cantonnement, en chantant l'Internationale.
À partir du 28, les incidents se multiplient, de plus en plus graves. Seize divisions sont en état de rébellion latente. Près de Soissons, un meneur propose d'envahir un train et de gagner Paris. Une colonne se forme. Elle est arrêtée par un régiment fidèle, des cuirassiers.
Cependant Pétain a pu observer un fait consolant : en aucun lieu les tranchées de première ligne n'ont été abandonnées. Même non relevés, nos soldats n'ont pas voulu, comme ont fait les Russes, remettre leurs positions à l'ennemi, qui, par miracle, n'a rien su de ce qui se passait à quinze ou vingt kilomètres.
C'est la preuve que le patriotisme n'est pas mort. La grande oeuvre de Pétain est d'avoir restauré l'armée en voie de dissolution. Sans lui, Foch n'aurait pas eu en 1918 l'instrument de la victoire. Il n'y arriva pas par la terreur : sur les 283 condamnations à mort prononcées par les conseils de guerre pour rébellion, en mai, juin et juillet, il n'y eut que 25 exécutions.
Mais Pétain était un fantassin. La guerre l'avait trouvé colonel du 33e, tout juste désigné pour le commandement d'une brigade. Il comprenait mieux qu'aucun autre chef la psychologie du mobilisé. Le soldat, subitement, eut le sentiment que le généralissime avait les mêmes soucis que lui et qu'il entrait dans la vue du « poilu » pour en adoucir les épreuves. Pétain, chaque jour, visite au moins une unité (en tout 90 divisions) parlant avec tous, interrogeant, rappelant les gradés à leur devoir de bienveillance, secouant les officiers d'administration.
En même temps, il insiste (en vain) auprès du ministre pour que la justice sévisse contre les agitateurs et que la censure coupe impitoyablement les articles de bourrage de crâne qui font naître des espoirs sans fondement.
Dès que la discipline est rétablie, il s'emploie à monter avec le maximum de moyens et le minimum de pertes, sans sacrifices superflus, des actions limitées qui eurent plein succès et dont la plus célèbre, en octobre, aboutit au dégagement du Chemin des Dames sur le plateau de l'Aisne (moulin de Laffaux, la Malmaison). Dans son journal, Clemenceau écrivait :
« Jamais il n'y eut chez nos combattants tant de résolution, de sang-froid, de bonne volonté, d'élan... Le soldat déclare : « Ça colle, on a des chefs. »
Le 13 novembre, le ministère Painlevé est emporté par la campagne de presse de Léon Daudet, par les objurgations de Barrès, par la méfiance qui entoure son ministre de l'Intérieur.
Clemenceau est appelé par Poincaré (15 novembre 1917). Il résume son programme en quatre mots : « Je fais la guerre. » La « canaille du Bonnet rouge », comme disait Barrès, est envoyée au poteau. Malvy, traduit en Haute Cour, sera, en 1918, condamné à cinq ans de bannissement pour avoir « méconnu, violé et trahi les devoirs de sa charge ». Il sera ensuite réélu député.
| Haut de page |
HISTORIA N° 147 - Février 1959.

En août 1916, la Roumanie avait déclaré la guerre à l'Autriche, mais elle avait été tout de suite écrasée. En novembre, le vieil empereur François-Joseph était mort et son successeur, l'empereur Charles, marié à une princesse de Bourbon-Parme, avait, par voie secrète, cherché à quitter l'alliance allemande et à faire sa paix particulière. Tentative vaine.
La France et l'Angleterre avaient promis aux Italiens et aux Roumains des débris de la double monarchie. Le comité tchèque de Paris, très influent, préparait, au nom du principe des nationalités, la fonction d'une Tchécoslovaquie indépendante (presque aussi bigarrée que l'ancien empire).
Les propositions de l'empereur Charles furent repoussées (mai 1917). Qu'eût été l'avenir si elles avaient été acceptées ?
Un très gros renfort, par bonheur, était venu aux Alliés : les Etats-Unis, jetés dans le camp occidental par la guerre sous-marine à outrance que l'Allemagne (janvier 1917) avait déchaînée en riposte au blocus. Le 2 avril 1917, le président Wilson avait obtenu du Congrès l'autorisation de déclarer la guerre : c'était, pour la France et pour l'Angleterre, une immense espérance.
Argent, hommes, ressources, les Etats-Unis ont tout. Mais rien n'est prêt. Combien de temps leur faudra-t-il pour lever, organiser et entraîner leur armée ? Pour mettre l'affaire en route, on leur envoie Joffre, dont on redécouvre le bon sens et le prestige. Ils promettent 250 000 hommes par mois dès que possible.
En attendant, les Allemands, débarrassés du front russe, sur le point de faire la paix (mars 1918) avec les bolcheviks, dont ils ont eux-mêmes transporté les chefs de Suisse en Russie, disposent, à l'ouest, d'une énorme supériorité. Ils s'efforcent d'en tirer profit.
AMÈNE FOCH
Hindenburg et Ludendorff établissent une nouvelle instruction sur « la bataille offensive dans la guerre de positions ».
Il s'agit de disloquer le front allié par une série de coups de boutoir successifs, limités en profondeur, mails répétés et très violents. Les compagnies d'infanterie seront pourvues d'armes d'accompagnement à puissance accrue : lance-mines, mitrailleuses lourdes, lance-flammes, canons de petit calibre. Une aviation est créée pour intervenir dans le combat à terre. La préparation d'artillerie sera intense, courte, avec un emploi intensif des obus à gaz.
Le terrain choisi pour l'offensive est la région Cambrai-Arras-La Fère, à la liaison des armées britanniques et françaises ; choix d'autant plus judicieux que, depuis la disgrâce de Joffre, il n'y a plus de commandement unique : les deux armées sont juxtaposées, les commandants en chef Pétain et Douglas Haig reçoivent les ordres de leurs gouvernements respectifs.
L'aviation anglaise ne vit rien des préparatifs d'offensive allemande. Lorsqu'elle se déchaîna, le 21 mars, la surprise fut complète, la droite anglaise disloquée, volatilisée.
Par la brèche ouverte, les Allemands poussent en force. Ils avancent de cinquante kilomètres. Les voilà aux portes d'Amiens. La disjonction des armées française et anglaise n'est plus qu'une affaire de jours, peut-être d'heures.
Haig crie au secours, réclame le commandement unique. Les Alliés se concertent fiévreusement. Une conférence a lieu à Doullens. Foch, enveloppé naguère dans la disgrâce de Joffre, est chargé de « coordonner » l'action des armées alliées sur le front ouest. Il « s'entendra, à cet effet, avec les généraux en chef ».
Coordonner n'est pas ordonner. S'entendre n'est pas commander. Le 15 avril, on changea cette formule, sans vigueur ni précision : Foch sera nommé général en chef des armées alliées en France. A la sortie de la conférence, Clemenceau eut une phrase étrange. Il dit à Foch :
- Je connais un général qui est bien content. Il a enfin trouvé sa situation.
À quoi Foch répliqua :
- Vous me la baillez belle. Vous me donnez une bataille perdue et c'est tout ce que vous trouvez à me dire.
Foch était un très grand homme de guerre. Vivant simplement entouré d'un très petit nombre de collaborateurs, méditatif, habitué à raisonner par écrit, parlant volontiers par boutades, sachant la valeur irremplaçable de la présence, allant lui-même animer les chefs étrangers et les commandants de groupes d'armée (Fayolle, Franchet d'Esperey, Gastelnau), il s'impose par la supériorité de son génie.
À peine désigné, il parvient, avec les renforts français, à rétablir la liaison et, en tenant bon le pilier sud, il empêche l'avance allemande de s'approfondir. Finalement, le 30 mars, elle est arrêtée. Mais pour cela, il a fallu engager 41 de nos divisions, étendre notre front de 97 kilomètres et sacrifier 92 000 hommes, tués ou blessés.
L'offensive du 21 mars fut suivie de quatre autres, la première, le 9 avril, en Flandre, la seconde, le 27 mai, sur le Chemin des Dames, la troisième, le 9 juin, au nord de Compiègne, la quatrième, le 15 juillet.
La première et la troisième, après l'avance initiale, sont, non sans peine, mais assez vite, contenues.
La seconde emporte le front français sur une largeur de cinquante kilomètres et, après une avance ennemie de quarante, creuse, dans nos lignes, une vaste poche entre les villes de Reims (aux Français) et Soissons (perdue) qui amène Hindenburg de l'Aisne à la Marne.
C'est un désastre : les divisions françaises, malgré tant de leçons et d'instructions, malgré les directives formelles de Pétain, ont été entassées à l'avant au lieu d'être échelonnées en profondeur. Elles ont été toutes enveloppées, prises ou anéanties.
Comme après le 21 mars, la tactique de Foch est de tenir bon à droite et à gauche de l'avance allemande, certain que Hindenburg ne s'enfoncerait pas indéfiniment dans une nasse de plus en plus étroite.
C'est pour faire sauter le bastion ouest (Compiègne) que le maréchal allemand attaque le 9 juin avec des résultats médiocres. C'est pour faire sauter le bastion est (Reims) qu'il attaque le 15 juillet, de part et d'autre de la ville, en Champagne, entre Reims et la Marne, enfin sur la Marne.
Le 14, la revue traditionnelle avait eu lieu à Paris. On avait fait défiler des bataillons fraîchement retirés du front et des unités américaines, à qui Foch avait confié déjà quelques secteurs calmes. De temps à autre, Paris était bombardé par avions et, depuis le printemps, un gros canon, à longue portée, la Bertha, tirait irrégulièrement sur la ville. Ce canon avait beaucoup intrigué les mathématiciens. Painlevé le croyait monté à bord d'un ballon. Le Vendredi saint, 29 mars 1918, un obus était tombé sur l'église Saint-Gervais, pendant l'office des Ténèbres, faisant s'effondrer une voûte et tuant cent personnes.
 Les Américains en guerre en 1918 : une mitrailleuse antiaérienne. |
Quand la préparation d'artillerie allemande se déclenche, elle tombe en Champagne sur des tranchées aux trois quarts vides ou totalement abandonnées : Gouraud, admirablement informé, a retiré tout son monde. Les positions délaissées ont été « ypéritées » ou minées.
L'assaut allemand, désorganisé, se brise sur les secondes lignes. Au sud, il réussit mieux : six divisions passent la Marne, mais ne peuvent élargir leur gain. Le 18, la contre-offensive française se déchaîne dans le flanc ouvert de la poche.
Au cours de la retraite de 1914, le colonel Estienne, qui commandait alors le 22e d'artillerie, cheminait silencieusement à pied, tenant son cheval par la bride, lorsque, longeant un champ de terre grasse et molle, il se tourna soudain vers son officier d'ordonnance et dit :
- Celui qui, le premier, pourra faire rouler là-dessus des cuirassés de terre, armés et équipés, aura gagné la guerre.
L'idée du char était née. Mais il fallait en imaginer le dispositif.
En décembre 1915, le colonel exposa au général Janin le système du blockhaus d'acier adapté à un tracteur à chenille.
En février 1916, quatre cents chars de douze tonnes et quatre cents chars plus lourds furent commandés au Creusot et à Saint-Chamond. De leur côté, les Anglais en faisaient construire un certain nombre dans leurs usines.
Ils les utilisèrent, pour la première fois, le 15 septembre 1916, sur la Somme, emportèrent quatre villages, mais l'effet de surprise fut gaspillé.
De leur côté, les chars d'assaut français furent mal engagés, le 16 avril 1917, et parurent discrédités. Il ne suffisait pas de posséder une arme nouvelle, il fallait en fixer l'emploi, en liaison avec les armes traditionnelles.
Estienne, fin 1916, eut l'idée d'un char plus léger, facile à construire en série, qui fut mis au point par Renault. A la fin de 1917, il commença à sortir régulièrement.
La première unité autonome - 75 chars, montés par 370 officiers et soldats - fut constituée le 1er janvier 1918. En août, il existait 15 unités de cette sorte avec plus de 1 100 chars, 25 en novembre avec plus de 2 000, sans compter huit groupements de chars lourds, le tout formant trois brigades A.S. (Artillerie d'Assaut).
Ce fut une des erreurs de l'Allemagne de n'avoir pas compris l'importance de l'arme blindée. Elle n'a, pour ainsi dire, pas existé dans son armée.
En même temps, l'aviation, d'abord limitée à des tâches d'observation, se développe en aviation de bombardement et en aviation de combat. En juillet, elle comprend deux escadres, la plus faible à l'est, sur la partie inactive du front (environ 200 appareils), la plus forte au centre et à la charnière franco-anglaise (environ 650).
Le char et l'avion rendent leurs chances à l'offensive.
Dix-huit divisions en ligne, sept en réserve, deux cents chars, la moitié de la grosse escadre aérienne : tels sont les atouts que Foch a réunis. Mangin donnera le coup de boutoir. Le secret est gardé. A 4 h 45, le 18 juillet, le barrage roulant se déclenche, les chars suivent, l'infanterie ensuite. Le front ennemi est écrasé.
Précipitamment, Hindenburg rappelle les troupes engagées dans la poche. Elles refluent difficilement, perdant des milliers de prisonniers et des centaines de canons. Le la' août, l'Aisne est bordée, Soissons de nouveau entre nos mains.
Mais, cette fois, il n'est plus question de souffler. La contre-offensive a donné à Foch ce qu'il en attendait. L'initiative a été reconquise de haute lutte. Hindenburg et Ludendorff s'attendent peut-être à voir Mangin se lancer contre leur front reconstitué. Il les entretient dans cette idée par des tirs de harcèlement.
Mais, le 24 juillet, Foch a décidé que le second coup serait porté plus au nord, en Picardie, à l'est d'Amiens par les Anglais, par les Canadiens, par les Néo-Zélandais et par les Français (Haig, Debeney, Humbert). La date fixée est le 8 août. L'avant-veille, Foch a été fait maréchal de France.
C'est ainsi que Ludendorff a qualifié la journée du 8 août. La surprise est complète. L'attaque est lancée d'abord par les Anglais au nord de la Somme. Une heure après les Français attaquent à leur tour.
Le 10, le front est élargi au sud. Le 12, les Alliés se retrouvent sur leurs anciennes positions de la Somme. Le 17, Mangin reprend l'assaut sur l'Aisne. Le 21, le front d'attaque s'élargit une fois de plus, mais, cette fois, à 1'extréme gauche, dans la région Bapaume-Douai.
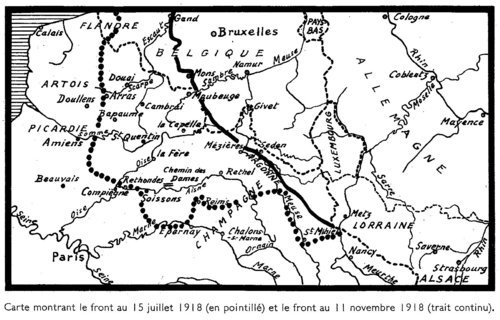
De son côté, le général Weygand, chef d'état-major de Foch, a écrit dans ses Mémoires :
« L'offensive engagée par le maréchal Foch ne ressemblait en rien à celles qui avaient été livrées depuis 1915, aussi bien par les Alliés que par les Allemands. Toutes avaient débuté par un succès qui était allé en s'amenuisant, jusqu'au moment où la dernière vague d'assaut venait mourir, impuissante, devant la ligne continue de feu, reformée par l'adversaire. Celle de Foch, au contraire, n'a cessé de s'étendre et de s'intensifier. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'accumuler dans le fond d'une poche et dans un terrain ravagé, où tout devient plus difficile et plus coûteux, ses réserves où le nombre n'a que faire, au lieu de s'obstiner dans une direction où l'attaque s'enlise elle-même, le maréchal élargit sa bataille par des actions d'aile. Il ne cherche pas la percée, mais la bataille générale. »
Les Allemands, ayant à peu près atteint la position défensive, connue sous le nom de ligne Hindenburg, Foch ébranle les secteurs du front encore immobiles : au nord, au voisinage de la mer, le secteur belge, à l'est de 1'Argonne à la Moselle, le secteur américain (général Pershing).
Le 12 septembre, Pershing attaque sur les deux flancs du saillant de Saint-Mihiel. Il ne trouve guère de résistance, car les Allemands sont en train de l'évacuer. Mais il fait bon nombre de prisonniers.
C'était une opération accessoire, visant surtout à dégager les voies ferrées. L'attaque principale devait se faire à l'ouest de la Meuse, en direction Sedan-Mézières, appuyée à gauche par Gouraud. Elle était d'une importance capitale : atteignant rapidement les Ardennes, les Alliés contraignirent l'adversaire à se retrancher sur un front rétréci, en faisant un long détour, avec une menace constante sur son flanc. "
Le premier élan des Américains (26 septembre) est magnifique mais il est aussitôt bloqué, Pershing, qui voulait une victoire pour son drapeau, a accumulé tant de divisions (375 000 hommes contre 175 000 Allemands) qu'il en résulte un embouteillage sans exemple et un désordre inexprimable. Rien n'arrive plus aux premières lignes.
Pershing, débordé, ne parvient pas à mouvoir ses troupes et il est impossible de faire partir un train de certaines gares.
Cet échec a de très graves conséquences : il oblige Foch à abandonner la manœuvre d'étranglement qui eût permis la capture d'une partie des Allemands en retraite. Il doit se contenter de les pousser devant lui, en les délogeant des positions préparées, en leur infligeant des pertes de plus en plus lourdes et en accélérant le rythme de leur retraite.
Une offensive de remplacement par la Lorraine, entre Metz et Strasbourg, est préparée sous la direction de Castelnau : elle n'aura pas le temps de se déclencher.
La victoire est comme une boule sur un plan incliné : plus elle avance, plus sa vitesse s'accélère.
Le 11 novembre, à part la pointe de Givet, le nord et l'est du département de la Meuse, le nord du département de Meurthe-et-Moselle et une petite fraction des Vosges, le sol français est libéré, et la Belgique, de Gand à Mons.
Le 15 septembre, les armées de Salonique - Serbes, Anglais et Français - sous le commandement du général Franchet d'Esperey, ont brisé le front germano-bulgare dans les Balkans, et le 26 la Bulgarie a demandé l'armistice. La révolution gronde à Vienne, à Budapest, à Prague. Des désordres ont éclaté dans les ports allemands et à l'arrière du front. Guillaume II sera contraint d'abdiquer par ses généraux.
Le 8 novembre, les plénipotentiaires allemands se présentent aux avant-postes sur la route de Maubeuge à Capelle pour solliciter l'armistice.
Reçus par Foch, dans son train de Rethondes, ils entendent la lecture des conditions posées : évacuation dans un délai de quinze jours des territoires occupés, y compris l'Alsace-Lorraine, livraison de 5 000 canons, 30 000 mitrailleuses, 3 000 lance-mines, 2 000 avions, 5 000 locomotives, 150 000 wagons, 5 000 camions, évacuation dans un délai de trente jours de la rive gauche du Rhin qui sera occupée, ainsi que trois têtes de pont, sur la rive droite, devant Cologne, Coblence et Mayence. La flotte sera internée en Angleterre.
Un délai de soixante-douze heures est accordé pour accepter ou rejeter ces conditions. Le 11 novembre, à 5 h 10 du matin, l'Allemagne accepte.
À 11 heures, les hostilités s'arrêtent. Toutes les cloches de France se mettent à sonner et les fenêtres se fleurissent de drapeaux.
Dès la signature, Foch a quitté Rethondes en auto pour apporter au gouvernement le texte de l'armistice. Il est reconnu à son arrivée à Paris, escorté par les cris de joie et de reconnaissance, sa voiture remplie de fleurs.
À 4 heures, Clemenceau donne lecture de la convention à la Chambre. Le soir, une foule énorme, chantant et acclamant, envahit les rues de Paris.
Il n'était pas écrit que vingt-deux ans plus tard ce serait de nouveau la guerre.
| Haut de page |
Documents personnels - Guerre 1914-1918
(Mon grand-père, côté maternel)
 Mon grand-père Raymond DANOIZEL dans les tranchées du côté des Flandres (sans date). |
(1885 St-Quentin - 1964 St-Quentin) A effectué son service militaire du 6 octobre 1906 au 25 septembre 1908. Certificat de B.C. (Bonne conduite) accordé. Ses différentes affectations : 148e Régiment d'infanterie ; évacué malade* du 26-12-1914 au 20-4-1915 ; passé au 33e RI le 18 mars 1916. Nommé caporal aux armées le 22 septembre 1916. Nommé sergent le 25 avril 1917. Disparu le 12 juin 1918 au combat de Laversine Cutry (à une dizaine de km à l'ouest de Soissons). Présumé prisonnier. Prisonnier interné à Sedan (Ardennes). Rapatrié le 26 novembre 1918. Puis affecté au 46e RI, 45e RI, 24e RI. Rendu à la vie civile le 20 mars 1919 « S’est porté courageusement en avant pour nettoyer les abris ennemis à la lisière du village de Bischotte (10 km au nord d’Ypres - Belgique) ». Cité à l’ordre du régiment n° 277 du 11 juin 1918 : « A été pour les hommes le plus bel exemple d’énergie et de ténacité – Le 3 juin avec un petit groupe de combattants a tiré à courte distance sur un groupe d’ennemis qui avait débordé sa section, s’est replié lentement en continuant le feu, retardant la progression de l’adversaire bien supérieur en nombre ». |
* D’après les souvenirs de famille, lors d’une attaque, il aurait été blessé ou déséquilibré par la déflagration d’une bombe et serait tombé dans un trou d’obus et perdu connaissance. À son réveil, en pleine nuit, ne pouvant se mouvoir dans le boue, avec sa voix forte (il était chanteur aux Orphéonistes Saint-Quentinois), il a appelé au secours toute la nuit et enfin, ce n’est qu’à l’aube qu’il a été secouru. |
Côté paternel, deux petits cousins ne sont pas revenus ...
Ernest THOEN (°1882, Lille), mort des suites de ses blessures le 28 novembre 1914 à l'âge de 32 ans, et Lucien THOEN (°1898, Paris), tué à l'ennemi le 31 août 1918, il allait sur ses vingt ans ...Ernest THOEN, a effectué son service militaire du 11 octobre 1905 au 28 septembre 1906. Certificat de bonne conduite accordé. Il a accompli une 1re période d’exercices dans le 43e Régiment d'infanterie du 24 août au 20 septembre 1908, et une 2ème dans ce même régiment du 30 mai au 15 juin 1912. Rappelé à l’activité par décret du 1er août 1914, il arrivé le 11 août au 94e RI et décède le 28 novembre 1914 à Jonchery-sur-Vesles (au nord de Reims) des suites de ses blessures. Il est inhumé à Cormicy (Marne), Nécropole nationale "La Maison Bleue", tombe 4204. Croix de guerre avec étoile de bronze. Médaille militaire à titre posthume. Mort pour la France. |
Ernest THOEN est né à Lille le 27 novembre 1882. Le 13 octobre 1906, il épousait Maximilienne Désirée Mittenaere née à Lille en 1888. De cette union sont nés deux enfants Andrée Maximilienne et Simone Madeleine. Comme indiqué ci-dessus Ernest est mobilisé en août 1914 et est tué trois mois plus tard le 28 novembre. Il laissait une veuve âgée de 26 ans et deux enfants de 7 et 6 ans. Andrée s’est mariée en 1927 et Simone en 1931.
Toutes deux avaient été « Adoptées par la Nation » en juillet 1919. |
Lucien THOEN, incorporé le 3 mai 1917 au 8e Régiment d'infanterie coloniale, soldat de 2ème classe. Passé au 4e Régiment d’infanterie coloniale le 5 janvier 1918, puis au 151e RI le 19 juillet 1918. Disparu le 31 août 1918 devant Crouy (Aisne). Inhumé le 1er septembre 1918, à Bucy-le-Long, près de la distillerie de Vauxrot. A été transféré en 1921 au Cimetière militaire de Crouy Vauxrot, Carré E, tombe 661.    Monument à Saint-Menoux, près de Moulins, (Allier) |
Léon THOEN, né en 1880 à Roubaix, est incorporé en août 1914 au 161e RI. Il est blessé en février 1915 à la cuisse droite par un éclat d'obus. Fait prisonnier le 22 février 1916 à Haumont, il est dirigé vers le camp de Munster (Westphalie) et sera rapatrié après l'armistice le 18 décembre 1918. |
| Haut de page |
HISTORIA N° 146 - Janvier 1959.
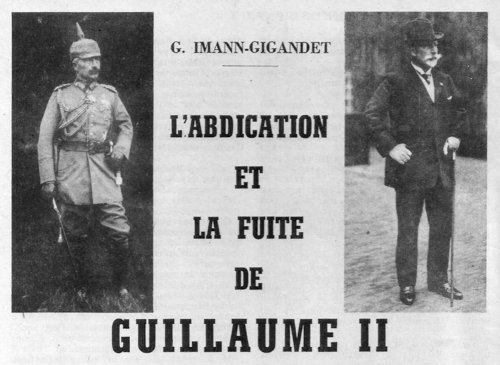
Le 15 juillet 1918, entre Château-Thierry et 1'Argonne, l'Allemagne lançait une nouvelle offensive, la cinquième depuis le printemps. Le 18, cette offensive était stoppée. Le 24, Foch contre-attaquait. En trois mois, il allait rejeter l'envahisseur sur la Meuse et nous assurer la victoire.
Cette date du 18 juillet marque donc le début de la débâcle allemande, au terme de la première guerre mondiale. « Jours de deuil ! » s'écria, dès les premiers revers, le quartier-maître général Ludendorff. - Notre grand malheur commence... » - dit, de son côté, Hindenburg.
Sous la pression alliée, les défaites allemandes et celles des puissances centrales vont prendre, en effet, des proportions d'avalanche. Le 13 septembre, l'Autriche fait savoir à Berlin qu'elle ne peut plus continuer longtemps la lutte. Elle devait capituler le 27 octobre. Le 26, la Bulgarie a déjà déposé les armes, le 1er novembre, la Turquie signe un armistice. En France, la ligne Hindenburg, dernier point d'appui des Allemands, est enlevée.
Ce n'est donc plus une paix victorieuse que l'Allemagne imposera à ses ennemis, ce n'est même pas une paix de compromis qu'elle pourra conclure. Aux 14 points formulés, le 8 janvier 1918, par le président Wilson devant le congrès de Washington, vient s'ajouter une note Wilson-Lansing qui confirme l'intention des Alliés d'exiger la capitulation.
De plus, ceux-ci refusent de traiter avec Guillaume II et posent, comme condition inéluctable son abdication. Pourtant les troupes du Reich continuent de combattre opiniâtrement. Mais la formidable machine de guerre est faussée, usée, irremplaçable, alors que s'accroît, chaque jour, le potentiel de l'Entente. Un vent de défaite souffle sur le pays.
Les divisions ramenées du front oriental après Brest-Litowsk et sur lesquelles le haut-commandement comptait pour écraser l'adversaire avant l'arrivée massive des Américains ont rapporté, de leur fraternisation avec les Russes, des ferments de propagande révolutionnaire.
Enfin, le peuple est à bout de résistance. Trois hivers de privations, au régime de la betterave (Rübenwinter), ont brisé son ressort. Il n'a plus qu'un désir, la paix, qu'une crainte, l'invasion, qu'une volonté, supprimer les obstacles qui s'opposent à la cessation de la lutte.
Or, de tous ces obstacles, le plus redoutable est le maintien du Kaiser sur le trône.
À cet égard, l'unanimité est faite depuis le début d'octobre. Pour des raisons différentes, mais qui tendent toutes vers un but identique, l'Allemagne souhaite l'abdication.
Ce n'est pas un idéal révolutionnaire qui l'anime, c'est son instinct pratique qui la fait agir. Dans son ensemble, la nation est demeurée monarchiste, le mythe du « coup de poignard dans le dos » qu'invoquera comme excuse Guillaume II et que reprendra, après lui, la propagande hitlérienne, n'est qu'une légende forgée pour les besoins de la cause. Il semble que l'Allemagne de 1918 ait plutôt pensé, en éliminant l'empereur : « - Prenons d'abord, cette garantie... On verra ensuite... »
La soi-disant révolution allemande a été, surtout, un acte de résignation opportuniste.
* *
 Le 5 octobre, le prince Max de Bade, devenait chancelier à la place du comte von Hertling démissionnaire. Peu après, au terme d'une entrevue orageuse entre Guillaume II et Ludendorff, au château de Bellevue, le quartier-maître général, grand chef des armées allemandes avec Hindenburg, était relevé de ses fonctions et remplacé par le général Grœner.
Le 5 octobre, le prince Max de Bade, devenait chancelier à la place du comte von Hertling démissionnaire. Peu après, au terme d'une entrevue orageuse entre Guillaume II et Ludendorff, au château de Bellevue, le quartier-maître général, grand chef des armées allemandes avec Hindenburg, était relevé de ses fonctions et remplacé par le général Grœner.Tous ces changements, ces apparitions d'hommes nouveaux constituaient autant d'indices de désarroi. Aux yeux des gens avertis, Max de Bade et Grœner se présentaient comme les liquidateurs de la faillite.
Guillaume II en a toujours voulu à Max de Bade de son attitude. Il l'a sévèrement jugé dans ses mémoires, Evénements et Figures, lui attribuant de machiavéliques desseins. En réalité, le prince a loyalement tenté de sauver la couronne et arraché sa patrie à une imminente soviétisation. Au Reichstag, au conseil du gouvernement, la social-démocratie, Scheidemann en tête, exprimait sa volonté de proclamer sans délai la république.
- Devance par ton abdication volontaire la social-démocratie - ne cessait de répéter Max à son impérial cousin. C'est un gage que nous donnons aux Alliés en vue de la conclusion d'un armistice moins rigoureux et notre dernière possibilité d'instaurer une régence.
 - Un Hohenzollern n'abdique pas ! répondait obstinément Guillaume.
- Un Hohenzollern n'abdique pas ! répondait obstinément Guillaume.Cependant, à l'intérieur, les événements se précipitaient. Dans tous les états, les tendances séparatistes s'affirmaient. « Détachons-nous de la Prusse ! » (Los von Preussen !). A Munich, la révolution abattait les Wittelsbach ; à Brunswick, le drapeau rouge flottait sur le château ; à Cologne se constituaient, sur le mode russe, des conseils d'ouvriers et de soldats.
Enfin, à Kiel, le 4 novembre, véritable résurrection de la mutinerie du Potemkine, la flotte se révoltait, les marins arrachant leurs insignes, et leurs parements aux officiers.
Un Hohenzollern n'abdique pas, mais il s'éloignait prudemment. Dès la fin octobre, Guillaume avait rejoint à Spa son quartier général.
- Je viens à vous, mes officiers, parce que le gouvernement de Max de Bade ne pense qu'à me jeter par-dessus bord !
Etranges paroles dans la bouche de celui qui s'était vanté jusqu'alors de faire trembler le monde. « Un valeureux poltron ! » ainsi l'avait qualifié, naguère, Edouard VII.
* *
Guillaume II aimait aussi, parfois, s'y délasser, entre intimes, des soucis du pouvoir et de la guerre. Il dépouillait alors sa morgue impériale et sa brusquerie volontaire de soldat, se révélant sous un aspect tout différent, celui d'un homme cultivé, courtois, enjoué et pourvu d'un charme auquel nul de ceux qui l'ont approché n'est demeuré insensible. Puis, soudain, le Kaiser de sa légende reparaissait, hautain, cassant, sujet à des violentes colères, mégalomane, le cerveau hanté de chimères et exaspérant de vanité. Le 1er novembre, le ministre de l'Intérieur Dreivs et le général Grœner se présentèrent, villa Fraineuse. Une fois encore, Max de Bade tentait une pressante démarche en faveur de l'abdication. Après avoir laissé longuement parler Drews, Guillaume l'interrompit d'un glacial :
- Et votre serment ? Le serment de fidélité que vous m'avez prêté. Ne m'obligez plus, je vous prie, à vous le rappeler !...
Puis, à Grœner :
- Quant à vous, général, qui semblez mettre en doute la loyauté de mes troupes, sachez que, partout où je me suis présenté, j'ai été acclamé !
Dès cette minute, un nouveau projet avait jailli dans cet esprit déplorablement enclin aux utopies. Puisque, à Berlin, une poignée de misérables usaient de hardiesse, avec la complicité évidente du chancelier, ne suffirait-il pas, pour rétablir l'ordre, que l'empereur, à la tête de ses troupes, marchât victorieusement sur la capitale ?
Il quêta, du regard, l'approbation de ses officiers.
- Qu'en pensez-vous, messieurs ?
Mais personne ne répondit. Dans les destins curieusement parallèles de l'Allemagne et de la France, le geste de l'empereur ne risquait-il pas de ressusciter à Berlin la Commune de Paris ?
* *
Le 9, au matin, Grœner se fit encore annoncer au grand quartier général. Il ne venait plus s'enquérir, mais exiger.
Un feu de bois brûlait dans la cheminée. Il y avait là, entourant l'empereur, Hindenburg, les généraux von \Iarschall, Plessen, Schulenburg, l'amiral Scheer, etc.
Le Kronprinz entra, au cours de l'entretien. Il apparut, blême d'émotion et de dépit, ayant été longuement sifflé et hué durant son voyage. Son premier mot fut un hargneux reproche à son père :
- Voilà, dit-il, où mènent les belles concessions démocratiques.
De nouveau, Grœner exposa les raisons qui rendaient indispensable l'abdication. Ce n'était plus une question d'heures, mais de minutes.
Guillaume coupa court :
- L'armée et la marine ne se déroberont pas à mon autorité.
Respectueux, mais ferme, Grœner se borna à répondre :
- À Berlin, le 4e chasseurs, une partie du régiment Alexandre, l'artillerie en entier ont déjà passé aux insurgés. A Kiel, le frère de Votre Majesté, le prince Henri de Prusse, n'a dû son salut qu'à la fuite.
- N'importe ! Je vous répète que j'ai ici des régiments fidèles... Si je l'ordonne, ils me suivront !...
- Ils ne vous suivront plus, Sire...
- Ils ont prêté le serment au drapeau.
- À l'heure actuelle, le serment au drapeau n'est plus qu'une fiction. (Der Fahneneid ist nur eine Idee.)
Crispé, comme sous un affront à sa personne, Guillaume se tourna vers Hindenburg.
- Monsieur le maréchal, qu'avez-vous à répondre ?
Le vieux soldat, le vainqueur de Tannenberg, l'homme dont toute l'existence n'avait été qu'un attachement aveugle à sa patrie et à la couronne, murmura :
- Le général Grœner a raison. L'armée ne suit plus Votre Majesté, et on ne peut compter sur elle.
Il acheva dans un soupir :
- Plût au ciel qu'il en eût été autrement !
À cette minute, deux solutions désespérées, mais qui eussent, peut-être, relevé son prestige devant l'histoire, s'offraient à Guillaume.
Avait-il donc oublié la fiole de poison que portait toujours sur lui son grand ancêtre, Frédéric II ? Vaincu, rouge de sang répandu, ne pouvait-il aussi, fin plus louable, devenir, sous le feu de l'ennemi, le dernier mort de la guerre ?
Aux insinuations à peine voilées de Grœner, il se borna pourtant à répondre que ses sentiments religieux et ceux de l'impératrice lui interdisaient le suicide.
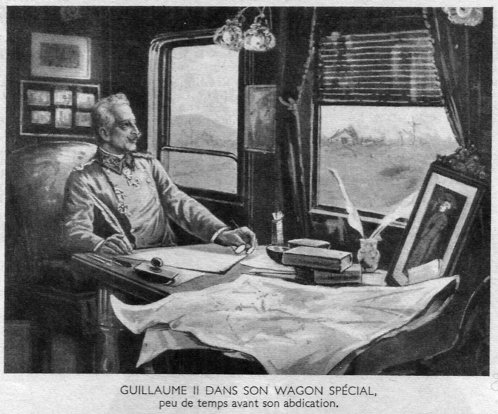
- À quoi bon, la mise en scène d'un pareil rôle de héros ? Nous ne vivons plus à une époque où, l'épée à la main, le chef couronné conduit ses fidèles au dernier combat !
On venait d'introduire le colonel Heye, chargé d'enquêter auprès des commandants de troupes sur l'état d'esprit régnant parmi les unités. Toutes les réponses recueillies confirmaient les sombres pronostics de Grœner et Hindenburg.
- C'est votre faute - cria rageusement Guillaume II à Grœner. Max de Bade et vous, avez démoralisé l'armée par vos discours pessimistes.
D'un coin du salon, S'éleva la voix ironique du Kronprinz. - A quelle heure avait-on convoqué les commandants de troupes ? - -Mais, comme prévu, ce matin, Votre Altesse... - Et, naturellement, ces messieurs étaient à jeun ! Croyez-moi, après un bon déjeuner et un cigare à la bouche, l'atmosphère eût été tout autre.
* *
- Finissons-en - dit brusquement Guillaume II. Puisque on m'y contraint, j'abdique !
Il se pencha vers le secrétaire d'Etat Hintze et ordonna :
- Préparez le message !
Puis, sur une adjuration pathétique de Plessen et Schulenburg, il rectifia :
- J'abdique en ma qualité d'empereur d'Allemagne, mais j'entends demeurer roi de Prusse.
En effet, dans l'esprit du Kaiser, cette double souveraineté appelait une distinction. Depuis le 18 janvier 1871, à Versailles, les Hohenzollern étaient empereurs par le choix des princes et l'existence même d'une confédération.
En abdiquant, les souverains de Bavière, Saxe, Bade, Wurtemberg avaient brisé l'unité de l'empire. La qualité d'empereur ne répondait donc plus à une réalité, c'était un titre sans consistance, une fiction, ainsi que l'eût dit Groener.
Par contre, les rois de Prusse tenaient de Dieu leur couronne. Ils n'étaient plus libres de la déposer. Enfin la royauté prussienne demeurait une question purement intérieure dans laquelle les Alliés ne pouvaient s'immiscer, au nom même du principe de libre disposition.
On tergiversa, on discuta sur ces arguties que la réalité allait balayer de son souffle, on griffonna vingt brouillons de dépêche.
À 1 h 45, de l'après-midi, une nouvelle sonnerie retentit. Devançant la décision de son cousin, Max de Bade avait passé ses pouvoirs au socialiste Ebert et annoncé au peuple l'abdication pure et simple du Kaiser et la renonciation du Kronprinz au trône. Deux heures plus tard, d'une fenêtre du Reichstag, Scheidemann proclamait la république.
Il ne restait plus à Guillaume qu'à tirer les conclusions du fait accompli. Après trente ans de règne, le plus puissant souverain d'Europe, le dernier autocrate, troisième empereur d'Allemagne, neuvième roi de Prusse, vingtième grand électeur de Brandebourg, était congédié par téléphone, sans préavis.
* *
Puis, les conclusions du rapport Heye dissipaient ses dernières illusions. Le grand quartier général, lui-même, n'était pas à l'abri d'un coup de main de soldats mutinés.
- Je ne peux pourtant pas me laisser arrêter ! s'écria-t-il.
- Il faut que Votre Majesté gagne sans délai la Hollande, déclara Hindenburg. En loyal serviteur, il ajouta :
- Je prends la pleine et entière responsabilité du départ de Votre Majesté. D'ailleurs, conclut-il, tant la défection du peuple allemand heurtait ses convictions et lui paraissait inadmissible - c'est une mesure... transitoire.
De longues heures s'écoulèrent avant que ne parvînt la réponse du gouvernement hollandais octroyant à l'ex-Kaiser le droit d'asile. Une inquiétude se lisait sur sa face défaite. Il demanda :
- Est-il admissible que je me dérobe au danger, tandis que l'impératrice demeure exposée ?
On le rassura ; l'impératrice venait de faire savoir, de Berlin, qu'elle était en bonne santé, saine et sauve, et qu'elle gagnerait, elle-même, la Hollande à bref délai.
Tranquillisé, Guillaume put, dès lors, épancher largement sa rancune contre Max de Bade, le « Bademax », ainsi qu'il l'appelait et faire ses officiers juges de l'attitude éhontée du prince (unverschämte Haltung).
Puis, dans un sursaut de dignité, comprenant quelle triste figure il léguerait à l'histoire et obéissant à ce goût des attitudes théâtrales qui cachait chez lui une peur maladive du risque, il répéta, certain que son appel ne serait pas suivi :
- Je ne crains pas la mort ! Qu'une poignée de fidèles m'accompagne, et je livre un combat désespéré !
Enfin, nouvelle ostentation d'héroïsme gratuit :
- Non, je ne partirai pas encore... J'attends !...
Il était onze heures du soir. Comme le départ s'effectua, le lendemain matin, à cinq heures, le délai d'attente fut, on le voit, assez court !
Il passa le reste de la nuit dans son wagon-salon, rédigeant ses derniers ordres, écrivant au Kronprinz, qui avait quitté Spa après la réunion de la journée.
À quatre heures, un courrier apporta le texte des conditions soumises par les Alliés à la délégation d'armistice. De profonds soupirs, de violentes protestations s'élevèrent parmi les officiers.
- Au revoir, mes camarades ! - prononça Guillaume en leur serrant la main, et le train s'ébranla en direction de La Reid, une des dernières stations avant la Hollande.
Le premier mouvement des gardes-frontière du poste d'Eysden, en voyant déboucher les automobiles de l'ex-empereur et de sa suite, fut de croiser la baïonnette et d'interdire l'accès du territoire avant d'avoir reçu confirmation des décisions gouvernementales.
Force fut donc à Guillaume de patienter. L'attente en gare frontière dura six heures, six heures durant lesquelles les rares voyageurs de passage à Eysden purent apercevoir l'ex-Kaiser, vêtu de son long manteau gris d'uniforme, arpenter nerveusement les quais.
Enfin, vers le soir, l'autorisation lui ayant été accordée, il put monter dans le train spécial mis à sa disposition. On partit, le matin, en direction de Maarn par Maestricht et Nimègue.
Pénible et sinistre voyage ! Jusqu'alors, Guillaume II avait vécu retranché, en quelque sorte, du monde réel. Pour la première fois, se révélait à lui l'hostilité quasi universelle qui s'attachait à sa personne.
Le temps s'était mis à la pluie, et ce 11 novembre, si radieux ailleurs, si débordant d'allégresse, pesait en sombres nuées sur le paysage des Pays-Bas. Le long des voies, aux gares que l'on traversait, une foule compacte huait le convoi, montrait le poing à l'empereur déchu, faisait le geste de le pendre.
On descendit à Maarn sous des torrents d'eau. Le gouverneur de la province d'Utrecht, comte Lynden, et le comte Godard Bentinck, qui avait dû accepter, bien à contre-cœur, d'héberger son hôte en son château d'Amerongen se présentèrent à l'arrêt du train.
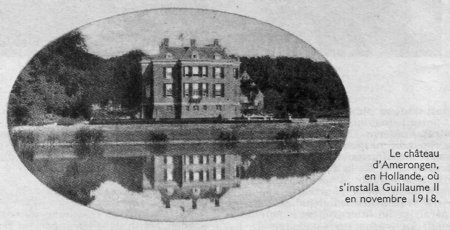
Un de ses premiers mots à Bentinck, comme si tous ces graves événements ne dépassaient guère le cadre d'un léger incident et ne constituaient, ainsi que le déclarait Hindenburg, qu'une mesure transitoire, fut :
- Na, was sagen Sie dazu ? (Eh ! bien, qu'est-ce que vous en dites ?)
Puis, à peine entré au château, il s'écria :
- Du thé, vite ! une tasse de thé bien chaud, de bon thé anglais !
Le 28 novembre, il signait docilement son abdication officielle d'empereur et de roi.
* *
 Il semblait avoir dépouillé, avec son physique d'antan, sa bruyante personnalité. Ses cheveux gris, la barbe qu'il avait laissée pousser à son menton et à ses joues, ses vêtements civils, contrastaient avec l'image du Kaiser d'autrefois, casqué et botté, l'œil perçant et la moustache en pointes.
Il semblait avoir dépouillé, avec son physique d'antan, sa bruyante personnalité. Ses cheveux gris, la barbe qu'il avait laissée pousser à son menton et à ses joues, ses vêtements civils, contrastaient avec l'image du Kaiser d'autrefois, casqué et botté, l'œil perçant et la moustache en pointes.Une bienveillante étoile marqua ce destin qui eût pu, qui eût dû être atroce. La menace du châtiment suprême, longtemps agitée par les Alliés, s'était évanouie devant la résolution du gouvernement hollandais de faire respecter le droit d'asile.
Généreuse, la république de Weimar rendit à l'exilé presque tous ses biens et lui assura même une confortable pension. Il vécut assez longtemps pour voir l'aventurier qui lui succéda poursuivre son rêve d'hégémonie universelle ; il mourut trop tôt pour assister à une défaite plus complète encore que la sienne, à un écroulement plus tragique que le sien.
La mort elle-même fut douce à cet homme coupable de tant de morts. Le 4 juin 1941, le grand responsable de la première guerre mondiale et de ses bouleversements ultérieurs, le complice indirect de l'horreur hitlérienne, de ses massacres et de ses ruines, s'éteignait paisiblement à Doorn, dans sa 83e année.
Les journaux de l'époque relatèrent la nouvelle en dix lignes.
 |
 |
| Haut de page |
HISTORAMA - N° 5 - Juillet 1984.
Les dossiers d'Alain Decaux
Il y a 70 ans
SARAJEVO :
LE CRIME LE PLUS IMPORTANT DE L'HISTOIRE
 Un soleil éclatant, une foule pressée, avide, qui se bouscule pour mieux voir l'automobile de l'archiduc François-Ferdinand, héritier présomptif de l'Empire austro-hongrois. Et, tout à coup, des coups de feu qui jaillissent de cette foule. L'archiduc, dans sa belle automobile, s'écroule, assassiné.
Un soleil éclatant, une foule pressée, avide, qui se bouscule pour mieux voir l'automobile de l'archiduc François-Ferdinand, héritier présomptif de l'Empire austro-hongrois. Et, tout à coup, des coups de feu qui jaillissent de cette foule. L'archiduc, dans sa belle automobile, s'écroule, assassiné.Cela se passait le 28 juin 1914. Un fait divers ? Sur l'instant, on a pu le croire. Or les coups de feu de Sarajevo vont se trouver à l'origine de l'une des plus effroyables tragédies de tous les temps. C'est de la Première Guerre mondiale que notre destin est issu. Sans elle et les conditions qu'elle a créées, l'Histoire n'aurait pas changé de visage, Hitler et Staline n'auraient jamais conquis le pouvoir.
Tout cela parce qu'un patriote bosniaque a tiré sur un archiduc ? Tout cela.
En 1914 régnait sur l'Autriche-Hongrie un empereur de quatre-vingt-quatre ans, François-Joseph. Ce long, trop long règne, avait été semé de drames familiaux dont l'accumulation ne peut, aujourd'hui encore, que nous frapper. Le frère de François-Joseph, Maximilien, avait été fusillé au Mexique. À l'annonce de sa mort, sa femme, Charlotte, avait perdu la raison. Le fils unique de l'empereur, Rodolphe, était mort à Mayerling. La belle-sœur de François-Joseph, duchesse d'Alençon, avait péri, brûlée vive, dans l'incendie du Bazar de la Charité. Son épouse, Elisabeth - Sissi - avait perdu la vie sous le poignard d'un assassin. L'un de ses neveux, Louis II de Bavière, était devenu fou. Et lui - lui seul - survivait.
Depuis 1896, l'héritier du trône était son neveu François-Ferdinand. À vrai dire, on n'avait guère préparé le jeune homme, dans son enfance, à cette éventualité : il avait peu de chances de succéder au trône. Cependant qu'il poursuivait une carrière militaire, traditionnelle chez les Habsbourg, on s'était acharné, dans son entourage, à écarter de lui toute influence libérale. On l'avait élevé dans le catholicisme le plus ardent. Son plaisir favori ? La chasse. Son médecin estimait qu'il avait tué plus d'un million de pièces de gibier. Avec cela, un fort mauvais caractère et s'embarrassant peu de nuances. Le général Conrad rapportait que l'archiduc lui avait dit un jour :
- Quand je serai commandant en chef, je ferai ce que je voudrai, et si quelqu'un fait quelque chose d'autre, je les ferai tous fusiller.
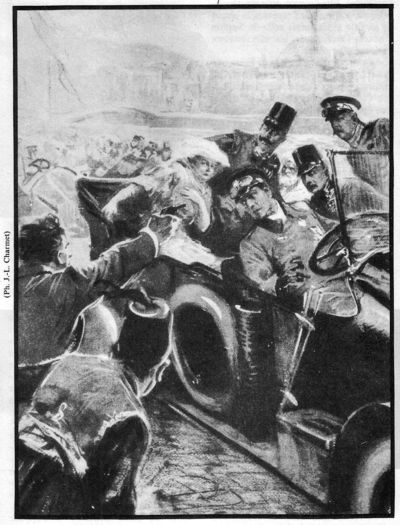 |
|
Plus qu'un fait divers, l'assassinat (ci-dessus) de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche (avec sa famille, à gauche) déclenchera la première grande hécatombe de l'Histoire. Le coup de revolver de Gavrilo Princip (ci-contre) allait faire dix millions de morts. |
 |
C'est alors que l'inattendu arriva. L'archiduc François-Ferdinand s'éprit de Sophie. On le vit de plus en plus chez l'archiduchesse Isabelle. Celle-ci croyait que son cousin était tombé amoureux de l'une de ses filles et s'en réjouissait. Un jour de 1898, François-Ferdinand oublia sa montre chez Isabelle. Celle-ci avait des raisons de soupçonner que se trouvait, dans le boîtier, l'image de l'objet des rêves de l'archiduc. Elle l'ouvrit. Elle n'y découvrit pas, comme elle l'espérait, la photo de sa fille aînée, mais celle de Sophie Chotek. Courroucée, Isabelle renvoya la dame d'honneur.
Mis au courant, l'empereur François-Joseph fit aussitôt entendre un avis qui était un verdict : cette demoiselle Chotek n'était pas, pour l'héritier du trône, une épouse possible.
Les malheurs de Sophie
L'année suivante, François-Ferdinand interrogea son médecin : sa tuberculose pouvait-elle se révéler dangereuse pour ses enfants ? Le médecin répondit par la négative, ce qui nous paraît fort léger. C'était, à juste titre, nier l'hérédité, mais oublier la contagion. Car François-Ferdinand s'obstinait. François-Joseph s'alarmait de plus en plus. À sa demande, le confesseur de l'archiduc intervint. En pure perte. Les rapports se tendirent entre l'oncle et le neveu. François-Ferdinand annonça tranquillement qu'il attendrait, pour se marier, la mort de François-Joseph. L'archiduchesse Marie-Thérèse plaida sa cause. Finalement, François-Joseph accepta le mariage, mais il exigea qu'il fût morganatique. Comprenez que, par serment, François-Ferdinand dut renoncer, pour les enfants qu'il aurait de Sophie, à tout prétention au trône. En 1900, il épousait enfin la femme qu'il aimait depuis cinq ans. Elle avait trente-deux ans, lui trente-sept.

Les trois complices avant l'attentat du 28 juin 1914 : Princip, Ciganovitch et Chabrinovitch (de gauche à droite). Membres de sociétés secrètes, ils rêvent d'une grande patrie commune qui regrouperait, avec les Serbes déjà indépendants, les Bosniaques et les Croates.
|
Une telle situation aurait pu distendre les liens qui unissaient François-Ferdinand et Sophie. C'est le contraire qui se produit. Le pape Pie X dira : « L'archiduc ne voit que par les yeux de sa femme. »
François-Ferdinand s'est, en politique, campé comme « défenseur du monde chrétien ». Il affirme hautement qu'il déteste le libéralisme, la franc-maçonnerie et les Juifs. L'un de ses meilleurs amis n'est autre que le maire de Vienne, Karl Lueger. Lequel proclame volontiers qu'il faut embarquer tous les Juifs sur un immense bateau que l'on coulera en haute mer.
Or Lueger, maître à penser de l'archiduc, se montre adversaire farouche de l'autonomie hongroise dans l'empire. Il prône la réunification de l'Autriche. François-Ferdinand, disciple zélé, se met à la tête des ultra-nationalistes autrichiens. Il ne cache pas l'hostilité qu'il ressent pour les protestants. Chef du parti militaire, il s'appuie avant tout sur l'armée (1).
En 1913, François-Ferdinand devient inspecteur général des Forces armées. Il prend sa tâche extrêmement au sérieux. En ce temps-là, l'archiduc est un homme solitaire, en conflit avec tout le monde : François-Joseph, les archiducs, les chambellans. Mais aussi avec les Magyars et les groupes nationaux des Slaves du Sud.
Les Slaves du Sud. Le mot est lâché. Si les Slaves du Sud - et le grave problème qu'ils posent - n'avaient pas existé, nul n'aurait tiré de coups de feu à Sarajevo.
Pour tenter de le comprendre, ce problème, il nous faut quitter l'archiduc et mettre nos pas dans ceux d'un autre homme. Ceux de son assassin, Gavrilo Princip. Car ce Princip est originaire de Bosnie.
La Bosnie ? Ici je devine que le lecteur commence à se perdre. Pour les écoliers et les lycéens, la question balkanique s'est toujours révélée un casse-tête presque insoluble. Posez la question : « Où situez-vous, sur la carte, la Serbie, la Croatie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine ? », et vous verrez ! Il faut savoir pourtant que, dans des temps très reculés, existait déjà un royaume de Serbie, que celui-ci avait même absorbé toute la péninsule balkanique, y compris la Grèce. Que l'on avait sacré alors un empereur des Serbes et des Grecs. Il faut savoir aussi qu'avait existé un royaume indépendant de Bosnie. Tout cela il y a bien longtemps, au Moyen Age. Après quoi étaient venus les Turcs. Ils avaient occupé les Balkans, adieu la Bosnie !
(1). Vladimir Dedijer : La Route de Sarajevo, traduit de l'anglais par Magdeleine Paz (1969).
Gavrilo, un enfant sérieux, mais bagarreur
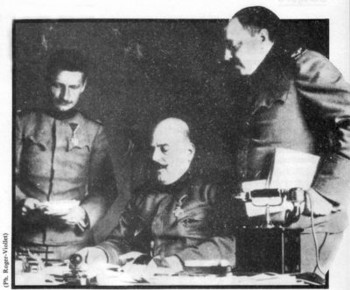 Le général serbe Dimitrievich, dit Apis, chef de la « Main Noire », et ses collaborateurs. Il avait déjà tué le roi Alexandre de Serbie et la reine Draga, et s'en faisait gloire.
|
Entre les deux pays, un trait commun : 1'amer regret de la liberté perdue.
Le XIXe siècle tout entier avait été marqué par d'incessantes révoltes serbes. La première, en 1804, menée par Karageorges ; la seconde, en 1815, par Milos Obrenovitch. Après une dernière guerre, le congrès de Berlin de 1878 avait édifié une Serbie indépendante, laquelle, en 1882, était devenue royaume.
Toutes ces années avaient vu naître aussi d'inexpiables rivalités entre les familles Karageorgevitch et Obrenovitch. Des assassinats, des coups d'Etat. En 1903, Alexandre Obrenovitch, roi de Serbie, et son épouse, Draga, étaient assassinés. La couronne passait à Pierre Karageorgevitch, qui devenait Pierre ler
Ainsi la Serbie se révélait le premier État balkanique à avoir conquis son indépendance. Comment les Bosniaques, toujours asservis, n'auraient-ils pas regardé avec envie du côté de la Serbie ? D'autant que la plupart des Bosniaques étaient de race et de langue serbes.
Ainsi en avait-il été des Princip. Les Princip, une famille de serfs, vivaient dans une vallée, à huit cents mètres d'altitude. Ils étaient orthodoxes, ils étaient pauvres. La situation des serfs en Bosnie se révélait si misérable qu'en 1875 ils s'étaient soulevés. Contre les Turcs bien sûr. La répression avait été terrible. Les femmes et les enfants des Princip avaient dû se réfugier en Autriche-Hongrie, où ils habitaient dans des grottes. Ils n'étaient rentrés chez eux qu'après le congrès de Berlin de 1878, qui avait confié l'administration de la Bosnie à l'Autriche-Hongrie. Ils avaient reconstruit leur maison, repris la culture de leurs deux hectares. Un fils leur est venu en 1894. Il est né le jour de la Saint-Gabriel. On l'appellera donc Gavrilo.
Un enfant sérieux, ce Gavrilo, mais bagarreur. Il va quitter la vallée à treize ans, après avoir terminé ses études à l'école primaire. À Sarajevo, il entre à l'École de commerce. L'été, il travaille aux champs. Il adore la lecture. Il est tout petit - ce qui fait naître chez lui un évident complexe - mince avec des épaules étroites, une tête toute ronde et des yeux tristes. Ses professeurs le notent comme très sensible, peut-être instable. En 1911, il obtient son diplôme.
Le serment de la Main Noire
De cette année-là, il dira qu'elle est restée pour lui essentielle. C'est en 1911 qu'il se découvre amoureux et qu'il adhère aux groupes secrets des Jeunes bosniaques. On lit dans son Journal : « C'est alors que je suis devenu définitivement révolutionnaire. J'aimais toujours la même jeune fille d'un amour platonique, parce que je ne l'avais jamais embrassée. Je passais le plus clair de mon temps dans les bibliothèques. Lors de la guerre des Balkans, j'eus l'intention de m'enrôler comme volontaire, mais je n'y réussis pas, vu mon jeune âge. »
Que sont les Jeunes bosniaques ? Avant tout des intellectuels qui ont résolu de consacrer tous leurs efforts à libérer la Bosnie des Autrichiens. Car l'occupant haï, maintenant, c'est l'Autrichien. En 1908, la Bosnie a été annexée à l'empire. Ce qui, pour les Bosniaques, revient à passer d'un asservissement à un autre. À leurs yeux, les Austro-Hongrois ne valent pas mieux que les Turcs. D'autant que les autorités autrichiennes emploient volontiers la manière forte. C'est militairement que l'on a réprimé la grève des ouvriers de 1906 et la révolte paysanne de 1910. Un sentiment unanime s'est fait jour : il faut libérer le peuple bosniaque du joug autrichien. Jeunes et vieux partagent cette volonté. Avec une différence toutefois : les vieux tiennent à user de moyens légaux. Les jeunes sont prêts s'il le faut à utiliser les moyens illégaux. Gavrilo Princip est jeune.
Le meilleur ami de Gavrilo se nomme Danilo Ilitch, un instituteur. Comme Danilo est membre des Jeunes bosniaques, Gavrilo Princip le sera aussi.
Au printemps de 1912, Princip se jette dans des manifestations véhémentes contre les autorités de Sarajevo. On le renvoie du lycée. Ce jour-là, son destin est scellé. Car il décide de gagner Belgrade. A pied.
Belgrade, pour lui, c'est la liberté. Il la voit comme la capitale de la future Yougoslavie - déjà les révolutionnaires usent de ce nom - qui groupera un jour les Croates, les Bosniaques, les Serbes. Un signe : quand Princip traverse la frontière, il embrasse la terre de Serbie.
Il va végéter à Belgrade avec le peu d'argent que lui envoie son frère. Il a faim. Il s'inscrit au lycée. En juin 1912, il rate son examen et sollicite son engagement dans les troupes qui partent en guerre contre la Turquie. Il est refusé à cause de sa petite taille. Encore ces centimètres qui lui manquent si cruellement ! Il en souffre de plus en plus.
L'idée peu à peu s'impose à lui d'entreprendre un jour quelque chose d'héroïque pour montrer aux autres qu'il est leur égal, sinon par la taille, du moins par le courage.
À l'été de 1913, il passe ses examens de cinquième et sixième année. Mais déjà il a adhéré à une société secrète, la Narodna Obdrana, autrement dit : « Défense de la nation ». Une société secrète serbe.
Elle a été fondée en 1908, lors de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche. Son but : enrôler les volontaires, les entraîner, organiser une force armée susceptible de lutter contre l'Autriche.
À cette société adhèrent des Serbes, mais aussi de nombreux Bosniaques. Ils organisent même un « tunnel » entre la Serbie et la Bosnie, avec un réseau d'agents, de passeurs, d'estafettes.

François-Ferdinand, sanglé dans l'uniforme de cérémonie de la cavalerie autrichienne, et son épouse, la duchesse de Mohenberg, en robe de satin blanc, quelques minutes avant l'attentat qui va leur coûter la vie. |
Article PREMIER. - Cette organisation est créée dans le but de réaliser l'idéal national : l'union de tous les Serbes. Chaque Serbe, sans distinction de sexe, de religion, de lieu de naissance, et tous ceux qui sont sincèrement dévoués à cette cause peuvent en devenir membres.
Article 2. - Cette organisation préfère une action terroriste à la propagande intellectuelle et, pour cette raison, elle doit rester absolument secrète pour les non-adhérents.
Ceux qui entrent dans la nouvelle société doivent prêter ce serment solennel :
- En devenant membre de l'association Union ou Mort, je jure par le soleil qui m'éclaire ; par la terre qui me nourrit ; par Dieu ; par le sang de mes pères ; sur l'honneur et sur la vie, que, dès à présent et jusqu'à ma mort, je servirai fidèlement l'Association et que je serai toujours prêt à lui faire tous les sacrifices. Je jure par Dieu, sur l'honneur et sur la vie, que j'exécuterai sans broncher tout ce qui me sera ordonné. Je jure par Dieu, sur l'honneur et sur la vie, que jusqu'à la tombe je garderai tous les secrets de l'Association.
Peu à peu, la Main noire va reprendre les hommes de confiances de ce Narodna Obdrana. On réorganise le fameux tunnel. Surtout on décide de passer à l'action. Désormais, ceux qui seraient tentés de désobéir savent qu'ils risquent la mort. A cet égard, le sceau de la Main noire est très éloquent : il représente une tête de mort au-dessus d'os croisés, avec un poignard, une bombe et une fiole de poison.
Le plus zélé animateur de la Main noire, c'est le colonel Dimitriévitch, appelé aussi le colonel Apis. Il ne se cache nullement d'avoir été le principal auteur de l'assassinat du roi Alexandre. Il a tranquillement tué le couple royal à coups de revolver, précipité les cadavres par la fenêtre ; égorgé les deux frères de la reine ainsi que les principaux courtisans. Pour ces hauts faits, il a été proclamé par le Parlement sauveur de la patrie. C'est un organisateur de grande valeur. Dans la guerre balkanique, il a obtenu des résultats remarquables. Il ne s'embarrasse d'aucun scrupule. Il brûle d'une fièvre nationaliste inextinguible. Ce qu'il veut, c'est la Grande Yougoslavie. Non seulement il est, dans le secret, chef de la Main noire, mais il occupe d'importantes fonctions officielles : il est chef du bureau, d'informations au Grand État-Major serbe. En fait, il est maître de tout l'espionnage de son pays. Quelle puissance !
La décision de commettre un crime exemplaire
Princip a-t-il lui-même prêté le serment de la Main noire ? C'est loin d'être sûr. Mais il semble avoir adhéré à une autre société secrète : la Mort ou la Vie. L'un de ses amis a même évoqué le serment que Princip avait prêté au fond d'une cave. C'est de celui-ci qu'allait découler l'assassinat de François-Ferdinand.
En fait, c'est depuis les manifestations de lycéens de 1912 que Princip nourrit l'idée de mettre à mort un Habsbourg. Au cours de ces années-là, plusieurs attentats ont été fomentés contre des personnalités autrichiennes. Certains ont réussi, d'autres échoué. Chaque fois qu'il en a reçu la nouvelle, Princip a traversé la même exaltation. Nous avons la preuve qu'il s'en est entretenu avec plusieurs Jeunes bosniaques, notamment Danilo Ilitch. Ce dernier vibrait à ce point à l'unisson qu'il avait pensé à tuer le gouverneur de la Bosnie, le général Potiorek.
Dès l'automne de 1913, la nécessité d'un attentat tourmente un autre Jeune bosniaque, un ouvrier imprimeur du nom de Chabrinovitch. En 1912, Princip l'a rencontré à Sarajevo. Ils ont sympathisé. En mars 1914, ils vont se retrouver à Belgrade.

En mars, quand Princip retrouve Chabrinovitch, il lui révèle qu'il est décidé à tuer l'archiduc. Quelques jours plus tard, Chabrinovitch reçoit de ses amis de Belgrade une coupure de presse sous enveloppe. Elle annonce la prochaine visite de l'archiduc FrançoisFerdinand en Bosnie, à l'occasion des grandes manoeuvres. Cet article Chabrinovitch va courir le montrer à Princip. Celui-ci, à cette époque, partage une chambre avec le fils d'un pope, un nommé Grabez, un Bosniaque lui aussi. Princip lit l'article sans ajouter aucun commentaire. Seulement, il donne rendez-vous à Chabrinovitch pour le soir-même, dans un parc.
La nuit est tombée. Les deux hommes sont assis sur un banc. Princip se tourne vers Chabrinovitch. Presque solennel, il lui demande de se joindre à lui pour assassiner François-Ferdinand. De la part de Chabrinovitch, pas la moindre hésitation : il accepte. Ils agiront donc ensemble. Ils se donnent mutuellement leur parole d'honneur d'aller jusqu'au bout et se quittent. Seulement, la nécessité d'un troisième homme leur est apparue. Princip s'adresse à Grabez. Et Grabez accepte.
Attention : tout ce qu'on vient de lire, c'est la version officielle. Celle que les intéressés rapporteront eux-mêmes. Il faut que le lecteur sache qu'il en existe une autre. Il semble que le comité de la Mort ou la Vie se soit réuni quelques jours plus tôt, sous la présidence du Bosniaque Charac. C'est alors qu'il aurait pris l'initiative de désigner Princip comme agent d'exécution. À noter que Charac avait été garde du corps du major Tankositch, l'un des chefs de la Main noire. Indication confirmative de l'influence des sociétés secrètes : fidèles à leur serment, Princip, Chabrinovitch et Grabez n'ont rien voulu dire des ordres qui leur ont été donnés. D'où la version simplifiée apportée par eux.
 Le quai Appel à Sarajevo. C'est là que le terroriste Princip vit déboucher l'automobile de l'archiduc. Il tira au jugé et abattit François-Ferdinand et son épouse.
|
Aussitôt qu'il entre en possession de ces armes, Princip écrit à Danilo Ilitch, à Sarajevo, une lettre - en code - l'invitant à recruter d'autres volontaires. Ilitch en recrutera trois. Tout cela coûte de l'argent. On l'obtient de riches commerçants bosniaques. Bien sûr, on a parlé non pas d'attentat, mais de collecte de fonds pour créer des écoles en Herzégovine. Ainsi rassemble-t-on plus de mille dinars.
Une véritable haie d'assassins
Un grave problème : comment va-t-on se rendre à Sarajevo ? Comment fera-t-on franchir la frontière de Bosnie, très surveillée, à des hommes porteurs de bombes et de revolvers ? À cet endroit, la douane et la police sont particulièrement vigilantes. Tankositch va résoudre le problème : on utilisera le fameux tunnel, c'est-à-dire la filière clandestine de Belgrade à Sarajevo.
Princip, Chabrinovitch et Grabez quittent Belgrade le 28 mai, après s'être laissé offrir un dîner d'adieu par le comité de la Mort ou la Vie. Ils sont munis d'argent, d'armes - et aussi de cyanure. Il est prévu que, s'ils se voient en danger d'être pris, ils se donneront la mort. Pour se rendre de Belgrade à Sarajevo, ils vont mettre huit jours et huit nuits. D'abord, ils voyagent en bateau sur la Save. Après quoi, ils sont pris en main par le tunnel.
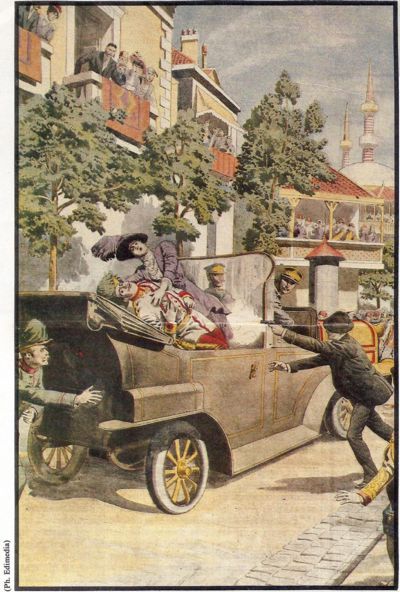 Le 4 juin, les trois hommes parviennent à Sarajevo. Alors Chabrinovitch révèle à Princip et à Ilitch que François-Ferdinand sera dans la ville le 28 juin.
Le 4 juin, les trois hommes parviennent à Sarajevo. Alors Chabrinovitch révèle à Princip et à Ilitch que François-Ferdinand sera dans la ville le 28 juin.Le choix de cette date est à elle seule une provocation : le 28 juin, c'est la date commémorative de Kosovo, l'anniversaire de l'assassinat du sultan Mourad par Milos Obilitch. C'est très exactement comme si, en 1917, le roi d'Angleterre s'était rendu à Dublin le jour de la Saint-Patrick.
François-Ferdinand le sait-il ? Assurément. Les avertissements lui sont venus de tout côté. Mais l'archiduc est brave. Et fataliste. Deux mois avant sa mort, parlant de sa sécurité, il a haussé les épaules et déclaré :
- Des précautions ? Des mesures de sécurité ? Je n'en ai que faire. Nous sommes partout dans la main de Dieu. Regardez, de ce buisson-là, à droite, un type peut surgir et me sauter dessus... Les craintes et les précautions paralysent la vie d'un homme.
Sophie est très inquiète. À plusieurs reprises elle a interrogé son mari sur la nécessité de ce voyage à Sarajevo. Le vieil empereur François-Joseph lui-même a conseillé à son neuveu d'y renoncer. Il parle d'expérience : c'est à Sarajevo, déjà, que naguère on a tenté de l'assassiner. François-Ferdinand a répondu :
- Je suis inspecteur général des forces armées austro-hongroises. Je dois aller à Sarajevo. Les soldats ne pourraient jamais comprendre mon absence !
Ce qu'il a annoncé, il l'accomplit donc. Le jour même où débutent les grandes manœuvres - le 26 juin - François-Ferdinand descend de son train spécial à la station thermale d'Ildizé. Où l'attend Sophie, sa femme toujours aimée.
Dans l'ombre, l'attentat se prépare. Non sans mal. Avec une détermination calme, Princip attend que vienne le moment d'agir. Les bombes et les revolvers, il les garde sous son lit. Mais Danilo Ilitch, lui, traverse une crise morale grave. Il en est venu à remettre en question à la fois l'assassinat de François-Ferdinand et le principe du terrorisme individuel. En fait, cette attitude nouvelle lui a été soufflée.
Sans que l'on sache bien pourquoi, la Main noire souhaite annuler l'attentat. Charac a rejoint Ilitch et lui a donné l'ordre de tout annuler. Ilitch, à son tour, a tenté de convaincre Princip. En vain. Princip répond qu'il ira jusqu'au bout et que rien ne pourra le faire dévier de la décision qu'il a prise. Illitch renonce à le persuader.
Au cours de la nuit du 26 au 27 juin, les conjurés parlent entre eux jusqu'à 3 heures du matin. Ilitch raconte à ses compagnons la vie des révolutionnaires... En même temps, on arrête les endroits qui se prêtent le mieux à l'attentat. Quant à l'itinéraire suivi par l'archiduc, ils n'éprouvent pas le moindre doute. Il leur a suffi d'ouvrir les journaux : le parcours exact y est soigneusement indiqué. Ilitch pense que l'endroit le mieux approprié est le quai Appel, qui va de la gare à l'hôtel de ville. Le cortège doit l'emprunter à deux reprises. On décide d'y placer six conspirateurs, répartis en trois groupes de deux. Chaque groupe devra attaquer simultanément. Si l'un manque son coup, le groupe suivant agira. On précise les emplacements réservés à chacun. Les groupes s'échelonneront sur une distance de trois cents mètres.
L'archiduc, fataliste néglige les avertissements
Le 27 juin, entre 3 et 4 heures de l'après-midi, on distribue les armes aux plus jeunes. Chacun reçoit une bombe et un revolver. Le soir, Ilitch remettra une dernière bombe à un autre volontaire.
Princip, qui d'évidence ne déteste pas les symboles, s'en va déposer des fleurs sur la tombe de Zerajitch. En 1910, celui-ci avait tiré sur le gouverneur autrichien de Sarajevo, l'avait manqué et s'était suicidé. Ilitch et Chabrinovitch iront, eux aussi, se recueillir sur la tombe.
Princip rentre chez lui, lit quelques pages de Kropotkine et s'endort. Il dira qu'il a rêvé de la Fédération mondiale des communes libres.
Le lendemain, 28 juin, Chabrinovitch va se faire photographier en compagnie d'un ami. Dès 9 heures, Princip s'est porté sur le quai Appel, ayant sur lui sa bombe et son revolver.
 Gavrilo Princip vient de tirer. Il n'a même pas visé et confiera plus tard qu'il a détourné la tête, mais la balle fera mouche et atteindra l'archiduchesse au côté droit et l'archiduc à la veine jugulaire.
|
On n'a pris que peu de précautions. Trop peu, dira-t-on à Vienne. Sur le parcours on a placé cent vingt policiers. Il y a soixante-dix mille hommes dans les environs de Sarajevo...
Il est 10 heures du matin quand François-Ferdinand, en compagnie de Sophie, arrive à la gare de Sarajevo. Ce qui frappe, c'est la sérénité de l'archiduc. À cette foule qui l'attend, il apparaît sanglé dans l'uniforme de cérémonie de la cavalerie autrichienne : tunique bleue, col montant frappé de trois étoiles, chapeau à plumes vert pâle, pantalon à bandes rouges et, autour de la taille, une ceinture d'or terminée par des glands. Il a cinquante ans. Il a beaucoup grossi. Il semble que la moustache soit encore plus agressive qu'auparavant. Mais le regard est toujours bleu. Sophie, elle, est coiffée d'une vaste capeline blanche que prolonge un voile. Elle porte une robe de satin blanc ceinturée de rouge et, sur les épaules, une cape de queue d'hermine. A la main, elle tient un éventail noir fermé.
À la gare, c'est le général Potiorek qui les a accueillis. Aussitôt, l'archiduc, son épouse et leur suite sont montés dans les six automobiles qui les attendaient. Dans la première prennent place le chef des policiers préposés à la garde particulière de l'archiduc et trois officiers de la police locale. Dans la deuxième voiture montent le maire de Sarajevo et le chef de la police de la ville. Dans la troisième s'installent l'archiduc et la duchesse. Il s'agit d'une Graef und Stift fabriquée spécialement par un carrossier viennois, avec un toit de toile qui, pour l'heure, est replié à l'arrière de l'automobile. Au-dessus du capot flotte le drapeau impérial noir et jaune bordé de rouge, avec, en son milieu, l'aigle autrichienne. L'archiduc s'assied à l'arrière, à la gauche de la duchesse. Le général Potiorek utilise le strapontin situé en face de François-Ferdinand, cependant que le lieutenant-colonel Harrach est assis à côté du chauffeur. Derrière s'avancent trois voitures dans lesquelles a pris place la suite de l'archiduc.
Le temps est magnifique. Un radieux soleil d'été. De la foule s'élèvent des vivats où domine le cri traditionnel : « Zivio ! » Sur tout le parcours, on applaudit le couple impérial, on jette des fleurs. Certes, les autorités se sont dépensées pour amener là le plus possible de partisans de l'Autriche. Malgré tout, ce voyage si controversé semble être un succès. Sophie, très crispée au début, se détend et sourit largement. Elle regarde près d'elle la rivière dont les eaux étincellent et s'enchante à considérer les minarets blancs des mosquées. Devant elle, sur la hauteur, elle reconnaît, à la fois gracieux et imposant, le vieux sérail de Mahomet II.
Les meurtriers, eux, attendent. C'est entre une véritable haie d'assassins que l'archiduc va défiler.
La voiture ! En la voyant s'approcher, le premier volontaire hésite, car un gendarme vient de se planter derrière lui. Sauvé, l'archiduc. Le deuxième hésite, lui aussi : on ne lui a pas dit que la duchesse serait là. A-t-il le droit de tuer une femme ? Sauvé une seconde fois l'archiduc. La voiture est passée. Personne n'a tiré, personne n'a lancé sa bombe. L'un des volontaires dira :
- Au dernier moment, je n'ai pas pu.
Maintenant, le cortège passe à la hauteur de Chabrinovitch. De tous les conspirateurs, il était le seul qui n'inspirait pas confiance. Princip lui-même le trouvait trop bavard, trop léger. Chabrinovitch, tranquillement, demande à un policier :
- Dans quelle voiture se trouve l'archiduc ?
- Dans la troisième.
Le gouverneur : « Tout danger est désormais passé »
Avec le même étonnant sang-froid, Chabrinovitch sort une grenade à main de sa poche, frappe le détonateur contre un réverbère tout proche, il sait que douze secondes sont nécessaires. Il attend ce qu'il faut. Après quoi, d'une main sûre, il lance la grenade vers la voiture de l'archiduc. Le chauffeur, un Tchèque, voit un objet noir voler dans sa direction. Mû par un réflexe excellent, il accélère. Il s'en faut de quelques centimètres : la grenade atterrit sur la capote repliée à l'arrière. Elle rebondit sur la chaussée et explose sous la roue gauche arrière de la voiture suivante, blessant une douzaine de personnes. Le pavé est défoncé, des carreaux ont éclaté. Deux ou trois poteaux électriques se sont abattus sur la chaussée ou sur les toits des maisons voisines. Aussitôt, François-Ferdinand a fait arrêter la voiture. Erreur qui pourrait se révéler fatale. Même, il s'est mis debout sur le marchepied pour mieux apercevoir ce qui se passe autour de lui. Impérieusement, il demande au comte Harrach de prendre des nouvelles des blessés, autour desquels s'affaire déjà le docteur Fisher.
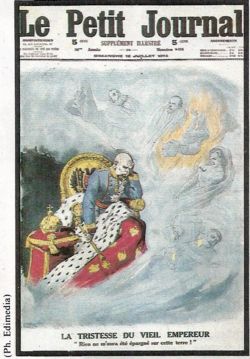 « Rien ne m'aura été épargné sur cette terre ! » La tristesse du vieil empereur, qui aura vu périr dans des conditions dramatiques son frère Maximilien,
son fils l'archiduc Rodolphe, sa bel1e-sœur la duchesse d'Alençon, son épouse Elisabeth et son héritier. |
Alors seulement François-Ferdinand s'aperçoit que Sophie est blessée au cou. Au vrai, ce n'est qu'une égratignure et elle tente aussitôt de le rassurer. Mais François-Ferdinand entre dans une colère violente. Il hurle :
- À l'hôtel de ville ! A toute allure !
Pendant ce temps, Chabrinovitch a avalé la capsule de cyanure qu'il portait sur lui. Faisant bonne mesure, il saute dans la rivière, accomplissant un bond de sept à huit mètres. Les policiers sautent derrière lui, le rattrapent, le ceinturent. Il hurle :
- Je suis un héros serbe !
Pendant qu'on l'emmène, il attend la mort qu'aurait dû lui ménager le cyanure. En vain. Le poison, sans doute éventé, ne produit aucun effet.
La voiture de l'archiduc s'est arrêtée. Erreur fatale. Princip n'est pas loin. Pourquoi ne tire-t-il pas ? En fait il s'interroge : il n'a pas reconnu François-Ferdinand et se demande dans quelle voiture l'archiduc peut bien se trouver ! Il n'a guère le temps de résoudre le problème : la voiture a redémarré et roule à vive allure vers l'hôtel de ville. Princip a raté son coup.
À l'hôtel de ville, le maire attend, entouré de ses conseillers municipaux, les chrétiens d'un côté, en habit, chapeau haut de forme à la main, les musulmans de l'autre, avec leur fez, leur veste ouverte et leur pantalon bouffant. Dès qu'il aperçoit l'archiduc, le maire entame le discours préparé de longue date et qui doit marquer l'heure suprême de sa vie :
- Votre Altesse Impériale et Royale ! Votre Altesse ! À l'occasion de la gracieuse visite dont Vos Altesses ont daigné honorer la capitale de notre pays, nos cœurs débordent de bonheur...
Il n'ira pas plus loin. Furieux, l'archiduc l'interrompt :
- Monsieur le Maire, à quoi bon ce discours ? Je viens à Sarajevo en visite amicale et on me lance une bombe ! C'est indigne...
Bouche bée, l'infortuné maire semble frappé par la foudre. La duchesse s'avance, murmure quelques mots à l'oreille de François-Ferdinand. Il semble hésiter, puis, plus calme :
- Maintenant, vous pouvez continuer votre discours.
Le maire obéit de son mieux. Il balbutie :
- Notre profonde gratitude pour la paternelle bienveillance de Votre Altesse... à l'égard du plus récent joyau de la Sainte Couronne Impériale, notre chère patrie, la Bosnie-Herzégovine...
Il transpire à grosses gouttes, parvient enfin au bout de son épreuve. L'archiduc doit lui répondre. Il cherche le chambellan qu'il a chargé de lui remettre le texte de l'allocution. Il n'est pas là - et pour cause : il se trouvait dans la voiture sous laquelle la grenade a explosé ! On attend, de longues minutes. Hors d'haleine, le chambellan apparaît enfin. L'archiduc lui arrache son papier et tressaille : les feuilles sont humides du sang versé par les officiers blessés dans la même voiture.
François-Ferdinand lit le texte préparé et, arrivé à la péroraison, improvise :
- C'est avec un plaisir tout particulier que j'ai reçu l'assurance de votre indéfectible attachement à Sa Majesté, notre gracieux empereur et roi, et je vous remercie du fond du cœur, monsieur le Maire, de l'ovation enthousiaste que la population nous a réservée, à mon épouse et à moi-même. Je le dis d'autant plus volontiers que je vois l'expression de sa joie devant l'échec de l'attentat.
Il ajoute encore, en serbo-croate, une phrase qu'il a apprise par cœur :
- Je vous prie de transmettre mes vœux les plus sincères à la population de cette belle capitale, et je vous assure de mon inaltérable bienveillance.
Un peu plus tard, l'archiduc demandera à Potiorek :
- Pensez-vous qu'il y aura d'autres attentats contre moi ?
Le gouverneur se récrie :
- Tout danger est désormais passé !
Cependant, il suggère de modifier l'itinéraire préalablement annoncé. Le programme de la visite officielle prévoit que l'archiduc se rendra au Musée, où l'attendent des membres du gouvernement. Pour cela, on doit emprunter la rue François-Joseph, particulièrement étroite. Potiorek préconise de suivre le même parcours qu'à l'arrivée, de longer le quai Appel, qui, logiquement, doit être redevenu désert. On éliminera ainsi tout péril.
Une erreur d'itinéraire qui va changer le monde
L'archiduc acquiesce, exprimant son désir d'aller saluer les officiers blessés à l'hôpital militaire.
Il est 10 h 45, lorsque le cortège quitte l'hôtel de ville. De nouveau, l'archiduc et sa femme montent dans la troisième voiture. Le lieutenant-colonel Harrach se tient debout sur le marchepied, du côté du fleuve.
Les voitures roulent à toute allure sur le quai Appel. Le chauffeur de l'archiduc constate que, contrairement à ce qui lui a été indiqué, les deux premières voitures tournent à droite dans la rue François-Joseph. Pourquoi cette fausse manœuvre ? Est-elle le résultat d'une erreur ou bien faut-il penser qu'elle a été délibérée ? Personne ne l'a jamais su. Le chauffeur de l'archiduc va suivre lorsque Potiorek crie :
- Arrêtez ! Vous prenez la mauvaise direction ! Nous devons longer le quai Appel !
 Le procès des meurtriers de l'archiduc. Plusieurs seront exécutés par pendaison, d'autres, dont Princip, en raison de leur jeune âge, seront condamnés à de lourdes peines de prison.
|
Affolé, Potiorek voit l'archiduc et sa femme tout à coup figés sur leur siège. Le gouverneur crie au chauffeur de remettre en marche. La voiture roule à toute vitesse. À l'aide de son mouchoir, le lieutenant-colonel Harrach essuie le sang qui coule des lèvres de l'archiduc. La duchesse s'écrie :
- Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ?
Puis elle glisse sur son siège, la tête entre les genoux de l'archiduc. Harrach entend François-Ferdinand murmurer :
- Soferl, Soferl, ne meurs pas ! Vis pour mes enfants !
Harrach, bouleversé, demande à l'archiduc s'il souffre :
- Ce n'est rien.
Récit de Harrach : « Son visage était légèrement distordu, il répéta six ou sept fois, mais en perdant de plus en plus conscience et d'une voix de plus en plus éteinte : "Ce n'est rien". Il y eut ensuite une courte pause, suivie d'un gargouillis convulsif de la gorge, dans laquelle le sang affluait. Cela cessa lorsque nous arrivâmes à la résidence du gouverneur. Les deux corps inanimés furent transportés à l'intérieur du palais, où le constat de décès fut bientôt établi. »
Des terroristes transformés en héros
La duchesse a été frappée d'une balle qui, traversant le flanc de la voiture, avait pénétré dans son côté droit. Quant à l'archiduc, la balle a percé le col de sa capote, tranché la veine jugulaire, se logeant enfin dans la colonne vertébrale.
Et Princip ? La foule furieuse s'est ruée sur lui, l'a frappé, jeté à terre, piétiné. Des policiers l'ont frappé à coups de sabre. Il est blessé gravement. Il perd son sang abondamment. Ceux qui l'entourent sont persuadés qu'il ne survivra pas. Ils se trompent.
Tous les conjurés - sauf un - seront arrêtés. Princip, Chabrinovitch et Grabez n'ont pas vingt ans. En raison de leur âge, ils ne seront condamnés qu'à vingt années de prison. Cinq autres, en revanche, sont promis à la pendaison, dont Danilo Ilitch. Plusieurs autres accompliront de lourdes peines de prison.
Princip, Chabrinovitch et Grabez sont jetés dans une forteresse. Ils sont chargés de chaînes, ils subissent un froid intense, on les nourrit à peine, Chabrinovitch mourra le premier, en 1916. Grabez et Princip le suivront dans la tombe en 1918.
Quand, dans l'Europe nouvelle, la Yougoslavie aura été constituée - leur rêve ! - on exhumera leurs corps et on leur fera des funérailles en grande pompe, célébrés comme les héros de l'unité nationale.
Certes, ils avaient réussi. Mais il est légitime de se demander à quel prix.
L'Autriche a adressé à la Serbie un ultimatum. La Serbie est entrée en guerre. Et puis, c'est le jeu implacable des alliances : la Russie contre l'Autriche, l'Allemagne contre la Russie, la France et l'Angleterre contre l'Autriche et l'Allemagne. Quatre années de guerre vont en découler. Et d'abominables souffrances. La conséquence la plus directe de l'attentat de Princip, Grabez, Chabrinovitch et Ilitch ? Dix millions de morts.
Alain Decaux
| Haut de page |
HISTOIRE magazine - n° 19 - Septembre 1981
| L'HISTOIRE A LA SOURCE Maréchal Pétain |
25 février 1916 : le fort de Douaumont tombe
Après la victoire de la Marne, le front se fixa à une dizaine de kilomètres au nord de Verdun et tout ce secteur connut une grande tranquillité durant dix-huit mois, jusqu'en février 1916. Le commandement allemand était, en 1916, décidé à y reprendre l'offensive. Contrairement au Kronprinz, partisan d'une attaque rapide et massive, Falkenhayn désirait, par des attaques limitées et continues, « saigner à blanc » l'armée française.
Sa stratégie d'usure prévalut et, le 21 février 1916, après une longue préparation d'artillerie, l'assaut fut déclenché sur la rive droite de la Meuse au moment où le fort de Douaumont, cœur de la défense de Verdun, venait d'être dégarni de ses défenseurs ! « L'abandon du fort de Douaumont, écrivit plus tard le général de Rouquerol, équivaut dans l'ensemble de la guerre 1914-1918 à la perte d'une centaine de mille d'hommes ». Les responsables furent sans contredit les généraux de Langle et Chrétien et leurs officiers d'état-major.
Les Français résistèrent néanmoins héroïquement, à l'image du colonel Driant disparu au bois des Caures, et qui avait été le premier, ironie du destin, à avertir les autorités (1) que le « coup de bélier » serait donné à Verdun ! Mais au soir du 24 février, les soldats du Kaiser s'étaient emparés de notre deuxième ligne de défense et le lendemain ils entraient dans le fort de Douaumont, qui n'était pas défendu. Joffre envoya alors le général de Castelnau intimer aux troupes l'ordre de tenir coûte que coûte entre Douaumont et la Meuse, et le 25 février, à 11 heures du soir, il confiait au général Pétain, déjà chef de la 2e armée, la direction de la bataille.
Issu d'une famille de paysans du Pas-de-Calais, Henri Philippe Omer Pétain s'était orienté vers la carrière militaire sous l'influence d'un grand-oncle, vétéran de la Grande Armée de Napoléon. Formé à la dure école des chasseurs alpins, il n'était parvenu, en 1914, à cinquante-huit ans, qu'au grade de colonel. On lui reprochait surtout d'aller à contre-courant des idées en vogue, c'est-à-dire de tenir pour la défensive et la guerre des positions en s'inspirant des conflits récents : la guerre des Boers et la guerre russo-japonaise qu'il avait étudiées attentivement. Il était également partisan de l'utilisation des armes nouvelles (mitrailleuses et mortiers lourds) méprisées par Grandmaison, croyait à la puissance de feu et qu'une défense bien organisée pouvait avoir raison d'une attaque ennemie, bien avant que celle-ci puisse arriver au contact.
Ses idées, son esprit trop indépendant lui valurent longtemps de marquer le pas. Instructeur à l'École de guerre à partir de 1906, il n'y eut que peu de disciples, parmi lesquels figurait un certain Charles de Gaulle, qui, impressionné par son enseignement, demanda à servir dans le régiment qu'il commandait. En 1914 l'échec des idées de Grandmaison et le limogeage par Joffre de nombre de généraux incapables allaient donner à Pétain sa véritable place. Au début des hostilités, il s'était distingué dans le cadre du les corps d'armée en Belgique et à Guise et avait remporté un des rares succès du sombre mois d'août 1914. Nommé enfin général, il prit part à l'offensive d'Artois en mai 1915 et à Vimy il faillit bien percer le front allemand et emporter la décision. En Champagne, en septembre, il essuya un revers, mais refusa de racheter comme tant d'autres cet échec aux dépens de la vie de ses hommes. Ses qualités de stratège et d'homme soucieux de ménager la peine de ses soldats allaient en faire le chef idéal pour gagner la plus grande bataille de l'Histoire.
« Jamais Pétain, dira Pierrefeu, ne cessa d'être lui-même en présence des troupes. Pas de familiarité, pas d'affection paternelle, pas d'étalage de sentimentalité, car cela ne trompe pas le soldat un seul instant. Il demeurait calme, imposant, un véritable commandant en chef, rayonnant une autorité souveraine. Il parlait d'homme à homme, dominant les soldats de son prestige, sans essayer de descendre à un niveau plus bas, comme ceux qui se font une fausse idée du peuple. Mais il y avait tant de sincérité et de sérieux dans son ton, il paraissait si parfaitement honnête, juste et humain que personne ne mettait sa parole en doute. En fait, il tirait toute sa force de son humanité. » L'histoire a ratifié ce jugement et Philippe Pétain restera à jamais le vainqueur de Verdun.
Dans ses souvenirs sur La Bataille de Verdun, (Payot, 1929), Philippe Pétain nous parle de sa prise de commandement et des forts de Vaux et de Douaumont, enjeu de ce terrible affrontement.
1. Le 22 août 1915, dans une lettre au président du Sénat, Paul Deschanel.
Me trouvant disponible avec mon quartier général à Noailles, je considérais comme extrêmement probable ma désignation pour le front de Verdun, où l'importance de la lutte engagée et des renforts envoyés à la bataille justifiait l'entrée en ligne d'une armée nouvelle. De ma propre initiative, j'avais déjà fait partir le chef de mon bureau de renseignements pour qu'il se documentât sur les événements. Je ne fus donc point surpris de recevoir, le 24 février au soir, l'ordre de mettre immédiatement mon quartier général en route vers Bar-le-Duc et de me présenter moi-même au général Joffre le 25 au matin.
Direction Douaumont !
J'arrivai à Chantilly à 8 heures et fus aussitôt introduit auprès du général en chef, qui, dans une ambiance quelque peu fiévreuse et agitée, conservait son calme coutumier. Le général Joffre, sans longues phrases, me fit connaître son impression sur la situation qui lui paraissait sérieuse, mais non alarmante ; il me prescrivit de me rendre en toute hâte à Bar-le-Duc pour me tenir prêt à remplir telle mission que le général de Castelnau, mandaté à cet effet, me préciserait.
Pour couper au plus court, je m'acheminai directement sur Souilly, village situé sur la route de Bar-le-Duc à Verdun et où je pensais trouver le général de Castelnau. Mais, par les chaussées neigeuses et verglacées, mon voyage en automobile fut long. Je ne m'arrêtai que quelques quarts d'heure à Châlons, et, pourtant, je ne rejoignis que vers 7 heures du soir le général de Castelnau et le général de Langle, réunis à Souilly. Les nouvelles de cette quatrième journée de bataille ne leur arrivaient que lentement et semblaient peu réconfortantes. Pour être aussitôt documenté, je me hâtai vers Dugny, au sud de Verdun, où se trouvait le poste de commandement du général Herr. Entre Souilly et la Meuse, je longeai le défilé des convois qui roulaient vers la place, des colonnes qui encombraient tous les chemins, des sections sanitaires qui descendaient vers le sud et surtout, spectacle lamentable, le flot désolé des habitants qui cherchaient un refuge au-delà de la zone dévastée.
À Dugny, j'appris un grave événement : le 20e corps s’était courageusement battu toute la journée autour du village de Douaumont, mais le fort venait de tomber par surprise au pouvoir de l'ennemi ! Nous perdions ainsi le meilleur et le plus moderne de nos ouvrages, celui qui résumait les raisons de notre confiance, le splendide observatoire qui nous aurait permis de surveiller et de battre le terrain des approches allemandes et d'où, maintenant, l'ennemi, pourrait diriger ses regards et ses coups vers les moindres replis du cirque sacré de Verdun !
On ne possédait, à ce moment, aucune indication sur les causes de ce douloureux accident. Mais voici - d'après l'enquête historique faite ultérieurement à ce sujet par le général Passaga - ce qui s'était passé :
Les Brandebourgeois du 3e corps prussien (général Lochow) progressaient par les ravins boisés encadrant à l'est et à l'ouest le fort de Douaumont. Notre 20e corps, entré en ligne sans connaître le terrain et sans pouvoir se souder aux débris du 30e corps, luttait de son mieux, pied à pied. Bientôt, poussé et harcelé sans merci, il se voyait refoulé jusque derrière l'énorme masse couvrante du fort de Douaumont, qu'il croyait tenu par une garnison spéciale. Une des compagnies brandebourgeoises s'arrêtait devant l'ouvrage, hésitant à l'attaquer : son chef, le lieutenant Brandis, tenait son regard fixé sur cette masse que recouvrait la neige récemment tombée...
Cet officier, au lieu de ressentir l'effroi qu'aurait dû normalement provoquer en lui l'aspect d'un aussi puissant réduit, éprouvait une sorte d'hallucination, de vertige, d'irrésistible attirance. Soudain, se retournant vers sa compagnie, il s'écriait : « Direction Douaumont ! » Puis, devant l'attitude de ses hommes qui pensaient aller à une mort certaine, il éprouvait quelque repentir de son ordre irréfléchi et, cependant, trop courageux pour se dédire, il s'élançait vers l'objectif.
« C'est moi, général Pétain.
Je prends le commandement »
La compagnie réussissait, stupéfaite, à progresser saris peine ; elle cisaillait et traversait les réseaux, se glissait dans les fossés, escaladait les pentes neigeuses du massif central, redescendait dans la cour intérieure, y trouvait les casemates ouvertes, s'y engouffrait et s'y mêlait à une corvée de territoriaux français qui - par une véritable ironie du sort - procédait au désarmement de l'artillerie des parapets ! Faisant un inventaire sommaire de l'ouvrage, le lieutenant Brandis n'y pouvait dénombrer, comme garnison réelle, qu'un gardien de batterie et une dizaine d'artilleurs chargés d'assurer le service de la tourelle de 155.
Il nous faut rappeler, en effet, que Verdun ne jouait plus comme « place forte ». Ses ouvrages, incorporés dans le système général de défense du front, ne possédaient pas d'armement et de garnison propres et devaient être défendus, à la diligence des commandants de secteur, avec les troupes dont ceux-ci disposaient pour la bataille. Douaumont lui-même, malgré son importance primordiale, n'avait fait l'objet, en temps utile, d'aucune mesure spéciale. Des instructions données le 24 par le 30e corps visaient à le faire spécialement tenir et garder ; mais, du 24 au 25, les responsabilités passaient, avec bien des heurts et des oublis, du 30e au 20e corps, et la consigne d'occupation du fort demeurait encore inappliquée quand se présentèrent les Brandebourgeois.
Le lieutenant Brandis est un brave à donner en exemple aux cadres subalternes. Combien d'autres, et des meilleurs, eussent hésité devant l'obstacle redoutable, aux flancs duquel on pouvait supposer l'existence de nombreux engins de défense prêts à jouer ! Je rapportai moi-même la nouvelle de la chute du fort au généraux de Castelnau et de Langle, à Souilly.
Le général de Castelnau estimait qu'il n'y avait plus une minute à perdre pour « organiser » le commandement et éviter des erreurs comme celle qui caractérisait les événements de la journée. Dans l'après-midi, il avait téléphoné à Chantilly pour proposer de me confier le commandement des fronts de Verdun sur les deux rives de la Meuse, « avec mission d'enrayer l'effort prononcé par l'ennemi sur le front du nord de Verdun ». Le général Joffre approuvait sa proposition.
À 11 heures du soir, dès mon retour à Souilly, le général de Castelnau transcrivait mon ordre de mission sur une feuille de son calepin de poche, la détachait et me la passait « pour exécution immédiate ». À 11 heures, je prenais donc la direction de la défense de Verdun, déjà responsable de tout et n'ayant encore aucun moyen d'action...
Dans une salle vide de la mairie, je me mettais en communication téléphonique avec le général Balfourier, commandant les forces engagées dans le secteur d'attaque :
« Allo ! C'est moi, général Pétain. Je prends le commandement. Faites-le dire à vos troupes. Tenez ferme. J'ai confiance en vous.
- C'est bien, mon général. On tiendra ! Vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur vous. »
Aussitôt après, j'appelai le général de Bazelaire, commandant les secteurs de la rive gauche, et je lui donnai les mêmes avertissements, en lui indiquant le prix exceptionnel que j'attachais à la conservation de nos positions à l'ouest de la Meuse. Il me répondit comme venait de le faire le général Balfourier, sur le ton d'une confiance affectueuse et absolue.
La liaison morale, du chef aux exécutants, était assurée.
Un peu plus tard, vers minuit, arrivait le colonel de Barescut, mon chef d'état-major. Sur une carte à grande échelle plaquée au mur, je marquais au fusain les secteurs des corps d'armée en position, ainsi que le front à occuper, et je dictais l'ordre que l'on devrait faire parvenir à toutes les unités le lendemain matin.
Tels furent, à Verdun, mes premiers actes de commandement...
Après la chute de Douaumont, Pétain s'attacha à régler le problème primordial des communications. Verdun, du fait des attaques incessantes de l'artillerie allemande, n'était plus relié à l'arrière que par le chemin de fer à voie étroite Verdun-Bar-le-Duc, le « Petit Meusien ». Le général fit dégager la route Bar-le-Duc-Verdun via Souilly, la fameuse « voie sacrée », qui fut exclusivement réservée aux camions apportant en une chaîne ininterrompue les renforts, vivres et munitions. Dès la fin de février, grâce à son énergie, l'offensive ennemie s'essoufflait au nord de la ville. Mais à partir du 6 mars, les attaques reprirent avec une terrible intensité illustrée par les noms de Cumières, du Mort-Homme et de la cote 304. Le 10 avril Pétain, lançait son fameux ordre du jour : « On les aura ! » Après trois mois de combats acharnés, l' « enfer de Verdun », l'avance allemande n'avait progressé que de quelques kilomètres. Malheureusement, la tentative de Mangin pour reconquérir Douaumont échoua (22-25 mai). C'est alors que la dégradation militaire sur son front oriental poussa l'état-major allemand à jouer le tout pour le tout. Son offensive de juin allait lui permettre de s'emparer du fort de Vaux et de Thiaumont, théâtre de l'héroïque sacrifice des hommes de la Tranchée des baïonnettes.
Falkenhayn joue le tout pour le tout
La 5e armée allemande et la IIe armée française n'arrivaient pas au bout de leurs peines ; elles n'avaient même pas encore touché le fond de leurs épreuves, mais elles seraient désormais englobées dans les actions d'ensemble que les hauts commandements préparaient depuis plusieurs mois. La lutte, au lieu de s'apaiser, rebondirait de ce fait et « la crise » de Verdun devait atteindre son point culminant en même temps que se réveillerait sur les différents fronts l'activité combative des autres armées.
À partir du milieu de mai, l'Autriche-Hongrie causait au commandement suprême des empires centraux le plus grave souci. Elle avait une grande hâte, bien inquiétante aux yeux de ses alliés, de s'illustrer par un succès qu'elle espérait facile sur le front italien. Elle s'y croyait très supérieure à ses adversaires, sinon par le nombre des combattants, du moins par l'organisation, l'armement et l'instruction de ses armées, et nourrissait l'illusion de régler vivement son compte à l'ennemi séculaire. Falkenhayn, prévoyant qu'un ébranlement du front oriental ne tarderait pas à s'ensuivre, s'efforçait de détourner son alliée de ce dessein, mais ses objurgations demeuraient sans écho... L'Autriche-Hongrie entendait secouer la tutelle du commandement allemand et vaincre au moins une fois de ses propres moyens : le 15 mai, elle passait à l'attaque dans le secteur compris entre l'Adige et la Brenta et réalisait une sensible progression au centre, dans la région d'Asiago. Là s'arrêtait son effort. La vigueur des réactions italiennes, qui ne tardèrent pas à se produire ne légitima que trop les appréhensions de Falkenhayn, qui dut autoriser le prélèvement d'un renfort important sur les armées de Galicie. A l'armée française, seule engagée depuis trois mois contre le gros des forces ennemies, le général Cadorna venait ainsi d'apporter un premier concours par la belle résistance et la riposte de ses troupes !
Broussilov, de son côté, conformément aux engagements pris par la Russie le 6 décembre 1915 à Chantilly et le 28 mars 1916 à Paris, avait au cours de l'hiver reconstitué ses forces et, triomphant de très lourdes difficultés d'organisation, préparé dans le plus grand secret la puissante offensive que nous attendions avec impatience. Il la déclenchait le 4 juin. Exploitant avec habileté le désarroi et l'humiliation des Austro-Hongrois, il ouvrait en Volhynie et en Bukovine une immense brèche de plus de 50 kilomètres, au travers de laquelle il jetait ses armées. Les réserves allemandes disponibles dans l'est s'efforçaient de limiter le mal, mais elles n'étaient pas assez nombreuses pour y réussir, et le commandement suprême se voyait contraint d'en amener de nouvelles à l'heure critique où il s'attendait à l'entrée en action des Britanniques.
Par quel procédé ceux-ci pourraient-ils être retenus ou, au moins, retardés ? Il n'en existait pas d'autre, aux yeux de Falkenhayn, que de précipiter la ruine de la France, considérée par lui, nous l'avons vu, comme « la principale épée » de l'Angleterre... Le Kronprinz recevait donc encore une fois l'ordre de « pousser » sur les Côtes-de-Meuse. Sans doute ses troupes étaient-elles épuisées par leurs sanglantes attaques de la cote 304, du Mort-Homme ou de Thiaumont, mais le succès obtenu à Douaumont, du 22 au 25 mai, n'avait-il pas relevé leur moral, exalté leur confiance, régénéré leurs aspirations vers la victoire ? D'ailleurs, on accroîtrait leurs moyens pour les assauts prévus.
L'héroïque résistance du commandant Raynal
Aux premiers jours de juin, trois corps d'armée se ruaient, en conséquence, contre nos positions du fort de Vaux : c'étaient, de l'ouest à l'est, le 1er, bavarois, le 10e corps de réserve et le 15e corps qui, tous trois, connaissaient bien le terrain sur lequel ils se dépensaient depuis des semaines et des mois. Après un terrible bombardement, ils réussissaient à installer sur la superstructure du fort plusieurs groupes d'assaillants qui, pièce à pièce, s'attaquaient à chaque îlot de résistance. Plus favorisés que nous ne l'avions été quelques jours auparavant à Douaumont, ils parvenaient, grâce au saillant que formait en cet endroit notre position, à encercler aux trois quarts l'ouvrage, dont les communications avec l'arrière ne tardaient pas être irrémédiablement compromises. De notre part, c'était vraiment lutter pour l'honneur que de tenir dans des conditions pareilles. Pénétrés de cette haute ambition, le commandant Raynal et ses héroïques compagnons d'armes refusaient de céder la place ; pour reconnaître officiellement l'insigne qualité de leur abnégation, le général Joffre leur adressait ses félicitations et décernait au chef une haute récompense dans la Légion d'honneur. Rien n'est émouvant comme l'évocation de leur agonie quand, séparés de nous et ne pouvant s'illusionner sur l'arrivée d'aucun secours, ils nous adressaient leurs suprêmes comptes rendus.
Celui du 4 au matin, venu par pigeon voyageur :
« Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées très dangereuses. Il y a urgence à nous dégager. Faites-nous donner de suite communication optique par Souville qui ne répond pas à nos appels... C'est notre dernier pigeon ! »
Puis le message optique de la matinée du 5, passé à Souville :
« L'ennemi travaille, partie ouest du fort, à constituer un fourneau pour faire sauter voûte. Tapez vite avec artillerie. »
Cet autre, à 8 heures :
« N'entendons pas votre artillerie. Sommes attaqués par gaz et liquides enflammés. Sommes à toute extrémité. »
Encore celui-ci, à la tombée de la nuit du 5 au 6 :
« Il faut que je sois dégagé ce soir et que ravitaillement en eau me parvienne immédiatement. Je vais toucher au bout de mes forces. Les troupes, hommes et gradés, en toutes circonstances, ont fait leur devoir jusqu'au bout. »
Seulement ces quelques paroles, le 6 :
« ... Interviendrez avant complet épuisement... Vive la France ! »
Enfin, le 7, à 3 h 30, ces derniers mots, incompréhensibles :
« Ne quittez pas... »
Le Kronprinz, la mort dans l'âme
À aucun moment, le commandement français ne restait sourd à ses appels. Presque sans arrêt, des contre-attaques s'organisaient ou s'improvisaient, mais aucune d'elles ne pouvait franchir le cercle de feu qui isolait l'ouvrage. Le 7, quand déjà le communiqué allemand annonçait la chute du fort, à l'heure où le commandant Raynal et ses soldats avaient été terrassés par les obus, étouffés par les gaz, vaincus par la soif, le général Nivelle lançait encore vers eux la brigade mixte du colonel Savy « pour la plus belle mission que puisse avoir une troupe française, celle d'aller au secours de compagnons d'armes qui font vaillamment leur devoir dans des circonstances tragiques ». Il était trop tard ! Le fort de Vaux, captif, devait attendre des jours meilleurs, aux côtés du fort de Douaumont, pour entrer glorieusement dans les lignes françaises. Mais la défense de Verdun ne s'en trouvait nullement compromise et la 5e armée allemande ne remportait pas la victoire escomptée qui, par sa répercussion lointaine, dégagerait les Austro-Hongrois, arrêterait les Russes ou découragerait les Anglais.
Le 12, fort des succès de nos alliés, le commandant en chef agissait directement sur le moral des troupes par cet ordre du jour : « Le plan mûri par les Conseils de la coalition est maintenant en pleine exécution. Soldats de Verdun, c'est à votre héroïque confiance qu'on le doit : c'est elle qui a été la condition indispensable du succès : c'est sur elle que reposent nos victoires prochaines : car c'est elle qui a créé sur l'ensemble du théâtre de la guerre européenne une situation dont sortira demain le triomphe définitif de notre cause. Je fais appel à tout votre courage, à votre esprit de sacrifice, à votre ardeur, à votre amour de la patrie pour tenir jusqu'au bout et pour briser les dernières tentatives d'un adversaire qui est maintenant aux abois ».
À moi-même, qui lui avais écrit la veille pour lui demander de fixer à une date aussi rapprochée que possible l'offensive des Anglais, le général Joffre faisait connaître que l'action franco-britannique s'engagerait à très brève échéance, grâce à la résistance admirable de Verdun, puis il ajoutait ces mots : « Je compte sur votre activité et votre énergie pour faire passer dans l'âme de tous vos subordonnés la flamme d'abnégation, la passion de résistance à outrance et la confiance qui vous animent ! »
La parole et l'attitude du chef arrêtaient ainsi la crise menaçante à l'intérieur et en préservaient complètement l'Armée... Je devais m'en souvenir en 1917.
Chez nos adversaires, le moral fléchissait sérieusement. Depuis l'échec des Autrichiens sur le front italien et la poussée de Broussilov en Galicie, la presse germanique changeait de ton et trahissait un sentiment général d'inquiétude, fort insolite dans un pays où l'opinion publique n'avait point licence de se manifester. Mais, fait particulièrement grave, les discussions s'accentuaient et s'aigrissaient parmi les chefs. Hindenburg et Ludendorff voyaient leur prestige grandir, car ils n'avaient connu, sur les fronts d'Orient, que des succès et ne manquaient pas de souligner les fâcheuses conséquences de l'entreprise de Verdun ; ils faisaient observer que, si on les avait écoutés, on n'aurait pas dégarni l'est au profit de l'ouest et qu'on ne serait pas maintenant contraint à ramener des forces vers l'est, soit pour secourir les Autrichiens chancelants, soit pour menacer les Roumains, que le succès russe entraînait rapidement dans l'orbite des alliés de la France. Mais Falkenhayn, battu en brèche, tenait à sa victoire de Verdun, tandis que le Kronprinz s'efforçait de lui en montrer l'inanité. Celui-ci tenta d'en référer à la haute autorité de l'empereur, sans toutefois réussir à faire prévaloir son point de vue : « Les mois de combat de cette période devant Verdun, a-t-il écrit, comptent parmi mes souvenirs les plus pénibles de toute la guerre. Je devinais et je savais quelle était la situation de l'avant et j'avais eu des entretiens qui ne me laissaient aucune illusion. J'étais, dans mon for intérieur, absolument opposé à ce que l'offensive fût continuée, et cependant je devais en exécuter l'ordre ! »
Les Vendéens mouraient en égrenant leur chapelet
Le devoir qui incombait encore à la 5e armée allemande, il faut reconnaître qu'elle le remplit avec maîtrise. Elle continuait à être alimentée à une vingtaine de divisions. Notre IIe armée en alignait alors autant, groupées en sept secteurs de corps d'armée. Nous arrivions donc à l'égalité en nombre de divisions engagées, mais, dans des combats livrés pour Douaumont et Vaux, notre artillerie restait toujours inférieure, à tel point que, le 11, j'écrivais au général Joffre : « Nous luttons, au point de vue artillerie, dans la proportion de 1 contre 2 ; cette situation ne saurait se prolonger indéfiniment sans danger pour la sécurité de notre front... ». Le Grand Quartier général, pressé par la concentration de ses moyens sur la Somme, économisait les munitions et nous réduisait à l'allocation quotidienne de 11 000 coups, nettement insuffisante pour tenir tête à la dépense de projectiles sans cesse croissante de l'adversaire. De cela, nous allions souffrir beaucoup, et pourtant il fallait nous y résigner, car plus que qui que ce soit, nous tenions au rapide et grand succès de l'offensive franco-britannique.
Nos soldats firent preuve en ces circonstances de vertus étonnantes, qu'aucune troupe n'a jamais pratiquées à un si haut degré. Ils écrivirent alors cette page incomparable de la Tranchée des baïonnettes que le commandant Bouvard a si bien retracée dans son opuscule sur la Gloire de Verdun :
« Dans la nuit du 10 au 11 juin, les ler et 3e bataillons du 137e d'infanterie relèvent, sur les pentes nord du ravin de la Dame, au nord et nord-ouest de la ferme de Thiaumont, des troupes épuisées...
« Le bombardement est d'une très grande violence, entravant les reconnaissances et l'arrivée des bataillons. Il dure toute la journée du 11 par obus de gros calibre, sous lequel le col est remué comme la pâte d'un pétrin...
« Les pertes sont fortes. Le 11 au soir, on ne compte plus que 70 hommes par compagnie pour un effectif de 164 à l'arrivée en ligne. Il y a du sang partout. Près du poste de secours, des filets rouges courent dans le boyau. On trouve sur le sol remué des têtes et des membres détachés...
« Les survivants sentent que l'heure du sacrifice sonne. Comme les armes, bouchées par la terre, sont hors d'état de fonctionner, les hommes mettent la baïonnette au canon pour le corps à corps imminent...
 |
Verdun. La tranchée des Baïonettes. Une section prête à sortir de la tranchée y fut ensevelie, les canons des fusils émergnet de terre. (ph. E.C.A.) |
« À 6 heures, les Allemands surgissent, dix fois plus nombreux contre des compagnies réduites à 30 hommes... Les grenades sont épuisées... Les Français sont submergés ; presque tous les survivants sont faits prisonniers. Mais deux mitrailleuses, restées en état de tirer, balaient le terrain sur lequel l'ennemi ne peut se maintenir et qu'il évacue, laissant seulement un groupe dans la ferme de Thiaumont.
« ... Les hommes qui dorment là leur farouche sommeil étaient des Vendéens, soldats admirables, animés d'une grande foi religieuse. Beaucoup moururent en égrenant leur chapelet, décidés très naturellement à ne pas céder un pouce du terrain qui leur était confié, parce que leurs chefs leur avaient dit que le sort de Verdun et celui de la France exigeaient leur sacrifice... »
Le 23 juin fut une journée particulièrement critique. Après deux jours de préparation par leurs batteries lourdes, qui dominaient nettement les nôtres, les Allemands passaient à !'attaque depuis l'ouest du village de Douaumont jusqu'au sud-est du fort de Vaux.
Notre 6e corps et la droite de notre 2e corps, durement éprouvés par l'avalanche des obus et des gaz, ralentissaient pendant quelques heures l'avance de l'ennemi, mais celui-ci s'emparait bientôt de toute la crête allant du village de Fleury au village de Thiaumont, puis continuait sa progression vers les bois au sud de Fleury et sur la crête de Froideterre, au sud-ouest de Thiaumont. La situation devenait grave, car notre dernière position, du fort de Saint-Michel à celui de Souville, se trouvait investie à très courte distance. Si nous venions à la perdre, Verdun apparaîtrait à découvert au centre d'un vaste cirque dont les bords seraient tenus par l'ennemi. Notre occupation de la rive droite, dans ces conditions, deviendrait irrémédiablement compromise...
« Vous ne les laisserez pas passer, mes camarades... »
Or, les disponibilités de la IIe armée n'étaient pas suffisantes ni en quantité ni surtout en qualité, car elles se composaient de divisions trop fatiguées pour résister avec certitude aux assauts dont nous prévoyions la continuation. Le général Nivelle, cependant qui réclamait avec insistance des renforts, cherchait à faire vibrer toutes les cordes sensibles de ses troupes en leur annonçant que leur isolement dans la bataille cesserait prochainement : « L'heure est décisive... Se sentant traqués de toutes parts, les Allemands lancent sur notre front des attaques furieuses et désespérées, dans l'espoir d'arriver aux portes de Verdun avant d'être attaqués eux-mêmes par les forces réunies des armées alliées... Vous ne les laisserez pas passer, mes camarades... »
Dans la soirée du 23, je téléphonai au général de Castelnau, à Chantilly, pour l'éclairer, lui rappeler l'importance primordiale que nous attachions à la conservation des positions menacées, lui montrer que nous ne pouvions pas tenir le coup avec des « divisions de deuxième ordre ». Je terminai par ces mots, réitérant à ce sujet mes insistances quotidiennes : « Il faut avancer l'attaque anglaise ».
J'obtenais aussitôt satisfaction sur le premier point et quatre divisions fraîches étaient mises à ma disposition. Le général Nivelle pouvait alors, à partir du 24, non seulement enrayer l'avance ennemie, mais même entamer une série de contre-attaques visant à dégager notre position de repli. Sur la côte de Froideterre et autour de l'ouvrage de Thiaumont s'engageaient de rudes combats au cours desquels les divers points d'appui passaient alternativement de mains en mains. On revivait les souvenirs du mois de mai, quand, sur la rive gauche, nos troupes se dépensaient avec une égale énergie pour sauvegarder l'intégrité de la position de résistance à la cote 304 et au Mort-Homme.
Cependant, malgré ces succès, le temps était passé pour les Allemands. Depuis le 4 juin, en effet, les Russes attaquaient en Volhynie, et, en juillet, la grande offensive franco-britannique commençait sur la Somme. Pour Verdun, c'était enfin le salut.
| Haut de page |
HISTORAMA - N° 33 - Novembre 1986.
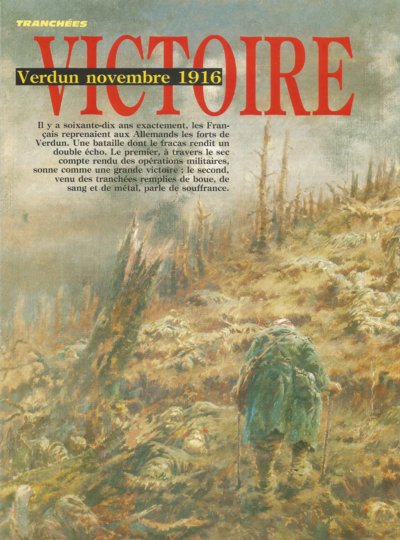
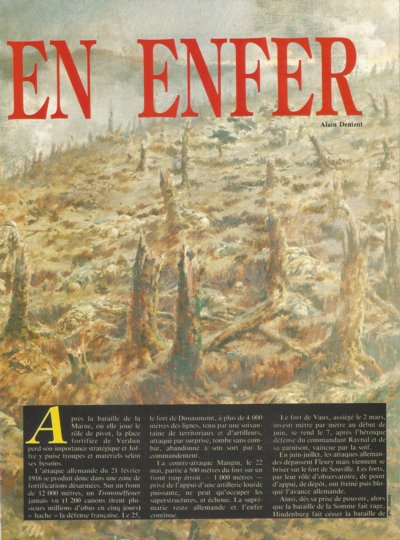
« Le Ravin de la mort », par Gueldry (musée des Deux Guerres mondiales).
Après la bataille de la Marne, où elle joue le rôle de pivot, la place fortifiée de Verdun perd son importance stratégique et Joffre y puise troupes et matériels selon ses besoins.
L'attaque allemande du 21 février 1916 se produit donc dans une zone de fortifications désarmées. Sur un front de 12 000 mètres, un Trommelfeuer jamais vu (1200 canons tirent plusieurs millions d'obus en cinq jours) "hache" la défense française. Le 25, le fort de Douaumont, à plus de 4000 mètres des lignes, tenu par une soixantaine de territoriaux et d'artilleurs, attaqué par surprise, tombe sans combat, abandonné à son sort par le commandement.
Le contre-attaque Mangin, le 22 mai, partie à 500 mètres du fort sur un front trop étroit - 1 000 mètres - privé de l'appui d'une artillerie lourde puissante, ne peut qu'occuper les superstructures, et échoue. La suprématie reste allemande et l'enfer continue.
Le fort de Vaux, assiégé le 2 mars, investi mètre par mètre au début de juin, se rend le 7, après l'héroïque défense du commandant Raynal et de sa garnison, vaincue par la soif.
En juin-juillet, les attaques allemandes dépassent Fleury mais viennent se briser sur le fort de Souville. Les forts, par leur rôle d'observatoire, de point d'appui, de dépôt, ont freiné puis bloqué l'avance allemande.
Ainsi, dès sa prise de pouvoir, alors que la bataille de la Somme fait rage, Hindenburg fait cesser la bataille de Verdun, le 2 septembre : « Les lignes atteintes seront organisées en position de longue durée. » La moitié de l'armée française est passée au laminoir, les pertes dépassent 300 000 hommes.
Au moment où les Allemands renoncent à Verdun, le commandement français décide de passer à l'attaque. Les artisans de cette première bataille offensive, en poste depuis le ler mai, sont Joffre (général en chef), Pétain (groupe d'armées du Centre), Nivelle (IIe armée de Verdun), Mangin (groupement D.E., de la Meuse à Eix).
 Le maréchal Joffre, par Jacquier (Versailles). Général en chef depuis décembre 1915, Joffre est le principal artisan de l'offensive de novembre. Politiquement affaibli par l'échec de la Somme, il sera démis de ses fonctions en décembre 1916 et remplacé par Nivelle. (Ph. Josse) |
Le projet d'offensive Mangin du 17 a pour objectif la croupe nord du ravin de la Dame, la ferme Thiaumont, les pentes nord du ravin de Bazil, la partie sud du bois Fumin. Nivelle approuve le 19, prolonge l'attaque à l'aile droite, face au fort de Vaux.
Le champ de bataille recouvert d'un brouillard épais ressemble « aux abords fangeux d'un abreuvoir piétiné par des milliers de bêtes. »
Le plan d'engagement Mangin du 24 décompose l'offensive en deux phases (pour ménager les forces humaines) à deux objectifs (le premier correspondant au projet Mangin), désigne les divisions d'attaque et leur second objectif. En première ligne, le I le R.I. (33e D.I.) - tranchée Balfourier, carrières d'Haudromont - rattaché à la 38, D.I. du général Guyot d'Asnières de Salins - route de Bras à Douaumont et sud du fort de Douaumont ; la 133e D.I., la « Gauloise », de Passaga - ravin de la Fausse Côte ; la 74e D.I. du général de Lardemelle - ravin des Fontaines et première ligne allemande au sud du fort de Vaux. En cas de succès, Mangin prévoit la reprise du fort de Douaumont.Le second plan d'engagement, du 4 octobre, inclut un troisième objectif le village et le fort de Douaumont, que Pétain réunit le 9 au deuxième objectif. Le 10, Nivelle fixe l'attaque au 17 octobre, « sauf modifications résultant de la température ».
Le mauvais temps qui règne à partir du 12 empêche la préparation d'artillerie prévue pour six jours et fait reporter l'attaque. Toutefois l'offensive aura lieu coûte que coûte : c'est ce que Nivelle proclame le 17. « Une artillerie d'une puissance exceptionnelle maîtrisera l'artillerie ennemie et ouvrira la voie aux troupes d'attaque. La préparation dans toutes ses parties est aussi complète, aussi parfaite que possible. Quant à l'exécution, elle ne saurait manquer d'être également parfaite, grâce à la discipline, à la bonne instruction, à la confiance et à l'entrain résolu des troupes qui auront l'honneur d'en être chargées ». Et Mangin ajoute, le 18, que le fort de Vaux « n'est pas un objectif éventuel, mais déterminé ».
 Le général Mangin, qui élabora les plans d'offensive et les mena à bien. Il restera dans les mémoires comme le « vainqueur de Douaumont ». (Ph. Vigne) |
Le 20 octobre, le temps se met au beau et l'attaque est fixée au 24. La préparation d'artillerie commence, effroyable. Pendant six jours, 654 canons de tout calibre - 265 du 65 au 105, 369 du 120 au 220, 20 du 240 au 400 (250 de 75, 2 de 400, 2 de 370) - tirent 693 400 obus, principalement sur un front de 7 000 mètres de longueur et 2 000 mètres de profondeur.
La suprématie aérienne absolue - escadrilles, ballons d'observation - permet une préparation d'artillerie efficace. Si l'artillerie allemande se trouve violemment contrebattue, l'infanterie, elle, est annihilée. Les tranchées sont nivelées, les abris, défoncés, les survivants se terrent dans les trous d'obus, les relèves sont détruites ou dispersées sur leurs itinéraires repérés à l'avance, les réserves, atteintes dans leurs cantonnements. Lorsque l'artillerie allemande vérifie son barrage, les Français « en prennent pendant dix minutes comme nous en prenons, nous, pendant des heures et des jours », raconte un combattant allemand.
 Le combat est inégal. Face au cloaque allemand, où le gel aggrave les destructions, les Français ont aménagé le front d'attaque, consolidé les premières lignes, empierré les routes et les pistes, créé des passages étroits pour l'artillerie lourde. Un officier constate amèrement :« Si nous avions eu tout ça au début de la guerre, nous ne nous battrions pas en France actuellement. »
Le combat est inégal. Face au cloaque allemand, où le gel aggrave les destructions, les Français ont aménagé le front d'attaque, consolidé les premières lignes, empierré les routes et les pistes, créé des passages étroits pour l'artillerie lourde. Un officier constate amèrement :« Si nous avions eu tout ça au début de la guerre, nous ne nous battrions pas en France actuellement. »L'ascendant moral, l'initiative ont changé de camp. La défense allemande, chloroformée par le Trommelfeuer, attend chaque jour l'attaque.
Mais Nivelle, l'artilleur, a les moyens, ne veut pas manquer sa cible. Le 22, à 14 heures, il déclenche une attaque simulée.
L'opération est un succès, des batteries réservées se dévoilent et, sur 158 emplacements de batteries révélées (environ 470 pièces), 90 seulement entreront en action le 24. L'artillerie française, guidée par l'aviation, a bien rempli son rôle de contrebatterie.
Mangin porte l'estocade le 23 ; les canons de 400 entament la destruction des forts de Douaumont et de Vaux, du jamais vu. Si l'optimisme règne dans le camp français, l'enfer est allemand. Un message trouvé sur un pigeon voyageur du 118e Réserve indique : « La garnison est complètement incapable de combattre. » Soixante-douze Allemands, dont 2 officiers, épuisés et morts de faim, se rendent.
Les Allemands se rendent sans combattre
Le matin du 24 octobre le champ de bataille, recouvert d'un brouillard épais, ressemble « aux abords fangeux d'un abreuvoir piétiné par des milliers de bêtes ». Bien que la visibilité varie entre 20 et 80 mètres, Mangin ne reporte pas l'attaque. L'artillerie a effectué ses réglages, les cadres ont une boussole, la troupe s'est entraînée à Stainville, près de Bar-le-Duc, où le fort de Douaumont et ses abords ont été reconstitués en grandeur nature.
À 11 h 40, l'infanterie d'attaque, arrivée la veille sur ses positions de départ pour limiter au minimum les fatigues et les pertes, s'élance à la conquête du premier objectif, progressant de 100 mètres en quatre minutes, à 70 mètres derrière le barrage roulant des 75. Le tir allemand se déclenche douze minutes plus tard ; les Français sont déjà dans les premières lignes adverses, le brouillard a masqué les mouvements des troupes.
Les 38e et 133e D.I. avancent comme à la parade, en l'absence d'organisations défensives. Abasourdis, les Allemands se rendent presque sans combattre, quand ils ne sont pas surpris dans les abris. Au ravin de la Dame, un officier supérieur sort de son abri en culotte, tenant à la main ses molletières, et clame « chef de corps ». Un vaguemestre en train de procéder au triage des lettres émerge de son trou, les yeux hagards, les bras levés, brandissant d'une main sa boîte aux lettres, de l'autre une liasse d'enveloppes, et s'écrie d'une voix suppliante : « Pardon, pardon, Monsieur ! ». Le 4e Zouaves fera ainsi 1 600 prisonniers, un record.
Mais, aux ailes, le 11e R.I., aux carrières d'Haudromont, et la 74e D.I., sur la première ligne allemande (tranchées Clausewitz et Seidlitz) et la ligne de soutien (Sablière, Petit Dépôt), se heurtent à une résistance acharnée, avec mitrailleuses, qui bloque toute progression et nécessite des renforts. Le premier objectif n'est pas atteint.
Après un arrêt de une heure pour permettre aux troupes de s'organiser sur place, les bataillons de deuxième ligne partent, à 13 h 40, à l'assaut du second objectif. Le brouillard stagne toujours, le soleil apparaîtra vers 14 h 30.
Entre les forts de Douaumont et de Vaux la 133e D.I. atteint le ravin de la Fausse Côte à 15 h 30. La 38e D.I. occupe à la grenade les carrières d'Haudromont, à 17 heures (1le R. 1.), le village de Douaumont - évacué - à 14 h 45 (6e bataillon de zouaves du 4e Mixte). Au 8e Tirailleurs, le sous-lieutenant Gilbert, accompagné de quelques hommes, descend dans le ravin du Helly, déserté, détruit à la grenade 4 pièces de 77 et 1 obusier de 150, mais ne peut reconnaître plus loin en raison de barrage français.
Ancien du Maroc, Mangin donne le fort de Douaumont au régiment d'infanterie coloniale du Maroc, qui a gagné la fourragère à Dixmude et à Fleury. Le 4e bataillon Modat part en tête à 11 h 40, trouve la première ligne française occupée par 50 Allemands, qui, pour éviter la préparation d'artillerie, se sont ainsi mis à l'abri. Ce contretemps retarde la progression. À 13 h 40, le ler bataillon Croll, chargé d'encercler le fort et d'organiser le terrain, s'élance à la conquête du second objectif, suivi du 8e bataillon Nicolaï, préparé et équipé pour occuper le fort.
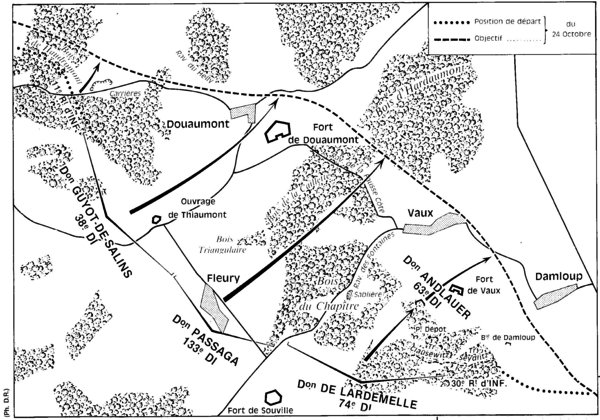

[...] Je vais faire une tournée dans les couloirs : ce que je vois est affreux. Des hommes sont pris de vomissements causés par l'ingestion d'urine, car ces malheureux en sont arrivés là, à boire leur urine ! D'autres s'évanouissent. Dans la grande galerie, un homme lèche un petit sillon humide sur le mur... Journal du commandant Raynal |
Le lendemain, nous fûmes volontaires tous les deux pour aller chercher de l'eau. On nous donna les bidons et nous partîmes un peu avant la fin du jour. La source était près du tunnel de Tavannes, dont on a tant parlé. Elle était diablement loin du bois Fumin et, avant de l'atteindre, nous avions rencontré tant de poilus affalés sur le sol avec leurs bidons autour d'eux, tués à l'aller ou au retour, que nous comprenions ce que cela signifiait : « être volontaires pour la corvée d'eau ! » Des 150 faisaient éclater leur voix puissante. Nous sentions la mort sur nos fronts... Des cris de joie accueillirent notre retour. Georges Gaudy, dans Les Trous d'obus de Verdun. Mes hommes qui ne boivent plus, ne mangent plus, ne dorment plus, ne tiennent debout que par un prodige de volonté... Plus de ravitaillement d'aucune sorte : pour vivres, quelques biscuits, quelques boîtes de « singe », qu'on hésitait à manger ar crainte d'avoir soif... Impossible de prendre le moindre repos. Nous étions dévorés par les poux - les totos - dont on sentait la morsure sitôt que l'on n'était plus préoccupé par le combat. Le samedi au matin, je note sur mon carnet : Il y a près de soixante-douze heures que je n'ai pas dormi... Ch. Delvert. |

Le capitaine Prollius qui mangeait des pruneaux
La patrouille du caporal Baranger arrive devant le fossé, rencontre des éléments du Se bataillon Mégemont (321e R.I, 133e D.I) qui ont pris la batterie Est du fort, mais le bataillon Nicolaï n'est pas au rendez-vous. Le sous-lieutenant Lesseux, du 5e bataillon, emmène le fusilier-mitrailleur Jayr, les grenadiers Dumont et Meydon, franchit le fossé du fort, occupe la tourelle Est, première reconquête, et fait huit prisonniers. Le capitaine Dorey (ler bataillon du R.I.C.M.) prend alors la décision d'entourer l'ouvrage en occupant également ses superstructures.
Perdu dans le brouillard, sa boussole déréglée par le casque et le revolver, Nicolaï arrive enfin vers 15 heures ; son bataillon nettoie le fort à la grenade et au lance-flammes. Le capitaine Prollius, qui était en train de manger des pruneaux, est fait prisonniers ainsi que 3 officiers et 24 hommes. Deux soldats du 90e régiment d'infanterie de réserve, isolés dans le coffre nord-ouest, démunis d'ordres, seront faits prisonniers le 25. Curieusement, ni les Français ni les Allemands n'ont défendu le fort de Douaumont, qui dominait le champ de bataille.
Ecrasé la veille par les obus de 400 capables de traverser les deux mètres d'épaisseur de béton, le fort a subi des dégâts considérables. À 11 h 30, le premier obus écrase l'infirmerie et fait 60 morts ; des obus aussi dévastateurs se succéderont ainsi à quinze minutes d'intervalle. Les casemates 8,11,17 sont détruites à leur tour ; au seizième coup, le dépôt du génie prend feu à côté d'un dépôt de 7 000 grenades et d'obus français amorcés.
Une éclatante revanche
Le major Rosendahl, chef de la garnison, décide alors l'évacuation du fort par quelque 300 hommes, ne laissant, à 18 heures, qu'une centaine d'hommes épuisés pour éteindre l'incendie. Puis, en raison de la fumée et des gaz toxiques du bombardement français, le fort est totalement évacué à 6 heures le lendemain. Le capitaine Prollius, observateur d'artillerie, prend le dernier tour de garde à 8 heures.
À l'aile droite, la 74e D.I. occupe à 20 heures, après des combats sanglants, la Sablière (230e R.I.), le Petit Dépôt (299e R.L), la Grande Carrière (333e R.I.), la batterie de Damloup (30e R.I.), à 500 mètres du fort de Vaux. L'échec est dû à Mangin, qui a ajouté au dernier moment ce fort comme objectif. La préparation d'artillerie, jusqu'alors très insuffisante, devait avoir lieu le 24. Le brouillard a gêné les réglages, les réseaux de barbelés et les nombreux réduits n'ont été que partiellement détruits. De plus, si le fort de Douaumont, sans défenses avancées, a reçu 978 obus de calibres 270 à 400, le fort de Vaux, avec trois lignes de défense, en a reçu 401.
La journée du 24 octobre représente, toutefois, une grande victoire, Nivelle le clame au groupement Mangin. « En quelques heures d'un assaut magnifique, vous avez enlevé, d'un seul coup, à votre puissant ennemi le terrain hérissé d'obstacles et de forteresses du nord-est de Verdun, qu'il avait mis huit mois à arracher, par lambeaux, au prix d'efforts acharnés et de sacrifices considérables. Vous avez ajouté de nouvelles et éclatantes gloires à celles qui couvrent les drapeaux de l'armée de Verdun. Au nom de cette armée, je vous remercie. Vous avez bien mérité de la patrie. »
Nivelle oublie le fort de Vaux mais, outre le fort de Douaumont, les Allemands perdent 144 mitrailleuses, 15 canons, comptent 14 000 tués et blessés, 6 000 prisonniers.
Avant l'attaque, l'artillerie française avait déjà gagné la bataille ; le 24 octobre, la IIe armée de Verdun prend sa revanche des journées de février.
Werner Beumelburg écrit : « La large croupe du Douaumont nous cacha désormais la vue du triangle Fleury, ouvrage de Thiaumont, abri à munitions, voie ferrée, bois du Chapitre et bois de la Caillette. Nous ne revîmes jamais ces lieux. »
A coups de pioche dans des sacs de terre
Au soir du 24 octobre, Joffre demande l'exploitation du succès et Mangin consacre ses efforts pour la reprise du fort de Vaux.
Le 25 octobre, Mangin met des unités de la 63e D.I. à la disposition de la 74e D.I. pour attaquer le fort de Vaux. Deux bataillons du 216e R.I., avec le bataillon Derode du 305e R.I. en soutien, partent à 10 heures de la Grande Carrière ainsi que le bataillon Lourdel (333e R.I.), pour encercler et occuper le fort. Les mitrailleuses allemandes, qui sont restées intactes dans les casemates, entrent en action. L'attaque est stoppée, les troupes sont décimées, mais deux compagnies du bataillon Lourdel ne peuvent être rappelées. Seuls deux hommes parviennent sur les superstructures et sont tués aussitôt. Une section du bataillon Derode aborde le fort par l'est, jette des grenades dans les casemates ; le sous-lieutenant Morgana monte sur le fort, ne peut s'y maintenir. Les mitrailleuses allemandes font des ravages : à 11 heures, les unités se terrent dans les trous d'obus. Quelques hommes rentreront à la Grande Carrière, de nuit.
Il faut donc remonter une puissante attaque, comme pour le fort de Douaumont, appuyée par l'artillerie lourde. Le 26, Mangin insère la 63e D.I. entre les 133e et 74e D.I. Le 28, la 22e D.I. relève la 74e D.I., épuisée, et l'artillerie lourde commence sa préparation d'artillerie. Le bilan des pertes est déjà accablant pour les Allemands : 1 500 prisonniers, dont 42 officiers ; 4 canons français de 90 ; 23 lance-mines ; 54 mitrailleuses ; 2 lance-flammes. Jusqu'au 2 novembre, le fort de Vaux reçoit 22 coups de 400, 102 de 370, 4 000 de 75.
Les Allemands, qui n'ont plus la mystique du terrain, se soucient peu de consentir des sacrifices considérables pour la conservation de cette pointe avancée et ne réitéreront pas la faute du 24 octobre. Le 2 novembre à l'aube, des mouvements en arrière du fort traduisent une évacuation partielle. À 15 heures, un radiogramme annonce au monde l'évacuation du fort de Vaux. Méfiant, Andlauer, général commandant la 63e D.I., envoie deux patrouilles en reconnaissance... à 23 heures. La compagnie Diot (293e R.I.) aborde le fort à 1 heure. Le soldat Poulain, très menu, pénètre le premier dans l'ouvrage par un trou de mitrailleuse du coffre sud-ouest. Le lieutenant Labarbe et sa section, après avoir vainement cherché une ouverture, réussissent, à coups de pioche dans des sacs de terre, à entrer par les superstructures du fort et rejoignent Diot. À 2 h 30, donc, le 3 novembre, le fort de Vaux est occupé.
Condamnés à continuer le combat
Pour les Allemands, « le front a été ramené sur une ligne plus favorable, préparée déjà depuis longtemps, moins marquée et moins exposée au feu de l'artillerie ennemie ».
L'abandon du fort de Vaux démontre l'affaiblissement matériel et moral des Allemands, et Mangin écrit : « Cette retraite volontaire, sans attaque de notre part, dénote chez l'ennemi une démoralisation certaine. » Le butin comprend 4 mitrailleuses, 1 million de cartouches, 3 000 boîtes de conserve, 1 000 bouteilles d'eau minérale, de quoi tenir un siège comme le commandant Raynal. La puissance de l'artillerie lourde a vaincu à elle seule la résistance du fort de Vaux.
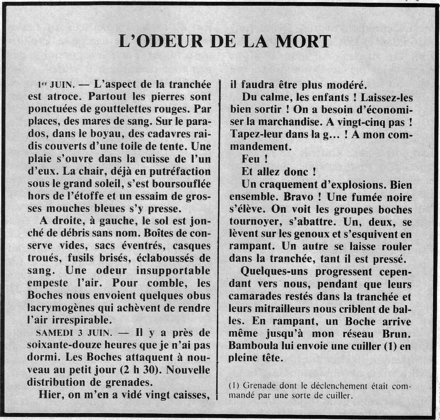 Aucune plaque commémorative ne relate l'événement. Resté vide le jour des Morts le fort de Vaux est officiellement repris dans la nuit du 2 au 3 novembre, sans précision, sans gloire.
Aucune plaque commémorative ne relate l'événement. Resté vide le jour des Morts le fort de Vaux est officiellement repris dans la nuit du 2 au 3 novembre, sans précision, sans gloire.La reprise des forts de Douaumont et de Vaux consacre la défaite allemande à Verdun. Du 21 février au 1er août, les Français ont constamment reculé, subissant des pertes énormes. La bataille de Verdun n'a pas empêché Joffre d'attaquer sur la Somme, le 1er juillet, et l'ouverture de ce front a soulagé peu à peu Verdun. La reprise des forts se produit au moment où les deux batailles s'enlisent. Si Joffre en avait donné plus tôt les moyens à la IIe armée, il eût été possible d'infliger une cuisante défaite à l'Allemagne. Mais Joffre a toujours voulu une bataille de rupture et Verdun ne représentait qu'une bataille défensive, sans victoire décisive.
La reprise des forts pourrait clore la bataille sur un succès mondial, Verdun ayant été sauvé définitivement. L'affaiblissement allemand, des raisons politico-militaires (Joffre tombe en disgrâce, Nivelle et Mangin connaissent la gloire) condamnent le soldat de Verdun à poursuivre les combats. Après Verdun, Nivelle veut « aérer » les forts et repousser le front plus au nord. Déjà, avec Mangin, il pense à la prochaine offensive aux bois d'Hardaumont et d'Haudromont ; le prochain « grignotage » des Allemands aura lieu le 15 décembre.
Le 5 novembre, jour de la reprise des villages de Vaux et de Damloup, Mangin, « le vainqueur de Douaumont », reçoit du président Poincaré la plaque de grand officier. En passant à Belleray, au sud de Verdun, le convoi est reconnu ; des soldats crient : « embusqués », des pierres sont lancées contre les voitures. L'enfer a ses limites, la lassitude du Poilu, ses victoires sans lendemain, ses sentiments diffus s'expriment par la révolte ; les mutineries de 1917 sont en gestation.
A.D.


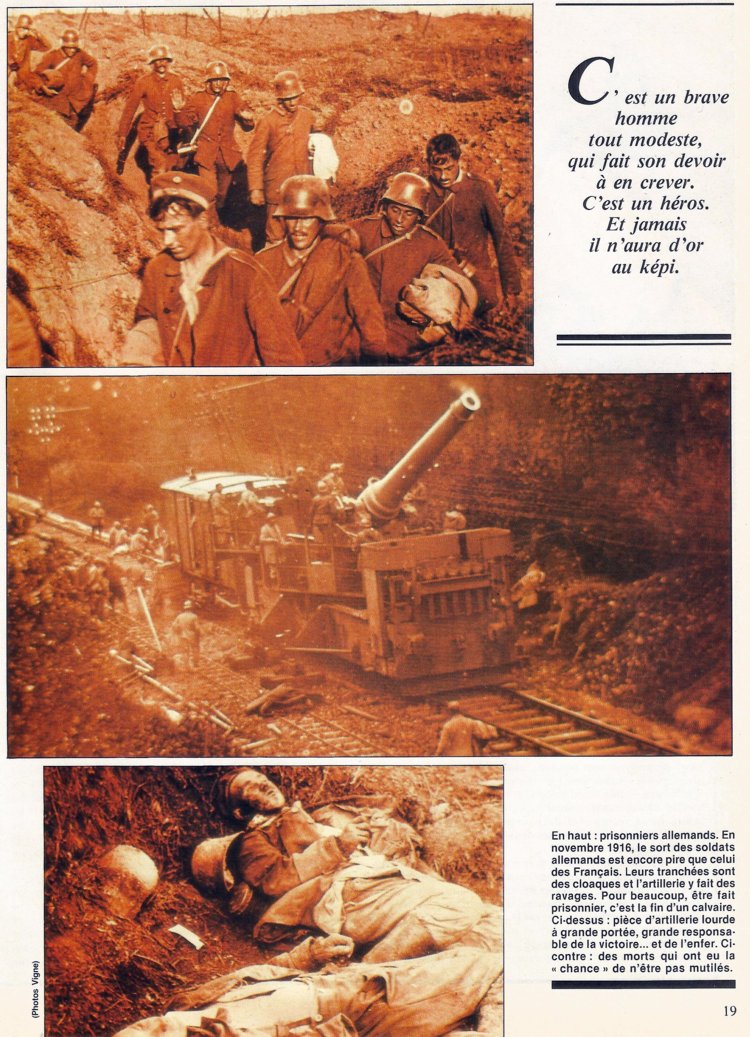


| Haut de page |
CARTES POSTALES DE VERDUN
(Deux albums datant du début des années 1930)
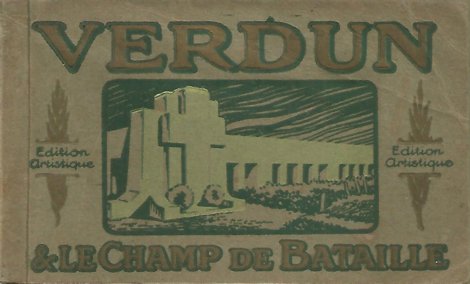 Les cartes doubles avec le diapo ci-dessus ne sont pas reproduites. Les légendes au dos des cartes ont recopiées telles. |
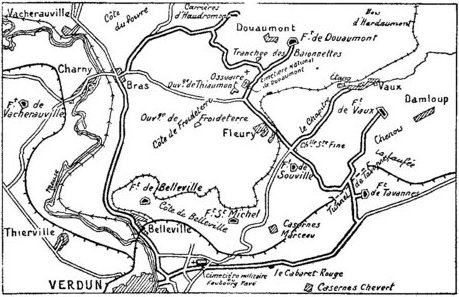 |
 Avenue de la Victoire - Vue prise du Mess. Monument à la Victoire et aux Soldats de VERDUN. Le Chevalier. (Léon CHESNA, architecte ; Jean BOUCHER, sculpteur) |
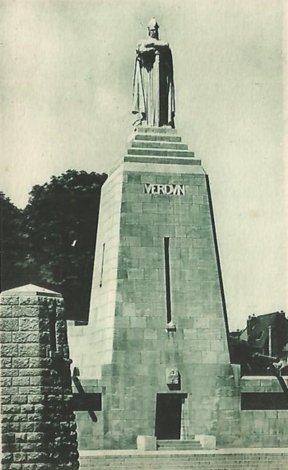 |
 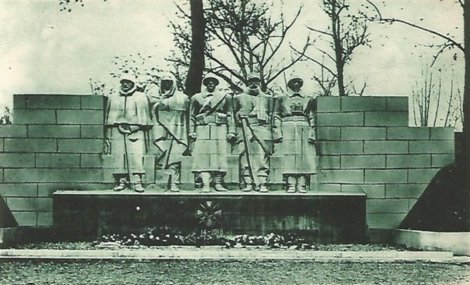 Pont et Porte Chaussée - Monuments aux Enfants de VERDUN morts pour la France. Inauguré le 1er novembre 1928. Œuvre de MM. Forest, archiecte et Grange, sculpteur. |
 La porte Saint-Paul (avec en face) le monument offert par la Hollande). (Œuvre de Rodin) « A la Gloire de la France éternelle, à Verdun, l'Indomptable Cité Lorraine, les fidèles amis de Hollande, qui n'ont jamais désespéré du Triomphe du Droit et de la Justice. » Décembre 1916-Août 1920 |
 |
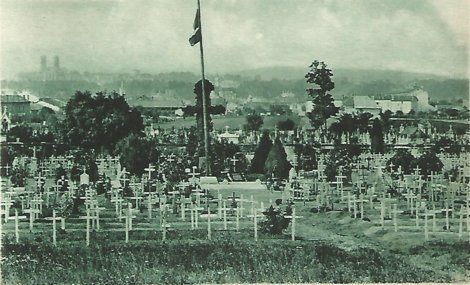 Cimetière Militaire du Faubourg Pavé, le plus important de la région. Au centre la Tombe des Sept Soldats Inconnus. (Le Soldat Inconnu a été désigné au hasard parmi 8 cerceuils) |
 Cimetière National de DOUAUMONT |
 Le Fort de Vaux. Au premier plan, les tombes des soldats qui se sacrifièrent pour ravitailler en eau le Commandant Raynal et ses hommes assiègés en juin 1916. |  Le MORT-HOMME Monument élevé à la Mémoire des Morts de la 40e Division. « Qui que tu sois, Français qui passe, arrête-toi et salue. Laisse un peu de ton cœur à ceux qui sont morts ici pour toi. » |
 MONTFAUCON. L'Eglise. (Le village de Montfaucon, élevé sur une butte, point culminant de la région, fut fortifié et utilisé comme observatoire par les Allemands pendant la Grande Guerre.) |
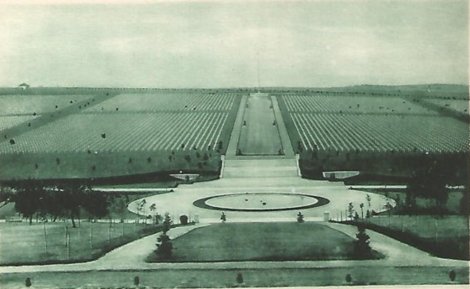 Cimetière Américain MEUSE-ARGONNE. Vue générale (14 095 tombes) |
| | Retour page précédente | |