Rémy d'Alta-Rocca
(1822-1896)
Mme Julie Anne Marguerite Boussard d'Hauteroche, épouse Paquet, dans le Dictionnaire international des écrivains du jour, d'Angelo De Gubermatis, Florence, Louis Niccolai, Editeur-Imprimeur, Via Faenza, 68, 1891.
Rédité par Théophile de Lamathière, Panthéon de la Légion d’Honneur, 1875-1911. (www.data.bnf.fr)
Alta Rocca (Remy d’), pseudonyme d'une femme de lettres française dont nous connaissons le véritable nom sans être autorisé à le dévoiler. Bornons-nous à dire que Mme la douairière de P… est née B…. d’H…. en 1822. On 1ui doit : « Contes et histoires, Les aventures d'un petit cheval, Pierre Desgranges » 1879 ; « Noblesse et bourgeoisie ; Mademoiselle de Roquebrulé ; Suzanne Guillaume » 1881 ; « Bon à rien » 1885 ; « Souvenirs d'une hirondelle » 1885 ; « Dans un vieux logis, suivi de : Le Mariage d’Alix » 1886 ; « Petits garçons et petites filles » 1887.
Ses œuvres : (www.data.bnf.fr)
- Contes et histoires : Les aventures d'un petit cheval, Pierre Desgranges - Jean-Marie et sa petite sœur Jeannette - Le trésor perdu - Réséda charité - La maison de l'étang de joncs - Le jardin d'alice - La Poule qui va plaider.
Édition : Paris : Vve Magnin et fils, Librairie de Louis Janet, 1878, 1879.
264 pages.
- Noblesse et bourgeoisie ; Mademoiselle de Roquebrulé. - Suzanne Guillaume.
Édition : Paris : Didier, 1881.
- Souvenirs d'une hirondelle
Édition : Tours : A. Mame et fils, 1885, 1887.
- Bon à rien
Édition : Tours : A. Mame et fils, 1885, 1887.
- Les gendres de Mme de Lucenay
Comédie en quatre actes en prose
Tiré à part de 108 pages. Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1885.
- Dans un vieux logis ; suivi de : Le Mariage d'Alix
Édition : Tours : A. Mame et fils, 1886, 1888.
- Les Infortunes d'André ; suivi de : Les Trois Chiens de sire Herbert. - et de : Ce qu'il y avait dans une douzaine d'oeufs
Édition : Tours : A. Mame et fils, 1887, 1888, 1891, 1893.
- Avec ma marraine
Édition : Tours : A. Mame et fils, 1888.
- Petits garçons et petites filles
Édition : Tours : A. Mame et fils , 1888, 1889, 1891, 1894.
- Le Collier d'Hélène ; suivi de : Quand on est honnête. Le Beau petit prince. L'Agneau mort
141 p.
- Édition : Tours : A. Mame et fils, 1890, 1891, 1894, 1898.
- Le Manuscrit d'une femme aimable
souvenirs de jeunesse racontés par une vieille dame
Édition : Tours : A. Mame et fils , 1890, 1891 , 1893, 1897.
- Souvenirs d'une hirondelle ; [Petite-Rose]
Édition : Tours : A. Mame et fils, 1890, 1894.
- Mademoiselle de Kergrun
142 pages.
Édition : Tours : A. Mame et fils, 1893, 1895, 1898.
- Le Muguet
72 pages, non daté.
Édition : Tours : A. Mame et fils.

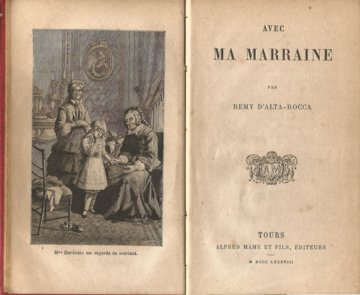
(www.biblisem.net/indexnar.htm) Copie de : par Rémy d’ALTA-ROCCA Après une nuit d’insomnie, ce qui n’est que trop souvent le lot des grand-mères, j’avais quitté mon lit, entrouvert ma fenêtre, et, bien assise dans un moelleux fauteuil, je regardais, ou, pour mieux dire, j’admirais mon jardin tout en aspirant à pleins poumons l’air pur et vif du matin. Les gazons, tondus de la veille, ressemblaient à des tapis de velours ; les massifs de pétunias, de verveines et de géraniums, véritables mosaïques, étalaient leurs masses fleuries ; les arbustes frissonnaient sous la brise ; les pigeons roucoulaient en se pavanant, et sur l’azur foncé du ciel je suivais les capricieuses évolutions de l’hirondelle. En face de moi, le soleil se montrait tout rouge au-dessus de la montagne, présage ordinaire d’une belle journée. En attendant, pour mieux jouir de cette fraîche matinée, j’appuyai ma tête sur un oreiller, je rabattis sur mon front un pan de mon capuchon de dentelle, et je tombai bientôt dans une profonde contemplation. Sous ma fenêtre, une énorme touffe de roseaux s’agitait en frémissant ; les fleurs semblaient se rapprocher et vouloir me confier leurs secrets ; un jasmin de Virginie, dont les rameaux entraient jusque dans ma chambre, laissait tomber à mes pieds ses longs cornets orangés remplis de mille insectes, et sur l’appui de ma fenêtre, sans crainte de ma personne, de jeunes hirondelles faisaient entendre leur vif et joyeux caquetage. Que pouvaient-elles donc se conter ? On dit, mes enfants, que les petites filles sont bavardes : les hirondelles le sont bien davantage, je vous l’affirme, et celles qui gazouillaient près de moi l’étaient certes plus que toutes les autres. Peu à peu, chose bizarre, il me sembla comprendre leur langage ; une voix argentine surtout arrivait clairement à mon oreille. « Grand-mère, disait la petite voix, vous qui tant de fois déjà avez traversé les mers, contez-nous donc vos voyages. – Oui, reprit une voix plus grave (celle de la grand-mère hirondelle, que je reconnus tout de suite à son air posé, qui différait absolument des mines évaporées du reste de la bande), oui, j’ai beaucoup voyagé, mes enfants, et, comme l’a fort bien dit un vieux fabuliste français appelé La Fontaine : Quiconque a beaucoup vu Peut avoir beaucoup retenu (1). « Mais, mes chères petites, j’en ai vu tant et tant, que je ne saurais, en vérité, par où commencer, et c’est presque le récit de toute ma vie qu’il faudrait vous faire. Or ce serait bien long, car je suis très vieille, pour une hirondelle, et peut-être pas bien amusante. – Oh ! grand-mère, contez toujours, s’écrièrent en chœur les petites hirondelles. – Vous le voulez, mes enfants ? – Oui ! oui ! grand-mère. – Vous serez sages alors et ne m’interromprez pas à tout propos ; puis vous resterez tranquilles, si toutefois cela est possible à de jeunes hirondelles. – Nous le jurons ! – Ne jurez pas, mais contentez-vous de promettre : tout serment est téméraire, surtout lorsqu’il s’agit de la tranquillité de petites hirondelles. – Nous le promettons ! – Eh bien, serrez-vous autour de moi et ouvrez vos jeunes oreilles. – Nous y sommes, grand-mère. » La vieille hirondelle recueillit un instant ses souvenirs, puis commença en ces termes : « Je ne saurais exactement vous dire depuis combien d’étés et d’hivers mes ailes effleurent la terre et les eaux : laissons donc de côté la date de ma naissance et prenons les choses du plus loin qu’il m’en souvienne. « J’avais environ huit à dix jours d’existence : un léger duvet garnissait mon petit corps, mes yeux commençaient à voir, et à un certain bruissement d’ailes, que je reconnaissais de fort loin, j’ouvrais un large bec pour recevoir la part de nourriture que m’octroyaient généreusement mes parents. Nous étions huit frères et sœurs, serrés en tas dans le même nid, ce qui nous procurait une douce chaleur. Notre nid, bâti contre une fenêtre de forme ogivale ombragée de vigne vierge, était adossé en angle moitié à la muraille, moitié à la persienne, fermée pour le moment ; ce qui est une grande imprudence, mes chers enfants, ne l’oubliez jamais : imprudence qui faillit nous coûter la vie. Mais nos parents n’en étaient qu’à leur première nichée, et l’expérience ne s’acquiert qu’avec l’âge et la pratique. « Notre fenêtre natale, qui était celle d’une tourelle faisant partie d’un grand et beau château, le château des Étangs, s’ouvrait sur un parc magnifique, aux allées majestueuses, aux ombrages touffus. Un parterre à l’ancienne mode française, avec ses compartiments bordés de buis, ses charmilles à portiques, ses ifs taillés en boules, son bassin rocailleux au milieu duquel un triton bouffi lançait une gerbe d’eau, ses vases et ses statues, s’étendait devant le château, véritable habitation princière. Dans le lointain, faisant perspective, on apercevait deux étangs immenses, bordés de roseaux et d’iris à fleurs jaunes sur lesquels, du matin au soir, les hirondelles du canton se donnaient rendez-vous ; et déjà, dans ma petite cervelle d’oiseau, je me réjouissais à la pensée d’en effleurer les eaux paisibles. « Une seule chose me surprenait : pourquoi ce beau château était-il inhabité ? Les portes en demeuraient closes, et, dans le parc, nul autre que le jardinier et ses aides. J’ignorais alors que les gens riches viennent tard à la campagne. Cependant un beau matin, des équipages entrèrent, avec fracas dans la cour d’honneur : c’étaient les maîtres du château qui arrivaient inopinément. En un instant, tout fut en rumeur dans cette maison, si calme d’ordinaire. Des laquais circulaient dans les vestibules, ouvrant bruyamment les portes et les fenêtres ; des hommes de peine montaient de lourdes malles ; les enfants s’appelaient d’une chambre à l’autre ; les chevaux hennissaient dans les écuries ; les chiens de chasse aboyaient du fond de leur chenil ; en un mot, tout s’éveillait. « Dans mon nid douillet, je voyais parfaitement ce qui se passait dans la chambre qu’éclairait notre fenêtre, et je me demandais avec curiosité qui allait habiter ce réduit coquet, lorsque tout à coup un homme qui venait d’y poser une caisse s’arrêta justement devant la susdite fenêtre. Sa grosse main en fit sauter l’espagnolette, puis ébranla la persienne... Horreur, mes enfants ; une seconde de plus, et nous étions broyées !... Père, mère, frères, sœurs, à l’unisson, nous poussâmes un cri de détresse, et à ce cri un autre cri répondit, poussé par une fillette de douze à treize ans : « – Arrêtez ! Arrêtez ! s’écria-telle, il y a un nid d’hirondelles... » Et une petite main, délicate et blanche, se posa sur la grosse main rouge. « – Mais, mam’selle, on n’y verra pas clair, dit l’homme à la grosse main. « – Eh bien, je me passerai d’y voir, répliqua la fillette ; mais je ne veux pas qu’on touche à mes hirondelles. » « De nouveau la petite main s’avança, et de ses doigts mignons recolla contre la muraille un coin de notre pauvre nid prêt à s’en détacher. Alors, à travers les lames de la persienne, je pus voir notre jeune protectrice. Elle était jolie à croquer : ses cheveux blonds, retenus par un ruban bleu, frisaient autour de son front ; ses yeux, couleur de pervenche, regardaient dans notre nid, et ces yeux-là étaient si doux, que je sentis instinctivement que nous avions une amie dévouée. « – Oh ! mes pauvres petites ! mes pauvres petites ! un peu plus on vous aurait écrasées !... Je frémis quand j’y pense. » « En effet, un léger frisson agita les épaules de la fillette. « – N’ayez plus peur, ajouta-t-elle, semblant deviner notre émoi, je suis là pour vous protéger. Maman, dit-elle à une belle dame qui venait d’entrer, voyez donc : un nid d’hirondelles à ma fenêtre, et tout rempli de jolis petits. » « La mère se pencha et nous regarda d’un air de bonté. « – Je vous en prie, maman, recommandez aussi qu’on ne leur fasse pas de mal ; deux recommandations valent mieux qu’une. Pierre, tout à l’heure, a failli les écraser en ouvrant la fenêtre. Mais il faut que je montre ce nid à papa », dit la petite. « Elle sortit en courant, et revint bientôt suivie d’un monsieur dont la figure et les manières me plurent infiniment. « – Papa, regardez comme elles sont jolies ! « – Très jolies, dit le père, qui avait l’habitude d’être toujours de l’avis de sa fille (je vis cela par la suite), très jolies !... Ce nid sera peut-être bien un peu gênant à cause du jour, mais on peut supporter une gêne de si courte durée ; tes petites protégées ne tarderont pas à prendre leur vol. Si tu m’en crois, mignonne, pour plus de sûreté, nous allons consigner la persienne : un malheur est si vite arrivé. » « C’était aussi mon avis, et j’avoue que je ne me sentis complètement rassurée qu’après avoir vu, de mes deux yeux vu, la poignée de la susdite fenêtre bien attachée avec une bonne ficelle. La fillette renchérit encore de prudence en faisant de gros nœuds par-dessus les nœuds paternels ; tranquille alors, elle quitta l’appartement, et bientôt je la vis courir dans le jardin avec ses frères, trois jeunes gaillards bien découplés. Je me réjouis, à part moi, d’avoir pour voisine et protectrice une aussi charmante créature que la petite Laure ; c’est ainsi que se nommait notre nouvelle amie, et ce nom me parut le plus joli du monde. « Le soir, après avoir fait sa prière, la gentille Laure s’étendit sur sa couchette blanche et bleue ; son père et sa mère vinrent l’embrasser et lui souhaiter une bonne nuit, et, je dois le dire, elle et nous nous dormîmes tout d’un somme. Mais les hirondelles ouvrent les yeux avec le jour, et notre bruyant caquetage ne tarda pas à éveiller notre jeune voisine. Elle sauta à bas de son lit, et, sans prendre le temps de chausser ses pieds mignons et de passer un peignoir, elle se précipita de notre côté, entrouvrit la fenêtre, et se penchant vers nous : « – Bonjour, petites hirondelles ; nous sommes amies, n’est-ce pas, et vous me porterez bonheur ? » dit-elle en souriant. « Passant alors un doigt à travers les lames de la persienne, elle commença à nous lutiner, et s’enhardit jusqu’à toucher le bout de nos petits becs jaunes, que nous ouvrîmes si démesurément, qu’elle se mit à rire aux éclats. Elle s’habilla ensuite à la hâte et s’amusa pendant un certain temps à suivre les évolutions de nos bons parents, qui, voyant bien qu’ils n’avaient rien à craindre, continuaient à pourvoir à notre nourriture : grande affaire pour des hirondelles, qui consomment par jour des milliers de moucherons. Enfin notre jeune hôtesse alla déjeuner aussi, ce qu’elle fit, j’en suis sûre, d’aussi bon appétit que nous. « Tout se régularisa bientôt dans le château, et les journées de la fillette furent divisées heure par heure. « Il y eut des heures fixes pour le lever, la toilette, l’étude, le piano, la lecture, la promenade, sans compter les heures de récréation, car on ne peut toujours travailler. Les leçons se prenaient dans la chambre bleue, et nous avions plaisir à constater l’application de notre charmante protectrice. « Cependant, au bout de quelques jours, le duvet qui couvrait nos petits corps rougeauds se changea en plumes soyeuses, nos moignons informes devinrent de longues ailes, et un beau matin, après quelques essais, nous primes notre essor vers les étangs, où des centaines d’hirondelles volaient en se poursuivant. Nos parents nous présentèrent à la ronde, et la connaissance fut bientôt faite. « Sur ces beaux étangs, tout bordés de plantes aquatiques, il y avait plusieurs barques dans lesquelles Laure et ses trois frères aimaient beaucoup à se promener. Je frémis d’abord à la pensée que ces légères embarcations pouvaient chavirer, et que notre petite amie et ses frères couraient grand risque de se noyer ; mais je me rassurai bien vite en découvrant que les quatre enfants nageaient comme des poissons. « Le baron et la baronne d’Olgicourt, tel était le nom du père et de la mère de Laure, aimaient beaucoup le monde ; aussi était-ce chaque jour fêtes nouvelles au château : parties de pêche et de chasse, de chasse surtout, le baron étant fanatique de ce plaisir, dîners, soirées, feux d’artifice, concerts !... « À ce sujet même je remarquai combien les hirondelles sont sympathiques à l’espèce humaine, car rarement un concert se passait sans que l’on chantât au moins un morceau en notre honneur. Un soir, notamment, je fus particulièrement charmée en nous entendant appeler « oiseaux bénis de Dieu » dans le joli duo des hirondelles de Mignon (opéra composé par un grand musicien qui se nomme Ambroise Thomas) ; Béranger, un poète national, nous a également célébrées, sans compter bien d’autres encore. N’oublions pas les mélodies italiennes, parmi lesquelles la Rondinella pellegrina avait mes préférences. Vous saurez, mes chères petites, que, destinées à habiter tous les pays, nous comprenons tontes les langues. « L’été se passa de la façon la plus charmante ; les fêtes se succédaient sans interruption, et vers la fin d’août, au moment où la chasse allait commencer, il ne restait plus au château un seul petit coin qui ne fût habité. « Tous ces nouveaux hôtes, dont la plupart étaient chasseurs, venaient tirer sur les étangs des oiseaux aquatiques. J’eus d’abord une peur horrible ; mais je m’aperçus bien vite que, toujours par suite de l’entente cordiale qui règne entre l’homme et l’hirondelle, on ne tirait jamais sur nous. J’aurais préféré sans doute que les chasseurs ne tuassent pas les beaux canards qui venaient se poser sur nos étangs ; mais avais-je bien le droit de leur en vouloir, qui me nourrissais exclusivement d’insectes ? Non !... d’où je conclus qu’il y a dans la nature certaines lois immuables qu’il faut accepter et non discuter. « Cependant les matinées devenaient froides, les soirées brumeuses, les insectes diminuaient : allions-nous donc mourir de froid et de faim ? « – Rassurez-vous, mes chères petites, dirent nos parents, le moment approche où nous allons partir pour le pays du soleil, pour les terres chaudes où l’on ne connaît pas l’hiver : ici nous péririons infailliblement. » « Mon cœur battit fort à cette annonce de départ ; mais l’amour des voyages, instinctif chez l’hirondelle, l’emporta sur mon regret de quitter le pays natal. « Bientôt, en effet, passèrent par bandes des nuées d’hirondelles, celles sans doute qui avaient séjourné dans les pays du Nord et que les précoces frimas de ces régions glaciales chassaient plus vite ; puis notre tour arriva aussi. Toutes les hirondelles du canton se groupèrent sur un seul point, et les plus anciennes, celles qui, comme moi, avaient plusieurs fois traversé les mers, tinrent conseil entre elles. « Pendant ce temps, je me reposai le plus possible sur la fenêtre natale, ne voulant pas perdre un seul des instants qui me restaient encore à passer dans le voisinage de ma petite amie Laure. « – Maman, dit-elle un jour à Mme d’Olgicourt, assise dans la chambre bleue, il me semble que les hirondelles se préparent au départ, et j’en suis toute triste. Croyez-vous que ce soient les mêmes qui nous reviendront l’an prochain ? « – Je le crois, répliqua la mère ; malheureusement beaucoup d’entre elles périront pendant la traversée. « À cette pensée que j’étais peut-être destinée à tomber dans la mer et que je ne reverrais plus la gentille Laure, mon cœur se serra, et je fus tentée de maudire les voyages ; mais, je le sentais bien, nous n’étions pas libres de choisir. « – Mère chérie, reprit après un moment de silence la petite Laure, je voudrais pouvoir reconnaître mes hirondelles, et pour cela aidez-moi, je vous en prie, à mettre un ruban rose à la patte de celle qui se trouve en ce moment sur ma fenêtre. Je l’aime particulièrement ; elle revient fidèlement se percher chaque jour à la même place, et je suis sûre qu’elle se laissera prendre sans difficulté. » « La fillette, en disant ces mots, avança la main, et je me laissai prendre, au risque de voir attacher à ma pauvre petite patte le ruban en question. « – Oh ! Maman, voyez comme elle et jolie ! dit Laure en m’embrassant de tout son cœur ; que ses yeux sont veloutés et expressifs, son plumage doux et sa poitrine soyeuse et blanche ! et je sens son petit cœur frémir dans ma main. « – Eh bien, mon enfant, reprit la mère, si tu aimes véritablement cette gentille hirondelle, crois-moi, ne mets à sa patte ni ruban rose ni ruban bleu ; ce ruban, si mince que tu le choisisses, pourrait la blesser, embarrasser son vol, et tu serais cause de sa mort. Embrasse-la encore une fois, et souhaite-lui bon voyage. » « La fillette, écoutant ce bon conseil, me serra à plusieurs reprises sur son cœur et sur ses lèvres : j’en sentis la douce chaleur ; elle me présenta ensuite aux lèvres de sa mère, puis, me posant délicatement sur l’appui de la fenêtre : « Adieu ! fit-elle, adieu ! petite hirondelle ; n’oublie pas ton amie Laure, et reviens l’an prochain nicher à la fenêtre de sa tourelle !... » Un instant étourdie par les caresses de ma jeune amie, je demeurai immobile ; mais bientôt j’entendis la voix de mes sœurs qui m’appelaient, et je les rejoignis d’un coup d’aile, non sans avoir jeté un dernier regard sur ma protectrice du château des Étangs. « Le lendemain nous étions en route, et le surlendemain nous arrivions au bord de la mer, de cette mer redoutable qu’il nous fallait traverser pour gagner les côtes d’Afrique, où nous devions passer la saison d’hiver. « C’est un bien beau spectacle que celui de la mer, mes chères petites ; bientôt vous en jugerez par vous-mêmes ; mais on y court parfois de terribles dangers. « Plusieurs parmi nous étant faibles encore, il fut décidé, en grand conseil des anciennes, que notre bande resterait quelques jours sur les plages de la Méditerranée avant de risquer la traversée. « – Il ne faut rien laisser au hasard, dirent nos anciennes, que les fatiguées se reposent, que les faibles se fortifient, et que chacune fasse provision de courage. » « Nous errâmes pendant une semaine environ sur ces belles plages où j’aurais voulu rester toujours, tant le pays me semblait ravissant. Des cités coquettes s’étendaient comme à plaisir sur ces rives enchantées ; les châteaux, les villas, les chalets, s’étageaient sur la pente des montagnes, et jamais rien d’aussi gracieusement beau n’avait frappé ma vue. Hirondelles humaines, des étrangers arrivaient de toutes les contrées du monde afin de passer l’hiver sous ce beau ciel ; mais pour nous, il paraît qu’il fallait aller plus loin encore. « – Surtout, mes petites, nous dit un soir la doyenne de la bande durant l’assemblée qui précéda le départ, que les plus délicates d’entre vous restent bien au centre de la colonne, qu’elles ne s’aventurent jamais sur les flancs : tout coup de vent leur serait mortel. » « Le lendemain, à la pointe du jour, la colonne s’ébranla décrivant un triangle, les fortes en avant et en arrière, les moyennes en flanc, et les plus jeunes au centre... Nous eûmes bientôt perdu de vue les côtes de notre chère France, et à ce moment je ne pus m’empêcher de donner un regret à mon pays d’abord, puis à ma jeune amie du château des Étangs. Mais le bonheur de me sentir emportée dans les airs au-dessus de cette belle mer domina bientôt tout autre sentiment. « La journée se passa sans incidents remarquables ; le temps était superbe, et pas une de nous ne périt. Déjà nous apercevions les côtes de Sicile, où nous devions descendre à la nuit, lorsqu’un tout petit nuage, semblable à une légère vapeur, se montra à l’horizon. À cette vue, je remarquai de l’inquiétude dans les yeux de ma mère, qui nous avait groupés autour d’elle. « – Hâtons-nous ! hâtons-nous ! tel fut le cri qui retentit bientôt parmi les anciennes.... Hâtons-nous ! voici l’orage. « – L’orage ? où donc voyez-vous de l’orage ? demanda une de mes voisines à une vieille hirondelle qui se tenait sur l’un des flancs de la colonne ; le ciel est bleu, le soleil resplendissant, la mer unie comme un miroir, et là-bas j’aperçois les côtes de Sicile. Encore quelques coups d’aile et nous allons arriver. « – Dieu le veuille ! » répondit la vieille hirondelle. « Cependant le petit nuage floconneux grossissait à vue d’œil ; l’air, jusque-là si calme, commençait à s’agiter ; la mer se soulevait avec effort, et l’on entendait au-dessus des vagues comme un sourd grondement. « – Hâtions-nous ! hâtons-nous ! s’écrièrent de nouveau nos chefs de file ; mais presque subitement le vent s’éleva furieux ; nous n’avancions plus qu’avec peine, et bientôt, malgré nos efforts, nous n’avançâmes plus du tout. « – Halte, firent les anciennes dont la voix avait de la peine à se faire entendre ; halte ! serrez les rangs, et n’essayons plus de lutter contre le vent, il serait plus fort que nous... Attention, et volte-face sans se débander ! » s’écria la doyenne. « La manœuvre s’exécuta immédiatement, et en quelques instants, chassées par le tempête, nous fûmes repoussées en pleine mer avec une rapidité vertigineuse. « Oh ! mes chères petites, quelle nuit !... Les ténèbres nous enveloppaient de toutes parts, les vents étaient déchaînés ; nos pauvres ailes, raidies par la fatigue, ne nous soutenaient plus qu’avec peine, et à chaque instant des quantités de nos compagnes tombaient à la mer, dans cette mer devenue toute noire. « – Serrez les rangs ! » criaient alors les anciennes. « Ce cri lugubre retentit longtemps à mes oreilles, et sans nos bons parents, qui se multipliaient pour nous soutenir, nous serions, mes sœurs et moi, mille fois tombées dans l’abîme. Mais, hélas, il arriva un moment où la lutte devint impossible : c’en était fait, il fallait mourir !... Même parmi les anciennes et les fortes, beaucoup succombaient, et nous nous sentions perdues, lorsque soudain la doyenne poussa un cri de joie. « – Courage, enfants, courage ! un vaisseau se montre à l’horizon, nous sommes sauvées ! » « Effectivement, entre deux éclairs, nous aperçûmes un vaisseau fuyant comme nous devant la tempête. Cette vue nous rendit quelque espérance ; par un effort suprême nous parvînmes à l’atteindre, et en moins d’une minute notre bande s’abattit sur lui, couvrant presque entièrement les mâts, les voiles, le pont et les cordages. « – Hurrah pour les hirondelles ! » crièrent les matelots avec joie ; car nous sommes regardées par eux comme un oiseau d’heureux présage. Ces braves gens s’amusèrent à nous contempler, à nous prendre, à nous caresser, et nous nous laissions faire sans crainte ; jamais, nous le savions, un matelot ne se permettant de tuer une hirondelle. « Pour nous laisser plus d’espace, le commandant du navire, M. Henri P***, excellent et brave marin, nous fit ouvrir à deux battants les portes de son appartement et de sa galerie ; sur son ordre, on posa partout des bassins remplis d’eau douce afin que nous pussions nous désaltérer, et chacun s’efforça de ne pas nous écraser en manœuvrant. Notre fatigue et notre raideur étaient arrivées à un tel degré, que là où nous tombions, nous demeurions dans un état de complète inertie, et la nuit entière s’acheva ainsi. Au jour seulement cette paralysie cessa, et nous recouvrâmes l’usage de nos ailes. Ce fut alors parmi nous un joyeux tumulte et des cris d’allégresse. Mais, hélas ! cette joie fut promptement modérée par les regrets ; on se cherchait, on se comptait, et beaucoup manquaient à l’appel. « J’étais allée, avec quelques-unes de mes compagnes, me poser sur le balcon du commandant, que notre joyeux caquetage semblait amuser singulièrement, car il prenait plaisir à nous contempler. J’étais la plus proche. Tout à coup il avança la main, me saisit et baisant le dessus de ma petite tête noire : « Gentille hirondelle, dit-il, si jamais tes ailes te portent dans les Ardennes, salut à ma mère, à mon père, à mes frères, à mes sœurs, salut à mon pays !... » En finissant ces mots, il ouvrit la main, et je rejoignis mes compagnes, qui commençaient à se rassembler. « Le temps était redevenu magnifique ; la doyenne donna le signal du départ, et nous prîmes, en tournoyant, congé du navire hospitalier (2). Quelques heures plus tard, nous descendions sur la terre d’Afrique, à une quinzaine de lieues environ de la ville de Constantine. « Ce pays, véritablement magnifique, fourmillait d’insectes de tous genres, et nous y trouvions sans peine une abondante nourriture ; aussi ne tardâmes-nous pas à oublier les fatigues du voyage. Pour moi, cependant, le chagrin d’avoir quitté la France était tellement vif, que je ne pouvais m’habituer à mon nouveau séjour ; je regrettais le château des Étangs et surtout ma charmante petite Laure. Il y avait pourtant de délicieuses oasis dans le coin d’Afrique où nous étions venues hiverner, et de jolis villages dans la montagne ; mais les habitants m’en paraissaient barbares, et malgré les jardins plantés de palmiers, d’orangers, de citronniers et de lauriers-roses, malgré la vue des jeunes filles qui venaient à la nuit prendre le frais dans ces jardins et puiser de l’eau, je ne pouvais oublier ma chère patrie. « Souvent aussi, dans nos excursions à travers le pays, nous apercevions des campements arabes. Les femmes vaquaient aux soins du ménage, ou bien, assises devant les tentes, préparaient le couscoussou, tandis que les hommes s’occupaient de leurs chevaux, qu’ils aiment passionnément. Les enfants, à moitié nus, se roulaient un peu partout, et les chameaux, accroupis sur le sable, semblaient avec leurs grands yeux somnolents et vagues continuer un rêve commencé dans le désert. « La nuit, de nos abris respectifs, nous entendions l’aboiement des chiens chargés de garder le campement et le cri discordant du chacal en quête d’une proie. Souvent des rôdeurs, – ce pays en est rempli, – cherchaient à s’introduire dans le camp pour y dérober des chevaux ou du bétail, mais généralement Arabes et chiens faisaient bonne garde. Parfois aussi, dans nos courses vagabondes, il nous avait été donner de rencontrer le lion, ce roi du désert, et je vous assure, mes chères petites, qu’à son aspect, je me félicitais singulièrement d’avoir des ailes. Un matin, j’en vis un qui poursuivait une gazelle, et jamais je n’oublierai le moment où la pauvrette, affolée, tomba sous la griffe de son redoutable ennemi. « Tout cela était sans doute fort beau, fort imposant ; mais rien ne valait pour moi le château des Étangs et les concerts où l’on célébrait si bien nos louanges. « Un jour, jour que je n’oublierai jamais, j’aperçus vers la lisière d’une forêt de chênes-lièges une petite troupe d’hommes à cheval suivie de grands lévriers, et, à ma grande joie, je reconnus que ces hommes étaient des Français, et très certainement des chasseurs. Mon cœur battit à cette vue, et plus fort encore lorsque je découvris au milieu d’eux le père de mon amie Laure ! Connaissant la passion du baron pour la chasse, je ne fus nullement surprise qu’il eût traversé la mer pour venir dans un pays où tout gibier abonde, et je me souviens même qu’il n’en était pas à son premier voyage. Comme vous le pensez, je me mis à suivre la chasse, ne perdant rien de ce curieux et intéressant spectacle. Les chiens couraient, les hommes galopaient, la poudre parlait, le gibier s’entassait dans les grands paniers portés par un mulet, et je vous affirme que nos chasseurs n’auraient, pour le moment, changé leur sort contre aucun autre. Le baron d’Olgicourt, qui paraissait avoir pris la direction de la petite troupe, conduisait son monde avec un entrain merveilleux ; et ses compagnons le suivaient avec confiance, sachant que plusieurs fois déjà il avait chassé dans la province de Constantine. « Mais moi, en hirondelle prudente et sage, je trouvai que mes chers compatriotes se laissaient emporter au delà des limites voulues par la prudence, et je tremblais pour les téméraires, sachant que les bandes de pillards kabyles, dépouillant indistinctement Arabes, juifs ou chrétiens, infestaient le pays. « Vers midi, la chaleur devenant gênante, nos chasseurs mirent pied à terre à l’entrée de la forêt de chênes-lièges ; on dessella les chevaux, et la bande joyeuse procéda au déjeuner, non sans avoir poussé une reconnaissance aux environs. « – Messieurs, dit le baron ; conservons nos armes à portée de la main, et, tout en déjeunant, ayons l’œil au guet ; car dans cet endiablé pays tout buisson peut cacher un ennemi. « Le déjeuner, bruyant et gai, s’acheva sans encombre, et nos chasseurs, après avoir désigné deux d’entre eux pour faire sentinelle, s’étendirent sur l’herbe épaisse afin d’y prendre quelques heures de repos, et ne tardèrent pas à s’endormir. Mais, juste à cet instant, des cris féroces retentirent, et en une seconde les chasseurs se virent entourés par une horde de bandits kabyles. Cela fut fait si rapidement, qu’ils n’eurent même pas le temps de saisir leurs armes. Trois ou quatre de ces bandits, le coutelas au poing, hurlant et vociférant, tenaient en échec chacun des chasseurs. Toute résistance devenait donc inutile et même nuisible ; le baron le comprit immédiatement et engagea ses compagnons à rester calmes. « – La lutte est impossible, dit-il, tâchons de parlementer et de nous en tirer au moyen d’une rançon. » « Connaissant un peu la langue arabe, il essaya d’entrer en pourparlers avec les bandits ; mais ceux-ci ne voulurent d’abord rien entendre. En même temps qu’ils s’étaient rués sur les armes, ils avaient fait main basse sur les provisions, et, peu soucieux des lois de Mahomet, se livraient déjà à de copieuses libations ; aussi dut-on, pendant la première heure, les laisser à la satisfaction de leurs appétits gloutons. Il fallait voir ces enragés éventrer les pâtés, et à pleines mains en tirer la viande, qu’ils avalaient aussi facilement que nous gobons un moucheron. Ils dévorèrent successivement jambons, filets et poulets, et auraient continué jusqu’à épuisement des victuailles si celui qui semblait être à leur tête, jugeant imprudent sans doute de laisser ce ramassis de bandits se gorger de nourriture et surtout de vins capiteux, n’eût menacé de mort quiconque ne cesserait à l’instant. Il remit dans la bande un ordre relatif, et pâtés, jambons et bouteilles, ou du moins ce qui en restait, rentra dans les paniers. On procéda alors au pillage régulier de mes compatriotes, et je vous assure, mes petites, que la cérémonie ne fut pas longue. En quelques instants, montres, bagues, cachets et breloques disparurent comme par enchantement, et ce fut à grand-peine que le père de Laure parvint à garder son lorgnon et son calepin. Cependant, au bout d’un certain temps, le baron étant parvenu à faire comprendre au chef qu’il avait affaire à des personnages de distinction, riches par conséquent, celui-ci expliqua à ses compagnons qu’il lui paraissait plus avantageux de tirer une rançon des prisonniers que de les massacrer sans autre profit qu’une poignée de bijoux et quelques fusils. « Si la rançon n’arrive pas, ajouta-t-il, nous serons toujours à même de nous débarrasser de ces chiens-là. » « – Qui gagne du temps gagne toujours quelque chose, murmura le baron à ses amis ; peut-être parviendrons-nous à prendre la fuite. » « Les bandits se concertèrent de nouveau, et, après une discussion assez orageuse, le chef intima au baron l’ordre d’écrire une lettre tant en son nom qu’en celui de ses compagnons. Une fois la missive écrite, chacun la signa, et le meilleur cavalier de la bande fut chargé de la porter à Constantine. Là nos bandits ne manquaient ni de complices, ni de ressources pour se faire payer la rançon demandée sans se compromettre. Trois jours étaient accordés aux prisonniers. Après ce délai, ils périraient. « Pendant ce temps, je volais au-dessus d’eux, espérant me faire remarquer, et je finis par me poser si près du baron, qu’enfin il fixa les yeux sur moi. Ma vue sans doute éveilla chez lui le souvenir de sa fille, car un profond soupir s’exhala de sa poitrine, et une muance d’émotion se peignit sur son mâle visage. « – Vraiment, messieurs, dit-il à ses compagnons, il faut avouer que nous sommes de grands fous, moi surtout, qui n’ai cessé de vous pousser en avant, et ne puis alléguer comme vous l’excuse de la jeunesse et de la liberté. Jamais je ne me pardonnerai le danger que vous courez par ma faute, si toutefois nous y échappons et que j’aie le loisir du remords ! Que ne donnerais-je pas pour que ce danger ne menaçât que moi seul !... Je m’attendris, et cela vous étonne ? La faute en est à cette hirondelle, fit-il en étendant la main vers moi ; elle me rappelle ma famille, ma maison, et surtout ma fille. L’été dernier, des hirondelles nichaient à sa fenêtre, la chère enfant les protégeait, et l’une d’elles s’était même apprivoisée au point de se laisser prendre. « – Et qui vous dit que ce ne soit pas celle-ci ? répliqua l’un des chasseurs ; voyez comme elle vous regarde : on dirait presque qu’elle vous écoute et vous comprend. » « À ces paroles, mon cœur battit bien fort, et je m’envolai, mais pour venir me poser plus près encore du père de Laure. Étonné de cette persistance, il me prit, et à plusieurs reprises baisa ma petite tête noire, en souvenir probablement de sa fille et du château des Étangs ; puis tout à coup il tressaillit et parut réfléchir. « – Messieurs, reprit-il en me caressant, qui nous dit que cette hirondelle n’est point une messagère envoyée par la Providence ? Si chétive que paraisse cette chance de salut, voulez-vous que nous en essayions ? On a vu des colombes porter des messages ; pourquoi n’en confierions-nous pas un à cette hirondelle ? Qui sait ? peut-être rencontrera-t-elle des libérateurs. « – L’idée a du bon et me plaît, répondit le chasseur qui m’avait déjà remarquée ; d’ailleurs, au point où nous en sommes, il ne faut rien négliger. Va donc pour un message par hirondelle, ne fût-ce que pour l’originalité de la chose. » « Après s’être concerté avec ses compagnons, le baron tira de sa poche le portefeuille qu’il était parvenu à garder, en détacha un carré de papier, et, caché par un ami, y traça les mots suivants : « Au général R***, à Constantine. 15 février, 2 heures. Entrée sud de la forêt de chênes-lièges, – prisonniers ! Au secours !... » « Baron d’OLGICOURT. » « Le général R*** était l’ami intime du baron ; je me rappelai même l’avoir vu au château, où plus d’une fois il avait reproché au maître de la maison son imprudence lorsqu’il chassait en Afrique, lui prédisant que, tôt ou tard, il lui arriverait malheur. La prédiction ne s’était, hélas ! que trop réalisée. « Le papier écrit, l’un des chasseurs parvint à couper avec ses dents un morceau du cordon qui soutenait le lorgnon du baron, il y fixa solidement le petit carré, et ce collier improvisé fut passé autour de mon cou. « Toutes ces choses s’étaient accomplies lentement et difficilement, à cause des bandits ; mais enfin on y était parvenu. « – Messieurs, dit le baron, un dernier baiser à notre gentille messagère, et à la grâce de Dieu !... » Il me baisa de nouveau, et je partis... « Je m’enlevai d’abord à une grande hauteur, puis je m’orientai, et de mon vol le plus rapide je me dirigeai vers Constantine. « Qu’est-ce qu’une dizaine de lieues pour une hirondelle ? Peu de chose ; aussi en moins d’une heure planais-je au-dessus de la ville. Après en avoir pris connaissance, je vis promptement ce que j’avais à faire et vins me percher sur les branches d’un laurier-rose, au beau milieu de la cour d’une maison qui me parut être un café, et dans laquelle plusieurs officiers prenaient des sorbets tout en lisant les journaux. « Je ne fus pas immédiatement remarquée ; ce que voyant, je me mis à voler çà et là, me posant de côté et d’autre afin d’attirer l’attention dont j’avais besoin. Cette manœuvre réussit à merveille. « – Voyez donc, messieurs, dit un jeune sous-lieutenant, voyez donc cette hirondelle qui porte un papier au cou. « – C’est pardieu vrai, répondit un camarade, et même un assez volumineux papier. Qu’est-ce que cela peut être ? Sans doute quelque gaminerie d’enfant. « – En tout cas, reprit le sous-lieutenant, il faudrait tâcher de l’en débarrasser ; à la longue, ce papier et ce cordon entraveront son vol et deviendront une cause de mort. « – Essaye alors de lui mettre un grain de sel sur la queue », dit en riant un autre camarade, se servant d’une plaisanterie populaire usitée en France lorsqu’un enfant parle d’attraper un oiseau. « Mais le sous-lieutenant, sans répondre à la plaisanterie, s’approcha de moi, et délicatement me saisit. C’était assurément un garçon fort bien élevé que ce jeune officier, et, soit dit en passant, mes petites, nous autres hirondelles de maison, nous nous connaissons en éducation. Je n’avais eu garde de bouger ; le jeune homme put donc me prendre tout à son aise, au grand étonnement des autres officiers, qui s’approchèrent curieusement. Je les regardais effarée, car pour une hirondelle, se sentir emprisonnée dans une main inconnue, voire même une main que l’on suppose amie, est toujours une effrayante chose ; mais je pensai à mon amie Laure, et je dominai mon effroi. « Un des officiers enleva délicatement le collier qui entourait mon cou, déplia le papier et lut son contenu... Impossible de vous peindre la stupéfaction des auditeurs. « – Il faut parler immédiatement au général R***, dit le sous-lieutenant, qui me tenait toujours dans sa main ; cette dépêche d’un nouveau genre n’est peut-être qu’une plaisanterie ; mais à lui seul il convient d’en décider. » Au même instant, un nouvel arrivant se présenta, c’était un commandant fort jeune encore. Il demanda la cause de l’animation qui régnait parmi les officiers, et en lisant à son tour la missive du baron, il devint pâle d’émotion. « – Messieurs, s’écria-t-il en remontant précipitamment à cheval, je cours moi-même chez le général, car je crains fort que l’appel au secours apporté par cette gentille messagère ne soit que trop réel. Depuis plusieurs jours, le baron d’Olgicourt et quelques amateurs passionnés de grande chasse campent dans nos environs ; parmi eux se trouve mon meilleur ami, un camarade d’enfance auquel je faisais observer, tout dernièrement encore, qu’il y avait témérité à s’aventurer de la sorte, et qu’assurément ces parties de chasse finiraient par une catastrophe. J’ai grand-peur d’avoir été trop bon prophète. Mais, s’il en est ainsi, il ne faut pas perdre un instant, nos imprudents étant aux mains de sauvages qui les égorgeront sans pitié le jour ils penseront n’en pouvoir rien tirer. Cette miraculeuse dépêche n’est vieille que d’une heure, je connais l’endroit où se trouvent les bandits, on peut y arriver cette nuit même, les surprendre, et délivrer les prisonniers ; mais, je le répète, il faut agir avec promptitude. « Rendez la liberté à notre petite messagère, dit le commandant au sous-lieutenant ; elle l’a, par ma foi, bien gagnée. » Après ces mots, il partit au galop de son cheval. « – Messieurs, reprit le jeune sous-lieutenant, m’est avis que nous devrions repasser ce collier à l’hirondelle en y attachant une réponse ; qu’en dites-vous ? – Peut-être va-t-elle retourner aux lieux qu’elle vient de quitter ; en tout cas, nous ne risquons rien. » « La proposition fut acclamée, et tout de suite les officiers rédigèrent la réponse suivante : « Courage ! on y va ; soyez sur vos gardes. « DES OFFICIERS. » « On roula le papier comme le précédent, et, le collier repassé à mon cou, la liberté me fut rendue. « Je restai un instant immobile, cet emprisonnement dans une chaude main d’homme m’ayant singulièrement oppressée : l’oiseau a besoin d’air et de liberté. Enfin, je repris peu à peu possession de mes facultés d’hirondelle, et je m’envolai vers la forêt de chênes verts... Une heure plus tard je me retrouvai au milieu de nos infortunés chasseurs, et je me posai de nouveau tout près du père de Laure, qui tressaillit à ma vue. « – Notre hirondelle », fit-il tout bas. « Il s’empara de moi ; et quelle ne fut pas sa joie et celle de ses compagnons en trouvant, non leur missive, qu’ils croyaient reconnaître, mais la réponse des officiers ! « – Cela tient du prodige », dirent-ils. « En effet, pouvait-on raisonnablement croire à l’intelligence d’un pauvre oiseau que l’on tient pour borné ? En général, mes petites, les hommes sont trop portés à n’accorder d’intelligence qu’à eux seuls : ah ! que souvent ils seraient étonnés, s’ils savaient combien parmi nous les observent, les comprennent, et parfois les jugent... « Cependant, malgré l’espoir que donnait la dépêche des officiers, un grand danger menaçait les prisonniers ; j’y pensais, et dès le premier instant de mon retour le baron et ses amis en eurent conscience. Voici ce qui était à redouter : si l’émissaire des bandits rencontrait la troupe envoyée au secours des Français, ne reviendrait-il pas au galop de son cheval donner l’alarme à ses complices ? Alors, plus d’espérance : les malheureux chasseurs, sans armes pour se défendre, succomberaient infailliblement, et les bandits prendraient la fuite emportant leur butin. « Bien qu’il fût difficile aux prisonniers de causer entre eux, car tout portait ombrage à leurs féroces gardiens, ils s’entretinrent à voix basse de cette éventualité, se promettant, en tout cas, de vendre chèrement leur vie. « Plusieurs heures se passèrent dans cette cruelle alternative ; mais vers le soir l’espoir revint au cœur de mes compatriotes : tout portait à croire que la rencontre redoutée n’avait pas eu lieu. « La nuit venue, je me retirai sous la margelle d’un vieux puits et j’attendis. Les Kabyles avaient allumé un grand feu pour se chauffer d’abord, et se garantir des bêtes fauves, précaution indispensable dans ce sauvage pays. On entendait au loin, dans le silence de la nuit, une nuit du désert, l’aboiement des chiens de quelque campement arabe, et, plus près de nous, le cri des chacals qui rôdaient aux alentours, attirés par la présence des chevaux et l’odeur des reliefs du festin. « C’était un singulier spectacle, mes petites, que celui de ces hommes, aux figures bestiales, entourant ce brasier. Ils sommeillaient à demi, appuyés sur leurs longs fusils, une main sur le couteau, prêts à frapper à la moindre alerte. Quant aux prisonniers, ils se tenaient immobiles et semblaient dormir afin de tromper la surveillance de leurs gardiens ; mais, l’oreille tendue, ils écoutaient... Moi aussi j’écoutais, et l’ouïe étant infiniment plus développée chez l’oiseau que chez l’homme, même quand cet homme est à moitié sauvage, mon oreille était frappée depuis quelques instants par un son que ni Kabyles ni Français ne pouvaient percevoir encore. C’était le bruit du galop, très éloigné, de plusieurs chevaux. Il cessa bientôt, et j’en conclus que les cavaliers avaient mis pied à terre dans le but justement de ne pas dénoncer leur approche par cette indiscrète sonorité. « Mes yeux cherchaient à percer les ténèbres : étaient-ce bien les Français libérateurs ou de nouveaux ennemis ? Je n’osais me risquer à voler, dans la crainte des oiseaux de nuit, nombreux dans ce pays ; aussi avec quelle impatience j’attendais le jour ! Enfin une légère lueur parut à l’horizon, et je pus sans danger pousser une reconnaissance du côté où devaient arriver les libérateurs. – Ô bonheur ! j’aperçus à une faible distance une cinquantaine d’hommes ayant à leur tête le commandant ainsi que le jeune sous-lieutenant, qui avait demandé, comme une faveur particulière, l’autorisation de prendre part à cette petite campagne. Ils rampaient plus qu’ils ne marchaient le long des buissons de lentisques, tandis qu’un nombre suffisant de soldats restait à la garde des chevaux et de l’émissaire kabyle, lequel avait été garrotté et bâillonné de façon à ne pouvoir ni prendre la fuite ni donner l’alarme. « Voici ce qui était arrivé. À une certaine distance de Constantine, la petite colonne apercevant un cavalier d’aspect équivoque, qui, à la vue des Français, se mit à fuir de toute la vitesse de son cheval, le commandant le jugea suspect, et d’un coup de carabine à longue portée abattit sa monture. En quelques instants notre homme fut arrêté et fouillé, et la lettre du baron, qu’il chercha vainement à dissimuler, ne laissant aucun doute sur sa mission, le commandant le somma d’avoir à diriger la petite troupe vers le lieu de l’attentat. « – Si tu nous sers, lui dit-il, la vie, la liberté et un cheval ; si tu résistes, la mort ! » « Les pillards qui infestent l’Algérie appartenant généralement au plus offrant, celui-là comprit bien vite que, pour le moment, mieux valait servir les Français. « Plus la petite troupe approchait du campement, plus elle redoublait de prudence ; et déjà, à la lueur du feu, on apercevait à travers les broussailles le profil bizarre de ceux qui l’entouraient. On se sépara doucement, et nos hommes s’arrangèrent de façon à cerner l’ennemi. « Cette manœuvre s’accomplit non sans difficultés, car il fallait procéder sans bruit, à la façon des sauvages, et tout faillit manquer au dernier moment par la faute des grands lévriers qui, inquiets depuis quelques instants, se mirent à aboyer furieusement. Heureusement nos hommes étaient proches, les chasseurs sur la défensive, et les Kabyles, alourdis par les copieuses libations auxquelles ils n’avaient cessé de se livrer pendant la nuit, se laissèrent, pour ainsi dire, surprendre et n’opposèrent qu’une faible résistance. Les chasseurs, le baron en tête, bondirent sur eux en gaillards qui ont une revanche à prendre ; les nouveaux arrivants leur prêtèrent main-forte, et en quelques instants, les mécréants furent à leur tour prisonniers. « Après avoir repris haleine, la vaillante petite troupe rejoignit les hommes et les chevaux laissés en arrière, et l’émissaire, rendu à la liberté et pourvu d’un cheval, disparut bientôt derrière les montagnes. « C’étaient entre les imprudents chasseurs et leurs libérateurs des remerciements pleins d’effusions, des poignées de mains à n’en pas finir, et surtout l’assurance d’être moins téméraires à l’avenir. De côté et d’autre on avait bien reçu quelques horions ; mais, grâce au Ciel, aucune blessure grave n’était à déplorer. « – Messieurs, dit le commandant, vous venez de courir un rude danger, et j’espère que vous voilà guéris à tout jamais de l’envie de chasser à travers les maquis algériens. « Nous ne sommes pas ici dans la forêt de Compiègne ou de Saint-Germain, ne l’oubliez plus ; car sans le message vraiment providentiel de l’hirondelle, Dieu sait ce qui serait arrivé. C’est donc à cette gentille messagère, plus qu’à nous, que revient la gloire de votre délivrance. Mais, en vérité, ajouta le brave et modeste commandant, cette aventure ferait croire à l’esprit des bêtes. « – L’esprit des bêtes ! répliqua le jeune sous-lieutenant, croyez-y, messieurs, et surtout respectez les hirondelles, qui, à force de vivre près de nos maisons, doivent en savoir plus long que nous ne pensons. » « On rit un peu, et même beaucoup, de la réflexion du jeune officier ; mais pour ma part, je jugeai qu’il était décidément un garçon d’esprit, et je lui souhaitai mentalement toutes sortes de prospérités. « Bientôt la colonne se remit en route, les prisonniers au centre, liés deux à deux, et moi je volai longtemps, longtemps au-dessus d’elle... Il fallut cependant la quitter et rejoindre mes compagnes ; mais, depuis cette aventure, je pensai plus encore à ma chère France, et j’attendis avec impatience la saison qui devait nous y ramener. L’Algérie, malgré la magnificence de certaines régions, ne disait rien à mon cœur. « Enfin ce moment tant désiré arriva. Nous nous massâmes comme pour le départ de la France, et de nouveau nous traversâmes la grande mer. « Cette fois, le voyage s’accomplit, si ce n’est sans fatigue, au moins sans incidents remarquables ; la mer était belle, et des vents favorables nous poussèrent vers cette chère patrie, où nous arrivâmes le 1er mai. « Je vous laisse à penser, mes chères petites, si je fus heureuse de revoir le château des Étangs, et la fenêtre en ogive et la jolie chambre bleue. Je construisis mon nid contre cette fenêtre ; mais j’eus soin de le placer plus sûrement que celui de nos bons parents. « De très bonne heure la famille d’Olgicourt arriva au château. Laure avait beaucoup grandi : c’était presque une demoiselle ; mais elle aimait autant que l’année précédente à entendre gazouiller les hirondelles ; aussi matin et soir avais-je bien soin de me poser sur le balcon de la tourelle, entourée de toute ma nichée. « Croyez-vous, mon cher papa, que cette hirondelle soit la même que celle de l’année dernière ? demanda-t-elle un matin au baron, qui fumait une cigarette, accoudé sur l’appui de la petite fenêtre. « – Pourquoi pas ? fit-il ; et de plus j’aime à penser que notre miraculeuse petite hirondelle d’Afrique n’est autre que celle-ci. » « À ces mots, qui lui rappelaient le danger couru par son père, Laure lui jeta les bras autour du cou et lui donna un baiser retentissant. « – Vous n’irez plus chasser dans cet affreux pays, mon petit père ; n’oubliez jamais que vous me l’avez promis et même juré ! « – Oui, fillette, répliqua le père, je te l’ai juré ; mais ce serment, je me le suis fait également à moi-même ; car si, par me faute, un malheur était arrivé à mes amis ou à nos libérateurs, j’aurais été malheureux pour le reste de ma vie. » « Depuis le retour de Laure, j’avais remarqué qu’elle portait un médaillon en or sur lequel, admirablement imitée, se voyait une hirondelle ayant au cou un papier, en un mot, mon portrait ; et je ne doutai pas un seul instant que le bijou n’eût été fait pour perpétuer le souvenir de la délivrance de son père. Chère enfant ! combien je lui sais gré de cette marque de reconnaissance ! « Une partie de l’été se passa d’abord le plus doucement du monde ; mais le château ne se peupla point de brillants invités : il n’y eut ni bals, ni concerts, ni parties sur l’eau. Une sourde inquiétude semblait planer sur l’habitation et sur tout le pays... « Bientôt des troupes d’hommes, plus nombreuses encore que les nuées d’hirondelles en voyage, arrivèrent du Nord, tandis que d’autres troupes, considérables aussi, mais bien moins que celles du Nord, arrivèrent du Midi, et je compris qu’il allait se passer d’étranges choses. Ces troupes d’hommes étaient suivies d’innombrables chariots portant de longues machines en fer de forme cylindrique, et tout cela roulait avec un bruit si formidable, que la terre en paraissait comme ébranlée. « Un jour, jour horrible ! tous ces hommes se massèrent en bataillons, formant des lignes ou des carrés, selon les ordres de leurs chefs, et les hommes du Nord, sans se lasser, tiraient des coups de fusil sur les hommes du Midi, et ceux-ci tiraient également, et c’était à qui se ferait le plus de mal. « ... Et, des deux côtés, les machines que portaient de lourds chariots vomissaient avec d’effroyables détonations, comparables à la foudre en ses jours de colère, d’énormes boules de fer qui, même à une grande distance, renversaient les bataillons aussi facilement que s’ils eussent été composés de fourmis : c’était horrible à voir ! Les villages brûlaient, les maisons s’effondraient, tout disparaissait sous les pieds des hommes et des chevaux et sous le feu de la mitraille... Partout des morts, des mourants, des blessés..., partout l’épouvante et la destruction... Hélas ! mes enfants, c’est ce qu’on appelle la guerre... « Ah ! mes chères petites, Dieu vous préserve d’assister jamais à un aussi terrible spectacle ! Depuis cette époque, bien que je ne sois qu’une pauvre vieille hirondelle, mon cœur est resté triste, et je me suis demandé bien souvent pourquoi Dieu, qui nous a créés tous, permet aux hommes de s’entre-tuer d’une façon aussi cruelle. Passe encore pour les bêtes puisqu’on prétend qu’elles n’ont pont d’esprit ; mais les hommes !... Enfin peut-être est-ce encore une de ces lois qu’il faut accepter et non discuter, comme je vous l’ai déjà dit au commencement de ce récit ; dans tous les cas, ma simple qualité d’hirondelle me dispense de répondre. « Bientôt le pays devint inhabitable, même pour des hirondelles, et nous dûmes prendre notre vol vers des contrées plus heureuses. Après avoir séjourné quelque temps dans le midi de la France, nous hivernâmes sur les côtes d’Afrique, et bien souvent, durant les longs mois passés loin du sol natal, je me demandai comment finirait cette abominable guerre. Enfin, vers le mois de mai, le mois des fleurs, nous nous hasardâmes à rentrer dans notre pauvre France. Ah ! mes enfants, quel tableau que celui de notre chère patrie, dévastée, saccagée, brûlée, pillée !... À tire-d’aile je revins aux Étangs.... Hélas ! le château n’était plus qu’un monceau de pierres noircies ; le parc présentait l’image de la dévastation ; de tant de splendeurs il ne restait presque plus rien, et nos étangs eux-mêmes, dépouillés de leur ceinture d’iris et de roseaux, participaient à la commune désolation. « Je planai tout un jour au-dessus de ces ruines, me demandant où j’abriterais désormais mon nid, me demandant surtout ce qu’étaient devenus les habitants de ce triste lieu... J’appris enfin que Laure et ses parents étaient partis pour un château situé à l’autre extrémité de la France, et j’eus un instant l’idée d’aller les y rejoindre ; mais notre pauvre province dévastée conservait pour moi le charme de la patrie, que rien ne remplace. D’ailleurs, faut-il abandonner son pays malheureux ? Non !... Je demeurai donc. « Après avoir, en quelques coups d’aile, parcouru les environs, je fis choix de la maison riante et tranquille où nous sommes en ce moment. Je la savais habitée, durant les mois d’été, par une bonne grand-mère, ses enfants et ses petits-enfants, et j’en conclus que là aussi on aimait et on respectait les hirondelles. Je ne m’étais pas trompée : la petite maison me fut douce et hospitalière, et je m’attachai à ses habitants. Depuis lors, chaque année, j’ai construit mon nid à la même fenêtre, et chaque jour je suis égayée par les cris joyeux des petits enfants... » Ici la vieille hirondelle s’arrêta, semblant se recueillir. « Oh ! grand-mère, votre histoire est-elle donc finie ? s’écrièrent en chœur les jeunes hirondelles. – Pas tout à fait encore, mes chères petites. Dernièrement, vous en souvient-il ? je disparus pendant quelques jours : ce temps, je l’employai à une excursion au pays habité par mon amie Laure, que je n’ai jamais oubliée et que je voulais revoir avant de quitter ce monde. C’est aujourd’hui une grande jeune fille, belle à ravir et bonne autant que belle. Elle ne porte plus son médaillon ; mais elle l’a remplacé par une bague sur laquelle se retrouve la même petite hirondelle, ce qui prouve bien qu’elle tient à perpétuer ce souvenir. J’ai appris, durant mon séjour là-bas, que le baron d’Olgicourt, qui aime toujours notre pays, allait reconstruire le château des Étangs tout semblable à ce qu’il était avant la guerre ; que Laure viendrait l’habiter avec son mari, et que son mari serait le jeune sous-lieutenant de Constantine, devenu commandant, le vicomte Pierre de Givonne. Cette nouvelle m’a comblée de joie, car ce jeune homme m’était resté sympathique, et je le crois tout à fait digne de ma gentille amie d’autrefois. « Rien ne vous empêchera donc, mes chères petites, de construire vos nids aux fenêtres du château qui m’a vue naître. Quant à moi, si Dieu me prête vie, j’aurai plaisir à revoir ces beaux lieux ; mais je suis bien vieille, et je crains fort que cette traversée ne soit la dernière... Enfin volons tant que Dieu nous laisse des ailes, et ne nous tourmentons pas de l’avenir... « Allons, venez, mes petites, cette histoire nous a fait perdre une grande heure. Le temps du départ approche ; à peine nous reste-t-il quelques semaines pour renforcer les pauvres ailes qui vont parcourir un si grand espace. Profitons-en : venez, volez, exercez-vous !... Apprenez à franchir l’immensité des plaines et des mers, à lutter contre la tempête ; apprenez enfin à devenir de véritables hirondelles voyageuses... » Après ces derniers mots, la grand-mère hirondelle s’envola suivie de sa bande, tandis que l’autre grand-mère, l’habitante de la petite maison, celle qui depuis une heure écoutait la vieille hirondelle, ouvrit tout à coup les yeux, se demandant si elle avait dormi et rêvé, ou si elle avait entendu véritablement le récit des souvenirs de l’hirondelle... Il lui fut impossible, malgré toute sa bonne volonté, de décider cette importante question. Cependant, réels ou rêvés, les souvenirs de la vieille hirondelle n’en demeuraient pas moins dans sa mémoire. Elle les raconta le soir à ses petits-enfants, Edmond, Henriette et Marie F***, et moi, présent à ce récit, qui m’intéressa, je pris plaisir à l’écrire tandis que parlait la grand-mère Mais tout conte serait incomplet s’il ne portait avec lui sa morale. Celui-ci me rappelle une fable de La Fontaine bien connue (3) : Il faut autant qu’on peut obliger tout le monde : On a souvent besoin d’un plus petit que soi. Rémy d’ALTA-ROCCA, Souvenirs d’une hirondelle, Maison Alfred Mame et fils. ________________________________________ (1) L’Hirondelle et les petits Oiseaux, liv. I, fab. VIII. (2) Ce petit épisode est absolument vrai, et s’est passé, tel que le raconte l’auteur, à bord d’une frégate commandée par M. Henri Paquet. (3) Le Lion et le Rat, liv. II, fab. XII. |