| | Retour page précédente | |
Plappeville
Biographie de Jean-Pierre SCHMITT (1860-1929),
père de l'abbé Victor Schmitt, fondateur et directeur du Centre de Réadaptation.
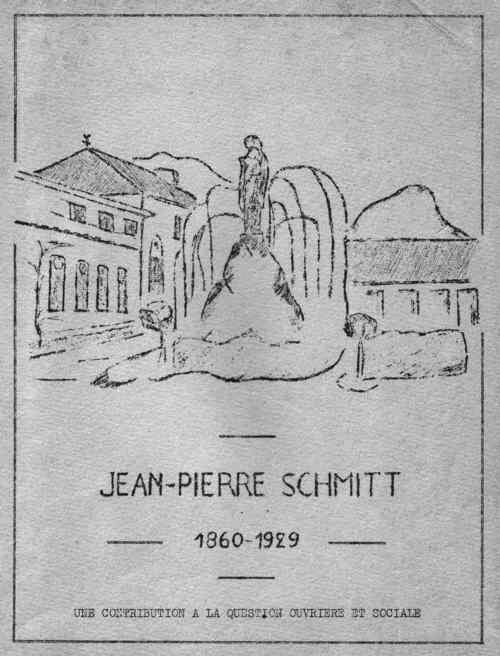 |
|
| I. Jean-Pierre SCHMITT à la maison paternelle. II. Dans le cercle de famille. III. A son lieu de travail. IV. Au service du monde ouvrier (son activité dans les Sociétés). V. Au service du Créateur. VI. Ses dernières années. |
« Ses amis attristés et en pleurs entourent la couche funèbre de ce noble disparu, Monsieur SCHMITT, et souhaitent que la joie active avec laquelle il se donnait si pleinement au service de la cause catholique trouve de nombreux imitateurs parmi nos hommes d’aujourd’hui. »
| M. FRANKUM secrétaire en chef au Réseau A-L (La Voix Lorraine, du 26.6.1929) |
Les lignes qui précèdent résonnent comme une invitation à faire connaître les efforts soutenus par Monsieur J.-P. SCHMITT pendant toute son existence pour réaliser l'idéal de l'ouvrier chrétien.
Pour dessiner un portrait vrai d'un homme au caractère affirmé, il suffit d’énumérer des faits et scruter en particulier ses rapports avec ses semblables. Dis-moi comment se sont manifestés tes rapports avec les autres, et je te dirai qui tu es.
Avec ses enfants, plusieurs amis ont rédigé « ces souvenirs » qui sont autant de contributions au problème de la question sociale et ouvrière que J.P. SCHMITT a solutionné en chrétien.
PLAPPEVILLE, Pâques 1941.
DANS LA MAISON PATERNELLE
1. Les premiers succès de travail
Jean-Pierre SCHMITT était le second fils d'une famille d'ouvriers qui comptait onze personnes. Les hasards de la vie et les nécessités du travail avaient amené ses parents à PARIS où il vit le jour le 8 février 1860.
Un peu plus tard, la famille vint se fixer à METZ, chef-.lieu de la Moselle, Là, le jeune Pierre, qui avait à peine fréquenté les classes, fut envoyé à l'Ecole des Frères ; ceux-ci, en voyant l'esprit ouvert de leur élève, conseillèrent de l'orienter vers l’enseignement. Par tous les dons de son intelligence et de sa volonté, l'enfant paraissait bien disposé pour cette carrière ; mais à la fin des cours primaires, le jeune garçon dut renoncer à continuer ses études : le gain du père était modeste, l'aîné des fils reparti à PARIS, et sept frères et sœurs plus jeunes réclamaient le pain quotidien.
Tout naturellement et courageusement, bien pénétré de la pensée de l'obligation qui lui incombait, le jeune Jean-Pierre partagea les soucis et le travail de son père. Bien plus : souvent au cours de la semaine, il n'hésitait pas à se présenter de nuit sur un chantier, et dans les heures matinales des dimanches, il parvint à trouver un troisième emploi chez un autre patron. Le jeune homme travailla littéralement jour et nuit afin de suppléer à l'insuffisance du gain paternel.
La situation financière de la famille finit par s'améliorer et Jean-Pierre put enfin songer à lui-même ; il fut amené à apprendre le métier de peintre.
2. Les Parents
L'attitude de dévouement dont fit preuve le jeune Jean-Pierre aurait dû lui concilier les bonnes grâces de tous les siens et lui valoir une reconnaissance de la part de tous. Hélas, il n'en fut pas tout-à-fait ainsi. Cette carence de reconnaissance s'explique par les conditions de vie dans lesquelles se trouvaient placés les ouvriers vers 1880, conditions qui créaient des situations de famille difficiles et disloquaient les foyers. Pauvreté n'est pas un vice, mais où sévit la misère, tout est à craindre. Rares sont ceux qui dans de telles conditions savent garder une aimante sérénité.
C'est ainsi que la vie au foyer devint extrêmement pénible pour le jeune homme, âme délicate et sensible On considérait facilement tous les sacrifices qu'il s'imposait comme une chose toute naturelle.
Dans la simplicité et la bonté de son attitude, il devint même la cible de la moquerie de ses frères et de ses camarades, surtout quand, le dimanche il accomplissait fidèlement son devoir de chrétien, alors que d'autres allaient s’amuser au jeu de quilles ou s'adonnaient aux plaisirs les plus variés.
Son caractère noble ne songe pas à relever ces écarts qui sont à mettre sur le compte de la jeunesse, bien au contraire. Toute sa vie il restera un fils soucieux de ses parents, un frère aimant, surtout lorsque bien plus tard le sort frappe durement ses frères et sœurs.
Quand on jette un coup d'œil rétrospectif sur les 27 années de jeunesse de J.-P. SCHMITT, années où les luttes amères de la vie eurent leur grande part, on y reconnait une conception de la vie toute imprégnée d'un sain réalisme servi par une volonté de fer et un caractère inébranlable.
Au milieu des pénibles difficultés des premières années de sa vie, jamais la révolte ne souleva son âme contre le sort qui se montrait si dur à son égard.
Mûri avant l'âge, agissant en homme fait, il s’accordera, sans se plaindre, de toutes les situations de fait ; il accomplit avec fidélité ses devoirs d'état, même dans les conditions les plus difficiles.
3. Quelques mots de sa belle-mère et de sa fiancée
L’année 1887 marque un tournant dans la vie de J.-P. SCHMITT, et une nouvelle voie s'ouvre devant lui. C'est l'année de ses fiançailles.
Nous ne présenterions pas une image fidèle de sa personne si ne faisions pas mention, même rapidement, de la famille HESS ; l'alliance avec cette famille devait lui procurer un bonheur bien mérité.
La famille HESS était une famille de paysans très attachée au sol qu'elle cultivait en exploitant, vers 1870, une ferme importante dans les environs de BOULAY. Du mariage du fermier d’alors sont issus quatre garçons et une fille, la future épouse de J.-P. SCHMITT. Le sort ne fut pas tendre pour cette famille. Une situation précaire fut créée par dix années d'une maladie incurable qui frappa le père durant la guerre de 1870-71. A partir de cette époque, toute la gestion de la ferme reposait sur la mère, Madame Catherine HESS.
L'exploitation d'une ferme aussi importante réclamait beaucoup de savoir-faire : surveillance des garçons et des bonnes, répartition du travail, cuisson du pain durant la nuit, la grosse lessive : tout cela dépassait les forces d'une femme qui ne pouvait compter que sur elle-même. Plus que cela, des hommes sans consciences tout en prodiguant des conseils intéressés à la pauvre fermière, surent exploiter à leur profit la situation et causèrent la ruine de la ferme. Il fallut vendre le bien. Alors elle se retira avec son mari malade et quatre enfants mineurs, aux environs de Metz, pour tenter à nouveau sa chance sur un bien de moindre importance. Mais en vain ! Un garçon de culture sans aveu arriva à liquider subrepticement l’équipement de la ferme et à s'approprier une grande partie des revenus. Ce garçon de culture, après avoir purgé sa peine de prison méritée, vient, poussé par le repentir, trouver Madame HESS ; elle le reprend à son service pour l'employer dans une troisième ferme.
Mais bientôt trahie par ses forces, elle doit renoncer à ce troisième essai. Elle doit se résigner à s’installer dans un modeste logement, dans une ruelle au SABLON. Elle accepte et ne craint pas le pénible travail de laveuse dans des institutions religieuses ou chez des particuliers. Elle porte elle-même les cendres nécessaires à la lessive. Ce furent des temps bien durs pour elle et ses enfants.
Pendant les 16 ans de son mariage, Madame HESS connut, à plusieurs reprises, des situations angoissantes ; elle aurait pu sombrer dans 1e désespoir si elle n'avait pas été soutenue par sa foi et sa confiance dans le Ciel.
Elle rappelait plus tard avec gratitude les mots de son curé, l'abbé CORDEL, qui, par la suite, devint Vicaire Général à METZ : « Ma bonne dame, vous avez tout perdu, mais il ne faut pas perdre la tête. » Elle comprit le soutien moral que lui apporta son curé. Le conseil fut écouté. Et quand la situation devint tragique, elle ne se laissa pas aller au découragement. Toujours elle sut faire face à tous ses devoirs. Elle continua à travailler comme simple laveuse, sans que l’ancienne fermière en éprouvât la moindre humiliation.
Tandis que la mère travaille dehors, la petite Marie, qui va sur ses dix ans, reste au chevet de son père malade ; tout enfant qu’elle est, elle le soigne avec la patience d'une mère pour son enfant.
Est-ce alors étonnant que la petite fille, harassée de fatigue s’endorme un jour dans la salle d’attente du médecin qu’elle était allée chercher pour son père. Ce n'est que tard dans l’après-midi qu’elle devait être réveillée par la brave gouvernante. Dans ces conditions de vie, il ne pouvait être pour la petite Marie de fréquenter l’école. Toutefois, sans avoir appris à lire ni à écrire correctement, elle saura faire face, plus tard, à toutes les exigences de la vie. Ses qualités innées, intellectuelles et morales, malgré les lacunes scolaires, s’épanouirent sous l’impulsion bienfaisante de sa mère, aux vertus chrétiennes si fortes.
Après la mort du père, décédé à quarante ans, en juillet 1880, Marie aida sa mère en faisant de la couture à la journée ; elle rapporta un mark par jour. On a paré à la plus grande misère ; mère et fille s’entraident, pleines d’émulation. Elles n'en oublient pas de remercier tous les jours le Seigneur pour son soutien paternel si visible pour les aider à porter leur douloureuse croix.
Maman HESS est la « femme forte » de l’Ecriture, qui devait devenir pour Monsieur SCHMITT une vraie mère. Elle donna, de plein cœur, son accord au mariage de sa fille Marie. Son œil de mère, qu’avait aiguisée l'expérience, avait reconnu depuis longtemps les excellentes qualités du prétendant. Elle plaisantait en pensant à la grande pauvreté des deux : « Vous allez associer pour un joyeux mariage 1a faim et la soif ». Mais qu’importe s’i1 n’y a ni dot ni fortune, une âme droite et ouverte et la crainte de Dieu peuvent être la base d’une heureuse vie commune, et son futur gendre offrait toutes les garanties pour ces conditions d’un vrai bonheur. Maman HESS ne se trompait pas ; l’avenir devait lui donner raison. Le fiancé non plus n'avait pas fait de faux calcul dans ses projets de mariage. Dépourvu de toute fortune - il avait consacré toutes ses économies à l'aide de sa famille -, il ne poursuivait qu’un but : contracter un mariage avec une personne qui avait une conception chrétienne de la vie et de ses devoirs de mère.
1. Aspect de la vie familiale
Après le mariage, fille et gendre vivent dans une véritable piété filiale vis-à-vis de Madame HESS. Leur vie est exemplaire à ce sujet. A trois, ils ne forment qu’un seul foyer bien uni, dans une petite maison isolée du SABLON, 59, rue Saint-Pierre (*). Un grand jardin attenait à la maison. Le gendre ne permet plus à sa belle-mère d’aller en journée. Celle-ci, toutefois, ne reste pas inactive ; elle travaille aux champs et au jardin.
Et son travail devint vraiment rémunérateur, puisqu'il lui permet d'aller vendre, au marché, le produit de son travail. Trois fois par semaine elle se met en route, à une heure du matin, vers le marché aux légumes de METZ, d'abord la hotte au dos, ensuite se servant d’une voiturette, accompagnée souvent par son gendre qui, lui, pousse une deuxième charrette. Comme elle est heureuse de rentrer à midi, après avoir vendu pour 10 ou 20 marks de légumes. Même quand elle est très fatiguée, elle trouve le moyen d’entrer dans une église pour s’acquitter de ce qu'elle considère comme une véritable dette de reconnaissance vis-à-vis du Bon-Dieu.
(*) La maison et le jardin de 15 ares ont fait place à la rue Paul-Diacre, en 1934.
Même les jours sans marché, la mère et la fille sont occupées dès le grand matin. Toujours Dieu premier servi ! La première à être prête se hâte pour assister à une messe matinale, alors que l'autre est retenue au foyer pour veil1er sur les enfants.
Dans une prise de conscience vraiment chrétienne de la valeur du temps, travail et prière alternaient, d'heure en heure, et cette ordonnance toute chrétienne faisait régner la joie dans la maison. Et le tout était agrémenté par des réparties d'humour de Madame HESS que lui inspirait son état de santé et d’équilibre moral.
Un jour, lors d'une réunion des mères chrétiennes, elle ne peut rester tranquille en place. Le discours d’un prédicateur, éloquent certes, mais bien éloigné des préoccupations précises de son auditoire, ne veut pas finir. Le curé, habitué à la voir accomplir ses dévotions religieuses avec un grand sérieux, est surpris de constater son impatience. Après la bénédiction, en quittant l'église, il s'arrange pour rencontrer Madame HESS. « Pourquoi si pressée aujourd’hui » l'interpelle-t-il. « Le soleil est encore en plein ciel et m'attend, le travail au jardin ne se fait pas tout seul, le Révérend père n’a pas l'air le savoir », telle fut sa réplique à laquelle ne manquait pas le sel du dialecte lorrain, et déjà Madame HESS avait disparu…
Ce serait un chapitre à part si l'on voulait parler du soin qu'elle apportait à l'éducation des enfants. Ce qui caractérisait son attitude de grand'mère, c'est que volontiers elle excusait et pardonnait.
Cependant, la patience de l'indulgente grand'mère était bien souvent mise à l'épreuve. Les petits-enfants révélant on ne sait quelle nature, se signalaient par trop souvent par des coups pendables : Vingt lapins auxquels elle prodiguait tous ses soins furent un jour trempés dans l'eau froide, puis placés sur une balançoire agitée qui devait servir de séchoir. Au grand ahurissement de la grand’mère, les pauvres bêtes périrent les unes après les autres Mais elle n'était pas au bout de ses peines. Les pots de confiture bien garnis se vidaient comme par enchantement ; et ironiquement une nouvelle étiquette, apposée à ces pots, faisait savoir que la confiture s’était desséchées. Il y eut pire que cela, le jour où un garçon, jeune fripon, lecteur passionné de Karl MAY, mit le feu à la .maison, de sorte qu'on dut faire appel aux pompiers de la ville. Il récidiva dans ses prouesses à l'indienne en sautant du toit paternel, haut de 6 mètres, et il fallut au médecin plusieurs heures de travail pour remettre en place la mâchoire désarticulée. A tout cela s’ajoutaient les actes de pillage habituel du garde-manger, qui s’accomplissait avec l'aide de petits voisins de la même trempe.
Pour être complet dabs l’énumération des déboires de la pauvre grand’mère, le frère qui écrit ces lignes devrait ajouter ses propres frasques. Mais toutes ces farces plutôt mauvaises, inventées par de pareils garnements, bien que mettant les nerfs de la grand’mère à une rude épreuve, n’arrivaient pas à bouleverser son âme. Tout bonnement, elle demandait à l'enfant coupable de penser à Dieu qui toujours pardonne.
Dans ces conditions, elle demandait au petit délinquant de regarder l’image toute jaunie, bien placée en vue dans la cuisine, et elle faisait lire une parole ou l'autre figurant sur cette image. Ce texte, interprété par la pieuse femme, prenait chaque fois un sens d’actualité qui se gravait dans nos mémoires d'enfant, tout en nous révélant, toujours davantage, 1’âme profonde de l’aïeule. Nous aimons à nous rappeler les paroles de ce tableau, nous ne saurions les oublier ; la théologie elle-même ne les désavouera pas.
| La foi amène l’amour, Où est l’amour, est la paix, Où est la paix, la bénédiction, La bénédiction vient de Dieu, Et Dieu supprime toute misère. |
Maman HESS connaissait par cœur toutes ces paroles qui inspiraient sa vie et dont elle expérimentait continuellement la bienfaisante efficacité. Pour elle-même, pour sa fille, pour son gendre, elle voyait constamment le ciel bénir une foi confiante, l’amour de la paix et 1’ardeur au travail.
Après 25 ans de dur labeur, la maison en location fut acquise. Pour toute autre que Madame HESS, le temps aurait pu paraître venu de jouir enfin d'un repos bien mérité. Mais sa nature avait un besoin incessant d’activité ; et le travail dans sa vie devait continuer, malgré les pressantes instances du gendre de se reposer, jusqu’à l’épuisement total des forces. On la vit un jour s’effondrer dans la rue, alors qu’elle poussait sa charrette.
Enfin, après tant de labeur, au mois de juillet 1916, en plaine guerre, elle fut jugée digne de jouir du repos de l’éternité. Les habitants du SABLON lui firent des funérailles imposantes qu’elle n’aurait, certes, pas demandées ; elle voulait toujours passer inaperçue. Mais le SABLON tenait à rendre un dernier hommage de respect et de vénération à la « Godé », comme l’on disait familièrement. Elle fut une de ces femmes pleines d'énergie qui, malgré leur modestie, s’imposent à la considération de tous ceux qui les approchent.
A son école, le gendre put se former et devenir capable d’accomplir de grandes choses. En effet, 1’humeur égale et joyeuse de la belle-mère, sa constante ardeur au travail, sa foi profonde et saine, tout cela ne put avoir qu’une influence heureuse sur celui qu’elle appelait son fils.
2. L’art éducatif de Monsieur SCHMITT
La Providence avait donné à la famille SCHMITT-HESS deux filles et trois garçons. De ces cinq enfants une petite fille et un garçon moururent en bas âge ; deux devinrent prêtres et la fille unique tient encore la maison d’un de ses frères.
Il est difficile à dire ce qui fut prépondérant dans l'éducation des enfants : le soin pédagogique du père ou l'art tout intuitif et simple de la mère. La reconnaissance des enfants serait bien embarrassée si elle devait se prononcer ; elle préfère rendre hommage aux deux méthodes qui ont été également bienfaisantes.
La Mère
Nous avons lu quelque part la remarque faite par un évêque, à la suite de la demande d'une mère qui implorait la bénédiction du prélat en vue d’obtenir pour son fils la grâce d'une vocation sacerdotale : « L’amour d'une mère est plus fort que ma bénédiction ».
Sans connaître sans doute cette parole, Madame SCHMITT, pour assurer le bonheur de ses enfants, mettait à la base de leur éducation son amour fort parce que bien compris, un amour allié à une certaine sévérité, Elle ne laissait rien, mais absolument rien passer, qui eut été incompatible avec une conduite chrétienne véritable. La plus petite faute était réprimandée ; et quand cela était nécessaire, elle savait souligner l'importance de ses paroles par des moyens frappants ; elle employait parfois le martinet. Dans l'éducation des enfants, il y avait de sa part collaboration complète avec les maîtres et le c1ergé. Aucun enfant ne pouvait espérer faire désavouer un de ses éducateurs. Elle n’aimait pas tresser des couronnes de louanges à ses enfants devant d’autres, le sentiment qu'elle avait de la justice l’en empêchait. Sa main était toujours prête à arracher la mauvaise herbe pour protéger la délicate plante de l’âme de ses enfants.
Dans l’austérité qui l’entourait, cette mère fit régner la joie dans la vie de sacrifice qu’elle pratiquait ou qu’elle imposait. La joie devait favoriser le développement intellectuel et moral de ses enfants. Cette mère au cœur d'or n'avait pas besoin de paroles pour manifester son amour. Ses actes s'en chargeaient.
Elle avait d’autant plus de mérites que toute sa vie elle fut souffrante. Il ne fut pas un Jour où son état de santé bien précaire ne lui rappelât qu’elle était appelée à marcher dans la voie royale de la souffrance.
Le souvenir d'une telle mère reste toujours vivant dans le cœur profondément reconnaissant de ses enfants.
Elle mourut au Centre de Plappevîlle, en mars 1941, auprès d’un de ses fils.
Le Père
Aucune éducation ne peut être valable si la responsabilité n’en est partagée pleinement entre le père et la mère. La méthode du père, plus raisonnée, doit toujours exercer son influence sur les intuitions affectives du cœur maternel. Cette règle d’or était parfaitement appliquée par nos parents.
Tout d’abord, le père sait inculquer à ses enfants un profond respect et pour tout ce qui est sacré et il impose une obéissance qui n’admet pas de réplique. Il a l’esprit large, compréhensif pour chaque initiative émanant de n’importe quel membre de la famille. Il ne s’oppose pas au développement des talents qui cherchant à se manifester ; mais il devient intraitable quand un enfant menace de s écarter du droit chemin, qu'il suit lui-même en tout.
Les réprimandes sont rarement nécessaires. Son silence est d’autant plus éloquent et plus impressionnant qu’il parle généralement par lui-même. Un seul regard calme, et qui pénètre dans l’âme, suffit pour rappeler immédiatement à l'ordre l’enfant.
Devant un tel père, les enfants ne pouvaient concevoir une autre attitude que celle de la soumission toute respectueuse et filiale. Le chef de famille non seulement s’impose à la vénération de ses enfants, mais il conquiert aussi leur amour et leur affection.
II se fait tout à tous ; c’est ainsi qu’il gagne la confiance des siens. Il s’intéressa, sans se lasser, à tous leurs petits et grands problèmes de vie. Il reste, écrites de sa main, une centaine de lettres pleines de détails de la vie familial. A travers 1’écriture, c’est son cœur de Père que l’on sent battre, et c’est ainsi que ses lettres constituent un véritable trésor familial.
Voici un extrait d’une lettre qui montre bien son grand tact dans la manière de former ses enfants : « Mon cher fils, si tu peux trouver un livre qui te permet d’apprendre les titre et les appellations quand tu t’adresses à des personnes à qui l’on doit le respect, étudie-le avec soin ; tu y verras que « Honoré Monsieur » peut s’appliquer à n’importe quel marchand de bêtes à cornes, mais pas à un « Révérend Père ». En quelques mots, il révèle son extrême délicatesse jointe à la plus grande discrétion. Par là, il s’impose au respect d'enfants plus instruits et plus formés que lui.
Ce qui impressionne encore les enfants, c’est de remarquer chez leur père une véritable soif de connaître. Pendant les longues soirées d’hiver, il travaille avec méthode à développer son instruction. Lui, qui n’a connu que l’école primaire, arrive à parler et à écrire un français pur et un allemand classique. Il arrive à posséder une connaissance de l’histoire qui étonne chez un simple artisan, mais qui explique certainement l’aisance et la sûreté avec lesquelles il aborde la discussion des problèmes les plus variés de la vie. Bien plus ! Les problèmes de mathématique les plus difficiles qui sont posés à ses fils au cours de leurs études, il sait les résoudre comme en se jouant, même si sa méthode ne devait pas donner entière satisfaction à un professeur exigeant. Mainte preuve de 1a vivacité de son esprit, qu'il cultivait sans cesse, pourrait être citée. Contentons-nous d'un trait rapporté par un témoin : Lors d'une réunion du Conseil Municipal dont il faisait partie (nous on parlerons plus tard), 1’architecte, après l’exposé d’un devis important, fut prié par Monsieur SCHMITT de refaire l'addition présentée ; elle contenait une erreur. Mentalement, pendant la lecture, il en avait fait l'opération.
Quant à sa volonté, ainsi que nous l’avons déjà insinué, elle est ferme et droite, et dans toutes les épreuves elle reste inébranlable, même quand la nature est affaiblie par un état de santé devenu précaire….. Notre père souffre souvent, il a des poussées de fièvre assez fortes, mais jamais le programme établi pour la journée n’en souffre.
Cette fermeté de caractère n’était pas innée, mais c’était le fruit d’une maîtrise de soi-même et de sa joyeuse poursuite d'un idéal chrétien. Cette fermeté s’épanouissait dans le sentiment toujours bien vif du devoir à accomplir qui pouvait le porter jusqu’à l’héroïsme.
Ces traits d'un caractère ferme n’excluaient pas le respect plein de douceur et de tact qu’il témoignait à la compagne de sa vie. Dans cette conjoncture de vertus maternelles et paternelles, le climat était créé pour faire jaillir du cœur des enfants la plus belle piété filiale à l’adresse des parents. Les parents, d'ailleurs, à 1’occasion, s'entendaient à faire éclore cette dévotion filiale.
Séparé de sa famille depuis dix mois, un de ses fils reçoit, dans un hôpital lointain où la maladie le retenait, la visite de ces parents. La scène de l'arrivée mérite d’être mentionnée : Le père devance, avec un autre visiteur, la mère d’une cinquantaine de pas. Une dame accompagne la mère, et toutes les deux ne suivent que lentement la marche des hommes. Le fils, dans la joie débordante de revoir son père, se précipite sur lui, mais, dans son élan, il est arrêté par un geste net du père : « mon cher », lui dit le père, « 1à-bas arrive ta mère, va la saluer d’abord et reviens vite vers moi ».
L’attitude du père pourrait paraître étrange et sévère. Mais celui-ci voulait montrer que l'amour filial doit se porter, en premier lieu, sur la mère, qui plus que le père souffre des épreuves de ses enfants ; elle mérite de recevoir en récompense la première effusion de l’amour filial. Ainsi éduqués, les enfants devaient trouver tout naturel de témoigner un très grand respect à leur mère. Le seul geste du père valait plus que de longs discours.
De son côté, la mère était un modèle de fidélité et de dévouement ; le père avait le grand mérite de porter les lourdes responsabilités accompagnées de soucis constants et tout le poids du jour dans son incessant labeur. Jamais, elle ne s’opposait ouvertement a son mari. Et si un malentendu surgissait entre le père et la mère, il était bien rare que les enfants soient les témoins d’une discussion quelconque.
Dans le souvenir des enfants se trouvera toujours évoquée, par la suite, cette fameuse entente qui cimentait l'union du foyer en reposant sur 1e respect et l'amour mutuel.
Toute cette structure morale avait comme fondement une attitude foncière. Le père et la mère ne vivaient que pour la famille. Dans les moments de tourment et d'épreuve venant de l’extérieur, qui semblaient vouloir ébranler et disloquer le cadre de la famille, les parents ne voyaient plus que le but essentiel de leur existence ; ils s’entendaient à faire comprendre à leurs enfants, qui subissaient 1e contre-coup de cette situation, qu'il ne saurait y avoir un bonheur et une joie durables en dehors de la famille.
Quelques faits suffiront à illustrer ces affirmations. Les parents avaient, certes, connu (nous le verrons par suite) un esprit social très grand ; mais cette participation active en dehors du foyer ne devait jamais nuire à la vie familiale. Le père ne tolérait pas les visites inutiles ou inopportunes, les relations frivoles ou mondaines. Il savait très bien que tous ces rapports sociaux inutiles, tout en faisant perdre un temps précieux, finissent toujours mal. Toujours, dans ses rapports, il cherchait à poursuivre un but supérieur et communautaire. Les parents ne craignaient pas de dire, et en cela ils n’exagéraient pas, malgré le paradoxe d’une telle parole : « Même les meilleurs camarades ne valent rien ».
Le père avait une répulsion pour les cabarets où se joue si souvent le sort du foyer. Il n’apparaissait dans une auberge que tout à fait exceptionnellement : il savait très bien que le véritable esprit social ne s’acquiert nullement dans ces sortes de fréquentations.
Toujours dans le même amour du foyer, il ne cherchait pas à faire des voyages de plaisir. Certes, sa curiosité native aurait pu le porter vers ces déplacements qui lui auraient permis de s’enrichir intellectuellement. Bien qu’il disposât de permis de circulation, qui n’auraient pas rendu onéreux ces voyages, il préférait rester chez lui et consacrait ses loisirs à des travaux d'entretien à l’intérieur de son foyer, à des travaux de jardin ou à l’enrichissement de sa culture générale.
Même attitude de réserve pour les représentations théâtrales (on ne parlait pas encore de cinéma). Bien qu’il eût des cartes gratuites pour le théâtre, il n’y alla qu’une seule fois pour accompagner l'un de ses fils. Loin de vouloir entraver la formation artistique de ses enfants, il leur permettait d’aller au théâtre à deux conditions : tout d’abord qu’il s'agisse de pièces réellement formatrices et, ensuite, que ces sorties ne deviennent pas une habitude.
Toujours oublieux de lui-même, ce bon père sait reconnaître les exigences qui s'imposent à ses enfants. Il fait lui-même cadeau d’une voiture à un fils prêtre qui doit desservir deux paroisses. Il travaillait lui-même à l'entretien de la voiture, mais il refusa toujours de s'en servir pour des fins personnelles. Jamais il ne monta dans cette voiture. Cette intransigeance dans la satisfaction personnelle n'était ni originalité ni entêtement, mais tout simplement une attitude d’austérité d’un homme qui vit intégralement le programme de vie qu’il s’est tracé. Il n’était nullement rébarbatif en face des progrès de la vie que son bon sens naturel lui faisait reconnaître comme vraiment bienfaisant. Mais jamais il ne voulait s’écarter du droit chemin qu’il s'était fixé. Un tel père ne pouvait être qu’imité en tous points.
A L’ATELIER
Suivons donc notre cher papa SCHMITT dans les différentes orientations de sa vie, tout d'abord dans son travail aux Ateliers de Chemins de fer de MONTIGNY. C'était en 1887 qu'il fit sa demande d’entrée aux Ateliers. Nous rappelons que c’était l'année de son mariage.
1. L’artisan consciencieux
C'est à pied que pendant 20 années, quatre fois par jour, il fait le chemin du SABLON à l'atelier et retour. Il lui faut une bonne demi-heure, qu’il pleuve ou qu’il vente. La pause de midi est courte et il lui reste à peine une demi-heure pour prendre le repas en commun avec les siens.
L'achat d'une bicyclette facilitera ses déplacements. Peu avant la guerre de 1914 un train pour les ouvriers fut mis en service, et ainsi le repas de midi se prolongea de 15 minutes.
Il apporta à son métier une compétence technique, exceptionnelle, de sorte qu’il s’imposa à la considération de ses camarades. Ses chefs le remarquèrent bientôt ; ils eurent pour lui le respect qu’il méritait.
Un empoisonnement dû au blanc de céruse l'oblige à passer quelque temps à 1’hôpital. Dés son rétablissement, sans chercher à prolonger la convalescence, il se présente sans tarder pour la reprise du travail.
La direction de 1’hôpital a remarqué le sérieux de son comportement et lui offre une place bien rétribuée à l’hôpital. Mais Monsieur SCHMITT aime son métier qu'il ne voudrait pas abandonner pour de simples considérations d’ordre financier.
Pendant les 37 années de service aux Ateliers de MONTIGNY, il n’interrompt son travail, à part le cas de maladie, qu’une seule fois pour une cure bien nécessaire à BADENWEILER, que le médecin lui avait ordonnée à son corps défendant.
Il est tout à son travail de vernisseur aux Ateliers. Ce travail qu’il exécute avec infiniment de conscience revêt pour lui le moyen honorable qui lui permet honnêtement de nourrir sa famille. Toujours la même pensée de la famille qui sublime toute sa vie et qui rend tous ses efforts faciles et presque agréables.
2. L’ouvrier respectueux de l’autorité
Dans son travail, Monsieur SCHMITT sait reconnaître les droits de l'autorité. Il exécute les ordres donnés. S’il est donc respectueux vis-à-vis des supérieurs, il sait cependant faire un usage légitime de la liberté de parole qu’il revendique parfois quand il s'agit de défendre les camarades.
Voyant bon nombre de pères de famille atteints par une mesure de licenciement, Monsieur SCHMITT ne veut pas bénéficier d’un traitement privilégié ; de son propre chef, il demande à quitter son emploi, dans l’espoir de sauver au moins un camarade. La direction, devant une attitude aussi courageuse et aussi noble, hésite, et comme elle tient absolument à un ouvrier aussi précieux, elle ne renvoie aucun ouvrier plus âgé que lui.
Lors des grèves et des arrêts de travail qui eurent lieu périodiquement vers 1890, mais qui prirent plus d’ampleur en 1920, conscient de ses devoirs sociaux il sut manœuvrer de telle façon qu’il arrive toujours à concilier le respect dû à l’autorité avec la défense des droits des camarades. Son esprit ouvert aux problèmes de l’heure et son caractère droit lui permirent de se faire écouter de part et d'autre.
La remise en marche des Ateliers, après la guerre de 1914-18, exigeait de tous un gros effort d'adaptation à 1a situation nouvelle. Dans cette période de transition tout particulièrement, il sut garder tout son calme et montrer toute sa compétence d’ouvrier qualifié, tant techniquement que socialement, parfaitement à la hauteur de la nouvelle situation qui se présentait. Plus d’une fois il fut convoqué à la direction du réseau ALSACE-LORRAINE à STRASBOURG. On appréciait beaucoup les avis d’un simple artisan qui s’appuyaient tout à la fois sur la connaissance du métier, sur l'expérience de la vie et la connaissance des hommes.
3. Le chef juste
L'engagement de Monsieur SCHMITT, en 1887, au réseau de Chemin de fer lui procura une situation plus avantageuse. Neuf ans plus tard, il devant chef de colonne. En 1924, il passe à la retraite comme sous-chef de brigade.
A plusieurs reprises on lui offrit des situations supérieures. Régulièrement, il refuse ; il ne veut pas troquer la casquette de l'ouvrier contre le chapeau de bourgeois. Il ne voudra jamais renier son passé, mais, fidèle à sa classe, il désirera rester toute sa vie un ouvrier, un travailleur manuel. A la tête d’une colonne à l'atelier de vernissage qui compte 20 hommes, il entend rester le premier ouvrier parmi ses camarades. Il ne cherche à faire prévaloir aucun esprit de domination, il prend sur lui les tâches les plus dures. Toutes les difficultés se règlent en famille et tout esprit de dénonciation est banni de l'équipe.
4. Le camarade plein de cœur
Pour ses camarades de travail, il est un ami sûr, j’allais presque dire un père dévoué. Ouvrier dans l’âme, il aime sincèrement les autres ouvriers, et toujours il est prêt à les aider.
A 1’atelier, surtout pendant les pauses, des discussions s’engagent sur les sujets les plus variés. Les avis sont souvent partagés, et les oppositions se manifestent. Monsieur SCHMITT, dans son amour de la vérité, de la justice et de la charité, sans chercher à flatter, arrive toujours à apaiser les esprits. Amis et adversaires lui décernent le beau titre de « brave papa SCHMITT ».
Un jour, un camarade de travail lui fait un grief d'avoir permis à ses deux fils de devenir prêtres. Il est heurté dans ses sentiments. Il est aussi blessé dans son honneur de père, mais il répond avec calme : « Mon cher, peut-être demanderas-tu bientôt à cor et à cri un prêtre, mais ce sera trop tard ».
A peine trois jours après, le pauvre se trouve coincé entre les tampons de deux wagons et il a le thorax écrasé. Monsieur SCHMITT est le seul témoin de l'accident et il doit entendre le malheureux au désespoir appeler un prêtre. Il accourt et ne peut que lui fermer les yeux pour le repos éternel…
Une autre fois, un camarade, militant communiste, lui dit : « Pierre, dommage que tu ne sois pas avec nous pour combattre dans nos rangs ; tu ferais carrière et tu deviendrais secrétaire de Syndicat ! ». Il répond avec calme et fermeté, mais évite de blesser son camarade.
Le plus beau témoignage de bonne camaraderie devait lui être rendu de la part de ses adversaires politiques et sociaux au jour même de sa mort. Les éléments progressistes de la Fédération des Cheminots avaient prévu une journée de propagande avec réunion et cortège à GOIN pour le 21 juin 1921. La délégation arrivée, musique en tête, à la gare, apprend que Monsieur SCHMITT vient de mourir au presbytère de GOIN chez son fils. Aussitôt, la manifestation est décommandée, et ses anciens collègues, oubliant toutes les divergences qui les séparent de lui, montent vers le presbytère, en cortège, pour s'incliner devant la dépouille mortelle de leur camarade.
Il était à la retraite depuis cinq ans ; depuis longtemps, il aurait pu être oublié, mais son souvenir était resté vivant dans l’esprit et le cœur de tous.
1. Au service de la classe ouvrière
Jean-Pierre SCHMITT était un ouvrier modeste et sans ambition.
Il ne cherchait ni honneur ni considération particulière. Il s’adonnait à son travail sans autre préoccupation que celle de procurer la subsistance à sa famille. Mais, grand cœur, prenant toujours part à la souffrance des autres, soucieux de la promotion sociale de la classe ouvrière, il ne pouvait vivre, comme nous l'avons déjà démontré, en marge du grand mouvement de la vie communautaire, alors que, dans sa modestie, il n'avait jamais songé à jouer un rôle dans la Société.
2. Les Associations
Monsieur SCHMITT se trouve placé dans une agglomération de 10. 000 âmes, qui constitue la commune et la paroisse du SABLON. Son sens chrétien, son sens social, son sens politique se réveillent tout à la fois. Il fera partie du chœur paroissial Saint-Léon, du Conseil de Fabrique, de l’association pour la construction de la nouvelle église, de l’association des hommes du Cœur-de-Jésus, du syndicat chrétien, de la Caisse d'Epargne communale, de l'Action Catholique et, enfin, de l'Association politique du Centre ; tout cela fait appel à son activité chrétienne et sociale. Il aura sa place toute désignée au Conseil Municipal du SABLON et, à partir de 1914, à l’assemblée municipale de METZ. Il y fut actif pendant 18 ans. En qualité de conseiller municipal, il devait jouer un rôle prépondérant et fournir un excellent travail.
Dans une précieuse et étroite collaboration avec les curés qui se succédèrent à la tête de la paroisse du SABLON, tout particulièrement avec Monsieur le curé Joseph MEYER ainsi qu’aux côtés de grands lutteurs qu’animait un même esprit chrétien et parmi lesquels il faut mentionner l'inoubliable secrétaire en chef du réseau A.-L, FRANKUM, Monsieur SCHMITT sut se rendre utile à sa paroisse, à sa commune, à son pays, tout simplement en étant un membre extrêmement actif dans toutes les Associations énumérées ci-dessus. Dans tous ces groupements il occupait une situation en vue, quand il n'en était pas le président.
Les Associations ne sont pas des écoles d'enfants bien sages où tout se passe sans heurt et dans le calme. Le bien commun est en jeu. Dans la poursuite de ce bien commun des luttes souvent bien âpres s’engagent, des frottements et des oppositions sont inévitables. C’est l'affaire du président de calmer les esprits et de ramener les débats à leurs justes proportions. Il faut pour cela un grand tact, une grande élévation de vue, une profonde connaissance du cœur humain ; toutes ces qualités Monsieur SCHMITT les possédait à un haut degré.
Dans une réunion d'une association précitée, un membre produit un acte d’accusation de 45 pages dirigé contre la personne du président d’honneur de 1’association, le curé d'alors, qui était un homme de grand mérité. Les arguments n’y avaient qu'une valeur bien relative. On y lisait : « Tout le monde sait qu'un homme bien élevé, quand il salue une dame, doit former avec son coude un angle de 45° ; le président d’honneur n’a pas observé cette règle en saluant la fille du plaignant… ». L’accusé veut interrompre à plusieurs reprises l’orateur un peu prétentieux. Monsieur SCHMITT, par des interventions très discrètes, sut calmer le prêtre, son sourire indiquait bien qu’il dominait la situation et qu’il était assuré de pouvoir pacifier les esprits. L'assemblée où se trouvait réunies plusieurs centaines e personnes semble vouloir se partager en deux camps. Le président se montre très habile en demandant tout d’abord à tous ceux qui paraissent le plus excité de dire ce qu’ils ont sur le cœur.
En quelques mots précis, il résume la situation, en évitant avec soin tout ce qui pourrait blesser et apparaître trop personnel. Mais, sans détour, il place chacun devant ses responsabilités. Il fait ressortir l’aspect comique de la situation, et avec une certaine ironie et beaucoup de finesse, il sait faire rire l'assemblée et par même ramener les choses à leurs justes proportions. Les vagues qui soulevaient les esprits s’apaisent et tout rentre rapidement dans le calme. L’accusateur ne peut s’empêcher de s’écrier : « Monsieur SCHMITT, vous me reconnaissez la victoire, mais c'est une victoire à la Pyrrhus ; encore un pareil succès et je suis battu pour la vie. »
Quand à l'ordre du jour figurent des questions très combattues ou des questions qui touchent à des intérêts personnels, toujours Monsieur SCHMITT sait trouver la solution qui satisfait tout le monde et cela sans s'engager dans de grands discours.
Les succès sur le plan social ne s’obtiennent pas sans peine. Il faut continuellement faire taire ses opinions personnelles et ne considérer en toutes circonstances que le bien commun. Tout cela ne va pas sans combat intérieur ni renoncement continuel. Certes, il est aguerri par la lutte, mais son âme reste extrêmement sensible. Une larme parfois perle dans ses yeux ; et devant les siens il ne cache pas sa sensibilité.
Dans ses luttes pour la bonne cause, il ne se laisse jamais arrêter par la fatigue, conscient qu'il est toujours de son devoir. Certaines semaines, il est pris presque tous les soirs par des réunions. Après le diner, on le voit sommeiller quelques instantes, appuyé contre le buffet de la cuisine. Mais bientôt, après s’être ressaisi et après avoir pris courage, il se rend à la salle de réunion où il est attendu. Quoique ces réunions se prolongent très tard, le lendemain matin, dès avant six heures, déjà il est debout.
Monsieur FRANKUM qui, pendant des années, lutte courageusement avec papa SCHMITT pour la cause de la vérité, de la liberté et du droit, résume dans un article nécrologique de LA VOIX LORRAINE du 28.6.1929 : « Dans la vie des Associations, des moments parfois orageux sont inévitables ; il s’agit de surmonter les difficultés. Il faut lutter pour faire triompher les principes qui nous sont chers. Monsieur SCHMITT savait toujours être à la hauteur de sa tâche. Sa règle de conduite était la suivante : « Les difficultés sont là pour être vaincues. Là où il y a de la volonté, l'action est toujours possible. »
Cette volonté qui arrivait à surmonter tous les obstacles n’était pas une volonté brutale mais une volonté toujours humaine, qui gardait le sens de l’homme et qui réussissait par son habileté sans recherche d’intérêt personnel et respirant une véritable noblesse. Sa volonté aussi se trouvait en toute occasion renforcée par un sens profondément chrétien des valeurs et des réalités de la vie.
3. Sa charité à l’égard de chacun
Monsieur SCHMITT agissait toujours poussé par son bon cœur. On peut dire qu’il était comme un aimant qui attire tout à lui. Il devenait, de plus en plus, un homme « mangé ». Dans sa petite maison de la rue Saint-Pierre, président de nombreuses Sociétés, conseiller municipal, il était littéralement assiégé par des personnes qui avaient besoin de ses conseils ou qui voulaient recourir à ses services.
Possédant l’allemand comme le français, Monsieur SCHMITT doit intervenir et s'entremettre dans des cas innombrables. Sans bruit il fait le bien, un bien que les journalistes ne devaient jamais relater.
Au début de la grande guerre, il a l'occasion bien souvent de montrer ses sentiments humanitaires et chrétiens. Cet homme réaliste et pratique est touché jusqu’au plus profond de son être quand le canon se fait entendre sur les champs de bataille bien proches.
La compassion qu’il éprouve pour les souffrances de ses semblables, il la manifeste comme membre du jury aux Assises. Là, plus qu’ailleurs encore, c'est sa conscience chrétienne qui parle et qui lui dicte son devoir et le rend indulgent. Il sait redresser des vies brisées en demandant aux juges de mitiger la sévérité de leur jugement.
Certes, le prévenu est coupable, les crimes peuvent être prouvés, mais la Société elle aussi a ses torts. Jamais il ne désespère de pouvoir faire revenir un délinquant à de meilleurs sentiments. Jamais il n’eut à se repentir d’avoir fait jouer la note de l’indulgence, toujours ceux qui bénéficiaient de cette indulgence se montrèrent reconnaissants en persévérant dans la voie du redressement qui s'ouvrait devant eux.
Il eut un jour le désagréable devoir de défendre devant la justice une Société dont il était président. Des irrégularités avaient été commises par un membre qui s'était placé, par le fait même, dans une situation extrêmement fâcheuse. Par son intervention, le président sauva une famille, honorable par ailleurs, du déshonneur, et prit à sa charge la plus grosse partie de la somme à rembourser.
Au service de son créateur
La vie de Monsieur SCHMITT fut une vie bien remplie, pleine de sacrifice et de mérite. Il suffit de rappeler les années particulièrement dures de sa jeunesse, les années aux journées trop remplies comme ouvrier des Ateliers de Montigny, qui ne connurent guère de congés ou relâche, son labeur incessant au jardin et aux champs aux côtés de sa compagne de vie, les sorties nocturnes au marché de Metz, les soirées absorbantes consacrées aux fréquentes réunions de sociétés, ses interventions courageuses inspirées par le sens de ses responsabilités de la vie publique. On doit se demander comment tout cela fut possible et d'où il tirait cette force pleine de joie qui le poussait à se mettre sans réserve au service de son prochain.
Le secret de cette prodigieuse et bienfaisante activité, il faut le chercher uniquement dans sa vie intérieure bien ordonnée. C'était un homme tout orienté vers Dieu dont la pensée ne le quittait que rarement.
Deux grands sentiments religieux animaient plus particulièrement cette grande âme : sa confiance en la Mère de Dieu et son amour filial à Jésus-Eucharistie. Dès ses jeunes années, ce double amour surnaturel avait pris racine dans son âme.
Il portait toujours son chapelet sur lui et il l’égrenait très régulièrement à une heure précise de la journée et cela, très fidèlement, toute sa vie. C'est la Mère de Dieu qui conduit cet homme simple, issu du peuple ; elle lui montre le chemin qu'il faut suivre. On ne peut mettre en doute la protection toute particulière que lui valut sa grande confiance en Marie. On le voyait se diriger très fréquemment vers l’église pour une courte visite au Saint-Sacrement. Même fatigué et harassé, même s'il fallait faire un détour, il trouvait moyen de pénétrer dans une église pour y demeurer quelques instants, conversant avec son Dieu. Dans la suite, utilisant les loisirs de sa retraite, il a pu passer tous les jours une grande heure dans la pénombre du sanctuaire à la lueur de la lampe de la Présence réelle. Le soir, il termine sa prière régulièrement par trois signes de croix, tel un prêtre, qu’il trace devant lui. On n'a jamais su quelle intention il mettait en cette habitude.
Les jours de fête, il n’oublia pas de s’approcher de la table eucharistique. A un certain moment de sa vie, il pratiqua la communion mensuelle, regrettant toujours que cette pratique ne lui ait pas été conseillée dès sa jeunesse.
Son esprit de foi était profond. Tout ce qui arrivait, les grands événements comme les petits, furent jugés à la lumière de la foi, et il n'hésitait pas à s'agenouiller aux pieds de son fils pour lui demander l'absolution des fautes qui échappaient à la vigilance de son âme.
Lorsque son deuxième fils l'aborda, un jour d’élection municipale…, pour lui demander de bénir paternellement la décision qu'il avait prise de devenir prêtre comme son frère aîné, il fit une réponse héroïque digne d'un saint : « Je n'ai pas le droit de te détourner de ta décision, mais écoute ceci : je devrai travailler dix ans de plus que je ne pensais, mais, en compensation, j'attends de toi que tu deviennes un bon prêtre. Ton désir signifie pour moi un gros sacrifice, il implique la mort de mon nom ; je n’aurai pas de descendants. » Peut-être sa tristesse était-elle adoucie en pensant qu'à la place d’une famille charnelle il pourrait avoir une famille spirituelle nombreuse née de la grâce.
Le fils, en effet, d'abord impressionné par la réponse du père, mais connaissant sa foi profonde, fait une délicate allusion à cette espérance, sans attendre les révélations de la bonté de Dieu que nous réserve l'Éternité ; dès aujourd'hui, nous pouvons affirmer que Dieu a agréé le sacrifice du père et qu'il lui a donné une nombreuse postérité. En voici la preuve :
En 1933, ses deux fils prêtres s'adressèrent, au maire de METZ, Monsieur Paul VAUTRIN, pour lui demander de mettre un immeuble à la disposition d’une œuvre devant accueilli des anciens tuberculeux en vue de les réadapter à la vie et de les rééduquer professionnellement. A leur grande joie, la réponse de Monsieur 1e Maire consacra leur père fondateur de l’œuvre. Il fit remarquer qu’il ne connaissait pas les fils, que leur projet trouverait difficilement l’agrément du Conseil Municipal, mais il ajoute qu'ayant vu à 1’œuvre leur père au Conseil Municipal de Metz, c’est à lui qu’il faisait confiance en ses fils et que par cet argument il espérait emporter un vote favorable au Conseil. Comme par miracle les élus de la Ville de Metz ne firent aucune objection. L’œuvre du « Centre de Réadaptation de PLAPPEVILLE » était créé. Le doigt de Dieu était 1à.
Etre le père de prêtres est en certaines circonstances un appel à collaborer à 1a Rédemption des hommes. Il dut monter ce calvaire, il dut souffrir et se sacrifier pour ses fils. Et quand la croix du Christ pesa lourdement sur les épaules de ses fils, risquant de terrasser aussi les pauvres parents, le père trouva pour la mère, dans sa douleur, les paroles de consolation qui révèlent la profondeur de sa vie intérieure et qu'on ne peut citer sans grande émotion : « Fais comme moi j'essaye de faire ; prie, pleure et tais-toi… ». Ainsi voulait-il dire : « Pleure, prie, car seul le Tout-Puissant peut te secourir, mais tais-¬toi, car aucune aide ne te viendra d’ailleurs ». Dans un style concis il disait ce qu’ailleurs nous avons pu lire :
| « Le hasard ne fait rien, Tout vient de Dieu, Ce qu'il veut, ce qu'il fait, C'est pour notre bien dans l'au-delà. » |
« Le vrai christianisme, aimait-il à dire, ne peut se réaliser sans sacrifices. » Tous ceux qui, en sa présence, se plaignaient des duretés de la vie, il savait les réconforter et les calmer. Il avait une manière populaire, bien à lui, qui ne manquait jamais son but, et il forçait à sourire ses visiteurs qui, parfois, pleuraient amèrement.
Il a volontiers recours à des légendes populaires qu’il arrange pour les besoins de la cause. Par exemple :
« Un ouvrier quitte son village pour tenter fortune ailleurs ; sa croix, pense-t-il, est trop pesante. Arrivé sur la hauteur de la première colline, il ne peut s’empêcher de jeter un regard sur sa maison, en bas dans la vallée, que voit-il ? Sur toutes les maisons brillent des croix, toutes plus grandes que celle qui illumine son toit. Un peu honteux, car il a compris, il retourne chez lui, ayant repris courage. »
Monsieur SCHMITT évite les débats théologiques, quoiqu'il soit capable de discuter bien des problèmes religieux, Les discussions, quand il juge utile de les faire, sont inspirées par son grand bon sens, par l’expérience de la vie, par de grands principes religieux.
Ses principes religieux apparaissent dans toutes ses réflexions. Il se les applique tout d'abord à lui-même avant de formuler une ligne de conduite valable pour les autres. Et ses principes sont fort simples. Ils peuvent s'énoncer ainsi : « Sois content de ton sort, abandonne-toi à la volonté de Dieu, la croix et la souffrance élèvent, spiritualisent et vous libèrent. » Une parole qu'il répétait souvent, la variant selon les circonstances : « L'homme est l'artisan de son bonheur, mais aussi de son propre malheur. »
Nous ne devons pas passer sous silence la présentation qui lui était familière d'une délicieuse scène qui se passe, parait-il, devant le trône du divin Juge : Le Père éternel laisse se défendre d'abord un candidat au ciel et lui donne la parole :
Je ne suis pas content, mon Dieu !
Bien, pourquoi pas, mon enfant ?
La vie que tu m'as donnée fut par trop amère !
Eh bien, écoute : cette première croix, qui était si lourde, vient-elle de moi ?
J'aurais pu l`éviter si j avais été plus sérieux et si j’avais vécu selon tes commandements. Et cette deuxième, cette troisième, quatrième, huitième croix ?
Là aussi j'ai commis des erreurs, Père céleste, je dois 1’avouer.
Enfin vient la dernière croix, la dixième et aussi la plus 1égère, celle-là vient de moi. Et maintenant tu as la parole…
Avec cette bonté souriante qui fit rayonner la bonne humeur, dans la joie et dans la peine, il se meut dans une grande sérénité qu’il communique aux autres. Comme Jésus, il passe en faisant-du bien.
En vérité, au service de son Créateur, il a mené le bon combat.
Les dernières années
Ce furent cinq années de progressif et douloureux affaiblissement, mais aussi d’abandon toujours plus parfait à la sainte volonté de Dieu.
En fait, pendant sa maladie, il lui arrive de s'impatienter sur des vétilles. Il a toujours été d'un tempérament vif, il aimait l'ordre en tout ; les forces qui auraient permis de réprimer les mouvements de sa nature étaient épuisées. Les impatiences s’expliquaient facilement. Mais ses amis et les siens arrivent facilement à le calmer. Il serait injuste de vouloir juger sévèrement les faiblesses de sa vieillesse qui se trouvaient par ailleurs largement compensées par les témoignages de tendresse qu'il prodiguait autour de lui, surtout à la compagne de sa vie.
C'était émouvant de voir comment l'homme dur comme du métal prenait dans les derniers mois de sa vie terrestre un aspect d'enfant, attaché fidèlement dans son amour indéfectible à sa compagne : « Mère, chuchotaient doucement ses lèvres, mère, je ne suis plus rien pour toi, il faut que dorénavant tu luttes seule. » Il avait toujours souhaité pouvoir la précéder dans l’éternité ; il se sentait trop faible pour l'assister dans ses derniers moments et la porter en terre. Cette prière semble avoir été exaucée. C'est une chose sacrée que l'amour qui lie deux êtres pour la vie et pour l'éternité.
Il souffrait longuement de pénibles souffrances ; il les offrit pour 1’activité sacerdotale de ses fils ; il ne fut pas difficile d’obtenir du malade cet aveu.
Ses funérailles furent un triomphe. La vaste église du SABLON, dont il fut un peu le premier bâtisseur après le curé, Monsieur Joseph MEYER, était à peine assez grande pour contenir tous ceux qui étaient accourus pour lui rendre les derniers hommages. Parmi eux se trouvaient plus de quarante ecclésiastiques, et, à leur tête, le Vicaire Général Mgr SIEBERT qui appelait ami le modeste ouvrier du SABLON.
Monsieur SCHMITT fut enterré dans le caveau de famille au nouveau cimetière du SABLON. Les siens comptent sur ses prières auprès de Dieu et demandent la faveur de reposer à ses côtés, dans l'espérance de l'heureuse et commune Résurrection.
Mardi 25 juin 1929 (Le Lorrain) GOIN Nécrologie. – La paroisse de Goin a pris une grande part au deuil de son curé, M. l’abbé Ernest Schmitt, à l’occasion du décès de son père, M. J.-P. Schmitt, au presbytère du Goin, à l’âge de 69 ans seulement, après une longue et dure maladie. L’inhumation devant avoir lieu au cimetière du Sablon, un premier service eut lieu hier à l’église de Goin ; dès 7 h. 30 du matin. La population du village, hommes et femmes, assistaient en très grand nombre à cet office, maire, conseil municipal et conseil de fabrique en tête ; les enfants, sous la conduite de M. Bichel, instituteur, ouvraient le cortège ; derrière le cercueil, deux prêtres, fils du défunt, MM. les abbés Ernest et Victor Schmitt, puis sa veuve et sa fille et les membres de la famille. L’office fut célébré par M. l’abbé Chevreux, archiprêtre, ancien vicaire du Sablon, assisté et entouré de plusieurs curés voisins de Goin. Le conseiller général du canton de Verny avait voulu se joindre également à ses compatriotes en cette circonstance. De l’église de Goin, le corps fut accompagné jusqu’à la sortie du village par les écoliers, les écolières et par l’assistance paroissiale. A MM. les abbés Schmitt, à leur mère, à leur sœur et à toute la famille, nous renouvelons ici l’expression de nos sincères condoléances. R.I.P. |
 |
| | Retour page précédente | |